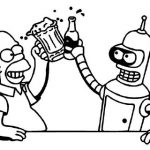INTRODUCTION
La scission de l’Union Nationale des Etudiants de France en février 1971 clôt, pour l’U.N.E.F, une période de division et de fractionnement engagée depuis la fin de la guerre d’Algérie. En effet, dès 1961, le gouvernement Debré encourage, puis reconnaît, la dissidence et la création de la F.N.E.F (Fédération Nationale des Etudiants de France). Il souhaite ainsi ” punir ” l’U.N.E.F pour ses prises de position très engagées et progressistes sur le problème algérien.
Cependant, la scission de 1971 ne met pas un terme à l’éclatement de la représentation syndicale étudiante. De 1971 à 1996, un phénomène d’émiettement toujours plus prononcé du mouvement étudiant se poursuit sans que rien ne vienne l’entraver. Le Plan Social Etudiant de Lionel Jospin, alors ministre de l’Education Nationale, favorise au contraire le regroupement des multiples associations étudiantes locales au sein de nouvelles structures nationales.
L’opposition entre les conceptions opposées du syndicalisme étudiant, entre les visions différentes de la représentation étudiante (P.D.E refuse de se concevoir comme un syndicat étudiant et revendique une vision corporatiste de la représentation étudiante), entre les clivages politiques favorise un éclatement du mouvement étudiant :
• 1971 : Scission de la ” grande U.N.E.F ” et création de deux branches distinctes et rivales, c’est à dire l’U.N.E.F-Renouveau (qui redevient dés 1971 l’U.N.E.F) et l’U.N.E.F-Unité Syndicale.
• 1975 : Création du CLEF (Comité de Liaison des Etudiants de France) rassemblant surtout des corpos de Droit et de Médecine, et du CELF (Comité des Etudiants Libéraux de France) à forte obédience giscardienne.
• 1976 : La C.F.D.T investit le syndicalisme étudiant en soutenant la création du Mouvement d’Action Syndicale, qui se veut une passerelle entre les deux U.N.E.F. Dans le même temps, le Parti Socialiste, réunifié depuis peu, tente lui aussi de réintégrer le terrain du syndicalisme étudiant avec le C.O.S.E.F (Comité d’Organisation pour un Syndicat des Etudiants de France), mais échoue rapidement.
• 1980 : L’U.N.E.F-Unité Syndicale et le M.A.S fusionnent dans une nouvelle entité : l’U.N.E.F Indépendante et démocratique.
• 1989 : La fondation de la F.A.G.E (Fédération des Associations Générales d’Etudiants) au congrès de Strasbourg en 1989 est une conséquence du Plan Social Etudiant de L. Jospin. Plus gestionnaire que revendicative, elle s’implante rapidement dans 25 villes universitaires et demeure d’esprit plutôt conservateur, puisqu’elle défend le maintien des traditions estudiantines comme la faluche.
• 1990 : Création du Renouveau Etudiant par Carl Lang, secrétaire général du Front National. Appendice du F.N à l’Université, il demeure à l’état de groupuscule.
• 1994 : Scission de la F.A.G.E : des étudiants de Droit, de Sciences Economiques et Politiques quittent la F.A.G.E et fondent P.D.E.
• 1996 : Création de Sud-EtudiantEs, issu du mouvement de novembre-décembre 1995.
La scission de l’U.N.E.F en 1971 apparaît comme une péripétie parmi les autres dans l’histoire agitée du syndicalisme étudiant. Le paysage syndical étudiant est en recomposition permanente. Pourtant, la scission de l’U.N.E.F en 1971 reste l’objet de l’attention des historiens… . Plusieurs raisons expliquent cet intérêt : la plupart des créations, c’est le cas du CELF, du CLEF, du C.O.S.E.F, du Renouveau Etudiant… sont des structures éphémères et/où sans grand impact sur le milieu étudiant. De plus, la scission marque la fin d’une époque, d’un symbole, voire même d’un mythe pourtant déjà bien ébréché : la ” grande U.N.E.F “. Enfin, en dépit de l’affaiblissement consécutif à la scission, les deux branches de l’U.N.E.F vont dominer le paysage syndical étudiant jusqu’à nos jours.
A Lyon, jusqu’au milieu des années 80, un syndicat étudiant puissant renaît de ses cendres. Il va dominer le mouvement étudiant lyonnais pendant une quinzaine d’années avant de péricliter. Issu de l’U.N.E.F-Renouveau, il influence le milieu étudiant lyonnais de sa création en 1971 à sa disparition en 1994. Le syndicalisme étudiant possède déjà à Lyon ses lettres de noblesse et une riche histoire. En effet, l’A.G.E.L, affiliée à l’U.N.E.F, joue un rôle considérable dans la rénovation de l’organisation étudiante, moribonde et discréditée, issue de la guerre. Forte de 7200 adhérents en 1946 (soit les 2/5 des effectifs de l’U.N.E.F, qui compte 18 000 adhérents), elle est à l’origine de la Charte de Grenoble de 1946, texte constitutif de l’U.N.E.F. Fortement inspirée par la Charte d’Amiens, texte fondateur du syndicalisme ouvrier français, elle donne trois dimensions à l’étudiant : jeune, travailleur, intellectuel et transforme l’U.N.E.F en syndicat. Appuyée par les A.G.E de Toulouse et de Paris-Lettres, elle est à l’origine du projet d’Allocation d’études adopté en 1950 au congrès d’Arcachon. Enfin, l’A.G.E.L est à l’origine de la ” minos “, groupe minoritaire de l’U.N.E.F au début des années 50 et de l’engagement anticolonial de l’U.N.E.F adopté en 1950.
Mais, si un certain nombre de recherches nationales ou locales ont été consacrées à la scission et surtout aux périodes précédant la scission, très peu se sont penchées sur l’évolution des deux ramifications de l’U.N.E.F après 1971. Comment expliquer l’absence, ou presque, de travaux sur l’histoire de l’U.N.E.F ou de l’U.N.E.F-Unité Syndicale après 1971 : période jugée trop contemporaine ? dédain des historiens envers une période qui apparaît bien pâle par rapport à celle de la ” grande U.N.E.F ” ? difficultés pour trouver de la matière exploitable et accessible ?.
——————————————————————————–
PRESENTATION DU MILIEU ET DU SYNDICALISME ETUDIANT A LYON
En dépit de sa présence quotidienne sur les campus, le syndicalisme étudiant est très mal connu des étudiants. Peu nombreux sont aujourd’hui les étudiants qui connaissent la véritable signification du sigle U.N.E.F. ou du simple terme d’A.G.E… . C’est pourquoi il convient de s’attarder quelque peu sur le syndicalisme et le milieu étudiant.
De par l’importance prise par la scission de l’U.N.E.F. en 1971 dans le paysage syndical lyonnais, nous devons décrire, assez succinctement malheureusement, les événements qui aboutissent à la création de l’A.G.E.L-U.N.E.F en février 1971. Avant 1971, le mouvement étudiant demeure, en dépit de la scission de la F.N.E.F., relativement uni sous l’égide de l’U.N.E.F. En l’espace de trois ans, le paysage syndical étudiant se recompose complètement et aboutit à la naissance de trois organisations syndicales étudiantes : l’A.G.E.L., l’A.G.E.L-U.N.E.F. et l’U.G.E.L-U.N.E.F. Il convient donc de s’interroger sur les particularités de la ” scission ” de l’U.N.E.F. à Lyon et des bases sur lesquelles se fait la création de l’A.G.E.L-U.N.E.F.
Cependant, le syndicalisme étudiant ne peut pas être coupé artificiellement du milieu étudiant, duquel il est issu. En effet, des interactions existent entre le milieu et le syndicalisme étudiant. Tous deux sont confrontés de 1971 à 1994 à deux phénomènes : la ” massification ” de l’Enseignement Supérieur et la crise de l’Université. Le monde étudiant connaît, durant ces 24 années, une progression numérique continue. Cette croissance ne se fait pas sans difficultés, crises, qui se traduisent par des mouvements étudiants auxquels participe activement l’A.G.E.L-U.N.E.F. Une attention particulière doit donc être accordée à l’étude des diverses crises qui secouent le monde étudiant et à la place de l’A.G.E.L-U.N.E.F. au sein des mouvements étudiants.
——————————————————————————–
Chapitre I. De l’A.G.E.L. affiliée à l’U.N.E.F., à l’A.G.E.L.-U.N.E.F. en passant par l’U.N.E.F.- Renouveau : le temps des recompositions du syndicalisme étudiant à Lyon 1968-1971.
I. De la crise à la scission de l’U.N.E.F. : le cadre national 1965-1971.
Un affaiblissement rapide. 1965-1968.
L’échec de la gauche syndicale et de l’orientation syndicaliste-révolutionnaire.
De 1965 à 1968, l’U.N.E.F. connaît un affaiblissement rapide, à la fois numérique et idéologique. En effet, les différents congrès de cette époque ne permettent pas de dégager d’orientations claires et continues.
Le congrès de Bordeaux en 1965 fait éclater au grand jour la faillite de la gauche syndicale et de l’orientation syndicaliste-révolutionnaire. Cette orientation, prônée par les Statutaires (Tendance de la gauche syndicale, elle-même tendance de la mino), estime possible l’existence d’un syndicalisme étudiant révolutionnaire ayant sa propre stratégie et indépendance vis à vis des partis de gauche. Cependant, aucune autre orientation ne se dégage et ne prend la relève. Les statutaires (tendance du courant mino au sein de l’U.N.E.F.), tirant les leçons de leur échec, tentent d’imposer leur projet à l’U.N.E.F., tout en renonçant à la diriger. A l’inverse, les A.G.E. de Province demeurent silencieuses et ne présentent pas de projet alternatif. C’est en particulier le cas des quelques A.G.E. dirigées par des militants communistes : Lille… .Face à cette situation de blocage, le congrès s’éternise et perdure bien au-delà de ses dates initiales, sans trouver un compromis ou une solution. Finalement, les dirigeants de la Fédération Générale des Etudiants de Lettres (F.G.E.L.) ouvrent une porte de sortie en proposant un ” plan de travail “, c’est à dire un ” catalogue ” de revendications à la fois universitaires, sociales et culturelles. Mais surtout, le nouveau bureau restreint volontairement son rôle et se cantonne désormais à un simple rôle de coordination, en particulier dans le domaine de la propagande. Les projets théoriques de la gauche syndicale (renouveau offensif du syndicalisme, rapport de force direct avec l’Etat, politique visant à pousser au maximum les contradictions qui traversent le système universitaire…) sont provisoirement gelés en prévision de jours meilleurs.
Le Bureau National prend comme principal objectif la ” reconstruction technique ” de l’organisation. En effet, l’état de l’U.N.E.F., en particulier dans le domaine financier, est inquiétant et problématique : dettes importantes ( elles atteignent les trois-quarts de son budget annuel), non-paiement des cotisations par des A.G.E., affaiblissement numérique (moins de 50 000 adhérents selon A.Monchablon), déclin des publications, renouvellement difficile des dirigeants, perte d’A.G.E. minos au profit des majos (AGEMP, Sc Po Paris, Institut catholique).
La nouvelle politique, considérée et assumée comme un ” retour à droite ” par le nouveau bureau, offre un bilan contrasté : certes, une indéniable diminution de l’endettement permet de pérenniser, d’assurer la survie de l’organisation. Mais le bilan politique sonne davantage comme un échec : incapacité à lancer des campagnes revendicatives contre les réformes gouvernementales de 1965, à générer au sein même du syndicat une nouvelle génération de militants et de responsables (un certain nombre de postes demeurent inoccupés au BN), exacerbation des divisions politiques (lors de l’A.G. de février 1966, six textes d’orientation contradictoires sont proposés). Enfin, le score réalisé par F.Mitterrand à l’élection présidentielle de 1965 met en accusation ce qui reste de l’orientation syndicaliste-révolutionnaire du bureau national. En effet, seule l’U.N.E.F. refuse à gauche en mars 1965 d’appuyer l’idée d’une candidature unique face à De Gaulle aux élections présidentielles, et donc de soutenir F.Mitterrand. La situation de l’U.N.E.F. à la veille du congrès de Grenoble est celle d’une organisation en déclin : baisse du nombre d’adhérents, effacement du programme syndical, isolement politique à gauche.
L’intermède ” centriste ” du congrès de Grenoble.
Le congrès de Grenoble, en avril 1966, ouvre une période, un intermède qualifié de ” centriste “. Le congrès est tout d’abord marqué par deux évolutions internes :
Le retrait des deux tendances de la gauche syndicale (Statutaires et Structuristes), ce qui confirme l’effacement du ” projet d’un syndicalisme étudiant révolutionnaire ayant sa propre stratégie “.
La naissance d’affrontements entre organisations politiques pour le contrôle de l’U.N.E.F. Ils sont principalement le fait du C.L.E.R. et de l’U.E.C.
Toutefois, cette évolution est momentanément contrecarrée par la naissance d’une coalition du ” centre ” décidée à poser sa candidature à la direction de l’U.N.E.F. Elaborée difficilement, elle se compose principalement de l’A.G.E. de Lille et du cartel des ENS. Elle développe une orientation modérée dans ses objectifs et ses formes d’action, et prône un rapprochement avec les ” forces démocratiques “. Il s’agit donc d’un véritable retour du syndicalisme étudiant dans son rôle traditionnel : les luttes universitaires sans heurter l’Etat centralisateur. Elle rompt désormais avec les idées du syndicalisme-révolutionnaire, et en particulier avec celle d’un syndicalisme étudiant révolutionnaire autonome dans ses stratégies. L’U.N.E.F. réaffirme cependant son indépendance dans son domaine privilégié, c’est a dire le terrain universitaire. Cette orientation, difficilement adoptée par le congrès, doit rechercher la ” neutralité bienveillante de la gauche syndicale “, qui accepte en participant au bureau national.
Cependant, la nouvelle orientation éprouve des difficultés à franchir le cap de la rentrée universitaire 1966-1967. L’U.N.E.F. connaît à nouveau des difficultés financières, tandis que le B.N. s’avère incapable d’assurer la rentrée revendicative. Les échos de la révolution culturelle chinoise achèvent le fragile édifice issu du congrès. En effet, les responsables de l’ENS se convertissent au marxisme-léninisme, fondent l’U.J.C.M.L., et renoncent à lutter contre le plan Fouchet, à développer des objectifs revendicatifs. En janvier 1967, le B.N. démissionne.
La prise de pouvoir P.S.U.
La démission du B.N. en janvier 1967 va permettre une prise de pouvoir par le P.S.U., et ouvrir une nouvelle ère : la prise de contrôle du syndicat étudiant par des groupes politiques.
A l’origine, le P.S.U. ne dispose pas véritablement de ligne directrice dans l’U.N.E.F. : ses adhérents se répartissent entre toutes les tendances de l’organisation. Cependant, durant l’été 1966, le P.S.U. pressent l’effondrement de la coalition de Grenoble et commence à investir le syndicat étudiant. Les E.S.U. (organisation du PSU dans le monde étudiant) prennent le contrôle de quelques A.G.E. de province. Lors de l’A.G. des 28 et 29 janvier 1967, le PSU acquiert le contrôle de l’U.N.E.F. avec une très faible majorité. Son texte est adopté par 190 mandats pour, 110 abstentions, 57 refus de vote et 36 mandats contre. La nouvelle orientation est très influencée par le contexte de son élaboration et de son adoption : elle est une compilation de thèmes empruntés aux structuristes et aux statutaires. Pour le P.S.U., l’essentiel réside dans les ” acquis de Dijon “, c’est à dire le maintient de l’U.N.E.F. à l’extrême-gauche et l’idée d’un rôle spécifique des étudiants dans la lutte des classes.
Toutefois, le nouveau bureau est rapidement confronté à l’épreuve du congrès de Lyon en juillet 1967. La situation interne à l’U.N.E.F. est alors peu favorable aux E.S.U. : le B.N., occupé à rétablir le contact avec les A.G.E. de province et à stabiliser la déroute financière de l’organisation, renonce à lancer des campagnes revendicatives et se contente de gérer les affaires courantes. C’est avec ce maigre bilan que les E.S.U. doivent affronter l’U.E.C. lors du congrès. Cependant, appuyés par la F.G.E.L., ils gardent le contrôle de l’U.N.E.F. en faisant adopter de justesse leur motion.
La rentrée universitaire 1967-1968 ouvre de nouvelles perspectives plus encourageantes pour le B.N.. En effet, la conjonction entre l’application de la réforme Fouchet dans le deuxième cycle et l’accroissement des effectifs avec son cortège de difficultés matérielles est à l’origine d’un réveil du mouvement étudiant. Une journée d’action, organisée le 9 novembre avec le S.N.E.Sup contre les conditions de la rentrée, réunit au quartier Latin 5000 étudiants. Or, elle n’avait pas été correctement préparée en raison du manque de moyens. La manifestation du 9 novembre apporte deux changements : elle donne au B.N. P.S.U. l’optimisme nécessaire pour continuer à gérer l’U.N.E.F. et ramène vers le terrain universitaire les groupes gauchistes. Une certaine agitation se développe aussi au sein des cités universitaires depuis 1965. Au début de l’année 1968, des résidents de la région parisienne s’élèvent contre l’interdiction de visite des garçons chez les filles et vice-versa. Ainsi, le début de l’année 1968 marque un renouveau du mouvement étudiant organisé ou non par l’U.N.E.F.
A la veille de 1968, quel est l’état de l’U.N.E.F. ?. Il est tout d’abord celui d’une organisation déliquescente :
• Les dettes menacent la survie de l’organisation et équivalent approximativement au montant annuel du budget. Elles contraignent le BN à la paralysie : absence de matériel, de propagande, interruption de la parution des publications nationales… .
• L’implantation géographique de l’U.N.E.F. se réduit considérablement. Elle passe de 52 A.G.E. en 1960 à 26 en 1968. Et encore, un certain nombre d’entre elles sont des coquilles vides et cessent de payer leurs cotisations… .
• La composition politique de l’U.N.E.F. ne cesse de s’étioler après la suspension des A.G.E. majos parisiennes en novembre 1967. Seule la mino demeure, réduite à trois organisations politiques : l’U.E.C., les E.S.U. et le C.L.E.R.. Les affrontements ont essentiellement pour but le contrôle de l’organisation et non l’élaboration d’un projet syndical.
• Enfin, l’U.N.E.F. doit faire face à une désorganisation interne : le président de l’U.N.E.F., M. Perraud, démissionne en avril 1968. Il est remplacé par J. Sauvageot, qui demeure néanmoins vice-président et non président.
Toutefois, l’U.N.E.F. dispose d’un certain nombre d’atouts pour affronter les événements dans une position correcte :
• Elle possède des contacts avec les centrales ouvrières, même s’ils sont épisodiques. Ils sont cependant assez forts avec la nouvelle direction du S.N.E.Sup., d’obédience P.S.U..
• Elle demeure la seule organisation étudiante à prétention de masse. La F.N.E.F. ne parvient toujours pas à s’implanter sur le terrain universitaire et aucun autre syndicat étudiant ne réussit à émerger. Elle reste, à gauche, la seule organisation étudiante et tous les groupuscules ont leurs entrées.
L’U.N.E.F. connaît donc un affaiblissement numérique, politique et financier, malgré des tentatives de redressement. Elle n’est plus désormais que le champ clos des luttes entre différentes organisations politiques étudiantes.
La chance ratée de mai 1968.
L’explosion de mai 1968 va offrir une nouvelle chance à l’U.N.E.F., même si en définitive, elle s’avère incapable de la saisir.
Le milieu étudiant, à la veille de mai 1968, s’inscrit dans un contexte particulier. En effet, la mobilisation estudiantine se fait surtout autour de deux axes : les réformes universitaires et l’anti-impérialisme.
Les réformes universitaires sont contenues dans la réforme Fouchet, issue d’une concertation restreinte (comme la loi Debré sur les études médicales en 1959) et imposée dans les facultés de Lettres et de Sciences par le ministère en 1966-1967. Conçue sur les suggestions de spécialistes de sciences exactes, elle généralise un organigramme et des cursus refusés par les facultés de lettres. L’organisation des études se tourne vers une spécialisation accrue des formations sur une base disciplinaire et vers deux formations distinctes au second cycle : une filière de formation des enseignants (Licence) et une filière de formation des chercheurs (Maîtrise). A cela s’ajoute la création d’un premier cycle en deux ans sanctionné par un diplôme et remplaçant l’année propédeutique. La réforme vise donc à faciliter la sortie des étudiants à tous les niveaux : fin de premier cycle, licence, maîtrise. De plus, la mise en place du système suppose la sélection à l’entrée des facultés, question de plus en plus d’actualité en 1966 et 1967. Face à cette réforme, les syndicats étudiants et enseignants dénoncent la mainmise de l’économie sur l’Université, l’aggravation de la sélection sociale et le malthusianisme du gouvernement. De 1965 à 1968, des mouvements restreints se développent contre l’application de la réforme Fouchet. (Cf. manifestation du 09.11.1967).La contestation des projets gouvernementaux est donc assez forte.
Le second axe de mobilisation des étudiants est extérieur au monde universitaire, puisqu’il s’agit de l’anti-impérialisme. Ainsi, le 21 février 1968, l’U.N.E.F. appelle aux cotés du Comité Viet Nam national, à une journée de solidarité anti-impérialiste. Elle donne lieu à une importante manifestation au quartier Latin.
Dans ce contexte de mobilisation d’une minorité des étudiants, personne, et surtout pas l’U.N.E.F., n’a vu venir l’explosion de mai 1968. La situation de l’U.N.E.F. est alors critique : difficultés financières, abandon de tout projet syndical, luttes internes… . Cependant, l’U.N.E.F. possède les capacités nécessaires pour s’adapter au mouvement. Elle est au carrefour de tous les foyers d’agitation du monde étudiant, puisque tous les groupuscules ont des adhérents ou contrôlent des A.G.E. : J.C.R., U.J.C.M.L., C.L.E.R.… . De plus, elle possède encore un sigle fédérateur et porteur, et ses A.G.E., bien que vides en militants, possèdent des locaux et de précieuses ronéos pour tirer les tracts !.
L’U.N.E.F. peut donc s’adapter au mouvement, mais elle ne peut pas le diriger. Le meilleur exemple demeure le lieu même de l’origine du mouvement : Nanterre. En effet, la faculté des lettres de Nanterre, récente, est très peu connue par le B.N.. Une A.G.E. existe sur le campus, mais, outre sa faiblesse, elle est aux mains de la J.C.R., et donc très indépendante. Les événements de Nanterre de janvier à mai 1968 se déroulent sans aucun contrôle de l’U.N.E.F. et dans la quasi-ignorance du B.N. !. Par la suite, si l’U.N.E.F. parvient à imposer son sigle, elle ne dirige rien. Ainsi, lors des différentes manifestations parisiennes, le service d’ordre de l’U.N.E.F. est systématiquement supplanté par celui de la J.C.R.. L’U.N.E.F. colle donc au mouvement sans le contrôler, en dépit des efforts de J. Sauvageot. Elle prête sa visibilité, son service d’ordre, son sigle, ses services, son pouvoir d’appel ou de pétition, mais dans une direction qu’elle ne maîtrise pas.
Ainsi, l’U.N.E.F. possède une nouvelle chance avec la crise universitaire de mai 1968. Cependant, la crise sociale et politique prend rapidement le pas sur la crise universitaire. La fin de mai 1968 ouvre une nouvelle période pour l’U.N.E.F. Elle tente, de mai à décembre 1968, de restructurer le mouvement étudiant en réformant ses structures, afin d’intégrer les groupes moteurs de mai 1968 à l’université, c’est à dire les Comités d’Action et les groupes gauchistes. La convocation des Assises de l’U.N.E.F. à Grenoble en 1968 marque le début de ce processus, de cette logique. En effet, à coté des A.G.E., traditionnelles structures de l’U.N.E.F., une invitation à participer aux travaux est lancée aux comités d’action. Le but est d’élaborer une ” nouvelle charte ” et de lancer le débat sur la réforme des structures.
Toutefois, cette tentative aboutit à un échec. Certes, l’A.G. de Dauphine des 4 et 5 mai 1969 adopte la transformation statutaire de l’U.N.E.F. : les anciennes amicales et corpos sont transformées en C.A. Mais la donne politique au sein de l’U.N.E.F. a évoluée : début 1969, les C.A., les étudiants de Rouge (J.C.R.) et les maoïstes de la future ” gauche prolétarienne “quittent l’U.N.E.F., rendant caduques les réformes statutaires de l’U.N.E.F. Désormais, le B.N. P.S.U. se retrouve seul face à deux tendances solidement constituées : l’U.E.C. et l’A.J.S.. Mai 1968, de par ses illusions, ses acteurs, ses structures, apparaît comme une chance ratée pour l’U.N.E.F. : associée tant bien que mal au mouvement, renonçant à le diriger, elle est incapable d’intégrer les forces motrices de l’explosion étudiante et de restructurer le mouvement étudiant. Le B.N. P.S.U. , confronté à l’U.E.C. et à l’A.J.S., sort affaiblit de cette période au moment ou la loi Faure envenime un peu plus les tensions internes.
La scission de l’U.N.E.F. : décembre 1968-février 1971.
De nombreuses scissions émaillent l’histoire de l’U.N.E.F., la plus marquante étant celle de 1961 encouragée par le gouvernement et donnant naissance à la F.N.E.F. De décembre 1968 à février 1971, l’U.N.E.F. subit sa dernière grande crise interne, qui s’achève par une nouvelle scission.
Mai 1968 a fait naître au sein de l’U.N.E.F. de nouvelles tensions. Elles se fondent sur l’attitude de l’U.N.E.F. face aux événements, l’échec de la refonte du mouvement étudiant… . Elles se cristallisent autour de la loi Faure de 1968. Proche des anciennes revendications de l’U.N.E.F., la loi Faure met en place la participation, c’est à dire la présence d’élus étudiants au sein des différents conseils universitaires. En décembre 1968, le congrès de Marseille tranche la question et refuse la participation, au grand dam de l’U.E.C., absente des débats à ce moment là pour protester contre l’invalidation de trois de ses huit A.G.E.. Face au boycott prôné par le B.N. P.S.U. et l’A.J.S., l’U.E.C. annonce le 14 janvier 1969 son intention de déposer partout des listes ” Défense des Intérêts Etudiants ” aux élections universitaires et de créer des ” Comités pour le renouveau de l’U.N.E.F. “. Cette décision marque donc l’émergence d’un nouveau courant au sein de l’U.N.E.F. : l’U.N.E.F.-Renouveau. Cependant, la décision de participer aux élections universitaires pose le problème de l’appartenance de l’U.N.E.F.-Renouveau à l’U.N.E.F., puisqu’elle va à l’encontre d’une décision prise par un congrès. Elle se place donc volontairement hors du cadre fixé par l’orientation adoptée au congrès de Marseille en décembre 1968 et provoque une rupture de la ” discipline syndicale “. De janvier à avril 1969, l’attitude du B.N. oscille considérablement, passant d’une volonté d’exclure les élus de l’U.N.E.F.-Renouveau à une position attentiste et modérée. Elle s’explique sans doute par le taux de participation des étudiants aux élections universitaires qui, en dépit de l’appel au boycott lancé par l’U.N.E.F., atteint 50%.
Le congrès d’Orléans en avril 1970 apparaît dés lors comme une parenthèse. En effet, l’élection d’un nouveau bureau P.S.U. ne cache pas les tensions internes, qui s’expriment au grand jour en octobre 1970. Le B.N., désormais minoritaire et incertain sur le maintien de son engagement au sein de l’U.N.E.F., retarde au maximum la délivrance des cartes pour l’année universitaire 1970-1971. En novembre, une réunion d’étudiants E.S.U. penche en faveur de l’exclusion du courant renouveau. En réaction à cette menace, G. Konopnicki puis M.Sérac saisissent la commission de contrôle composée de deux adhérents P.S.U., un renouveau et un A.J.S.. Cette nouvelle crise accélère la décomposition de l’organisation. Le 5 décembre, l’A.J.S. créée à Dauphine sa propre tendance intitulée ” Unité Syndicale ” et le 10 janvier, le BN annonce sa démission devant le collectif national. Une ” délégation permanente ” est provisoirement mise en place pour pourvoir au remplacement du B.N. démissionnaire et un congrès national est convoqué pour les 21-22-23 février 1971.
La ” délégation permanente ” ne peut cependant pas être une solution viable pour les deux tendances. Chacune tente donc de se fonder une légitimité dans et en-dehors de l’U.N.E.F.
La tendance ” unité syndicale ” s’appuie sur la légitimité du C.N., où elle est désormais majoritaire depuis le départ du P.S.U.. Le C.N. et une assemblée de 140 C.A. convoquent un congrès à Dijon, fief de l’A.J.S.. La présence d’organisations syndicales durant les travaux du congrès apporte un surcroît de légitimité. L’U.N.E.F.-Unité Syndicale obtient ainsi le soutien de la F.E.N. et de F.O., sans doute pour faire contrepoids au P.C.F.. L’U.N.E.F.-Renouveau tente, face à la commission de contrôle dominée par l’A.J.S., de jouer la carte de la base. Elle convoque une assemblée des C.A. qui, à son tour, appelle à un congrès national à Paris. Cette démarche obtient le soutien de la C.G.T. et du S.N.E.Sup.. Cette ” alliance ” ou plutôt convergence entre la C.G.T., l’U.N.E.F-Renouveau et le S.N.E.Sup. va d’ailleurs se poursuivre durant plusieurs années, en particulier au sein des conseils d’université.
Ainsi, la crise permanente dans laquelle s’enfonce l’U.N.E.F. depuis 1965 aboutit à une ultime scission en février 1971 et à la création de deux U.N.E.F. distinctes contrôlées par l’A.J.S. et l’U.E.C.. La scission, au niveau national, apparaît donc comme une lutte d’appareils politiques par l’intermédiaire des tendances. De plus, le cadre de la scission se limite à l’U.N.E.F. et, hormis les derniers avatars de février 1971, les trois tendances luttent dans une même structure : le collectif national. Toutefois, ce schéma, valable au niveau national, est-il adéquat pour les A.G.E. ?.
——————————————————————————–
II. La mise en place de l’U.N.E.F.-Renouveau à Lyon : entre l’appartenance à l’U.N.E.F. et le rejet de l’A.G.E.L.
La scission de 1971 est, au moins pour l’Union Nationale, interprétée comme l’aboutissement d’une lutte interne entre tendances. Trois tendances principales existent : l’U.N.E.F.-Renouveau (U.E.C., quelques socialistes et radicaux de gauche), l’U.N.E.F.-Unité Syndicale (A.J.S.) et le P.S.U.. Toutes trois tentent d’accaparer la direction du syndicat étudiant à leur seul profit personnel. La scission est donc une crise interne, qui engendre l’éclatement de l’organisation. Bien que schématique, cette vision est celle retenue pour la scission de l’U.N.E.F. Cependant, au niveau des A.G.E., la scission se déroule t’elle de la même manière : fonctionnement en tendances, tiraillements et éclatement ?. Il existe sans doute autant de réalités différentes qu’il existe d’A.G.E. dans les centres universitaires. En effet, des A.G.E. sont alors contrôlées par l’U.E.C., l’A.J.S. (Clermont-Ferrand, beaux-arts), par le P.S.U. (Lyon…), les forces des protagonistes ne sont pas les mêmes partout… . Une seule constante se dégage : les effectifs squelettiques de la plupart des A.G.E.. La création de l’U.N.E.F.-Renouveau à Lyon prend un caractère particulier, puisqu’elle se réalise entre l’appartenance à l’U.N.E.F. et le rejet de l’A.G.E.L.
Le catalyseur des divisions : la loi Faure de 1968.
La loi Faure de 1968 va servir de catalyseur aux divisions internes de l’U.N.E.F. Cependant, elle ne marque pas le début de la crise, puisque des oppositions naissent au sein de l’U.N.E.F. à Lyon dés 1966-1967. La structure de l’U.N.E.F., au niveau de l’université lyonnaise est l’A.G.E.L., c’est à dire l’Association Générale des Etudiants Lyonnais. Affiliée à l’U.N.E.F., elle fédère les Amicales implantées dans les multiples facultés : Sciences, Médecine, Lettres, I.N.S.A.… . La direction est alors aux mains du P.S.U. et soutient activement le bureau national.
Des tensions existent au sein de l’U.N.E.F. à Lyon. L’Amicale U.N.E.F. des Sciences, où militent de futurs responsables et leaders de l’U.N.E.F.-Renouveau, se détache progressivement de l’A.G.E.L. considérée comme un conglomérat de groupes gauchistes : ” On a été, on peut le dire, très à l’écart de l’A.G.E.L. Elle était une façade et n’avait plus aucune vie. Elle se maintenait sur sa lancée, puisqu’elle avait le bar, le restaurant de l’A.G.E.L. en-dessous, la M.N.E.F. à coté. Mais au sens de l’U.N.E.F. en tant que telle, c’était le vide. […]Le poids de l’A.G.E.L. comme structure fédérative sur Lyon était inexistant. “Un malaise latent se développe entre l’A.G.E.L. et certaines amicales, et se traduit par une autonomie, une distanciation des amicales vis à vis de la structure fédérative.
Les événements de mai 1968 vont renforcer les oppositions, les lignes de fracture. Jusqu’au six mai, les incidents de Paris ont peu d’influence sur les campus de Province. Quelques militants d’extrême-gauche tentent de mobiliser la faculté des Lettres, mais ils ne rencontrent qu’une relative indifférence de la part des étudiants. Toutefois, un terreau favorable à la contestation existe : les étudiants sont confrontés sur les deux campus universitaires (Les Quais et la Doua) à des conditions matérielles difficiles. Sur le campus de la Doua, des étudiants de Droit, de Lettres, et de Sciences cohabitent au milieu d’un vaste chantier. Entrepris en 1967, le nouveau campus se transforme dés les premières pluies en un vaste bourbier : ” La Doua, c’était l’enfer.[…] On arrivait, on marchait dans la boue… . C’était le bout du monde à l’époque !. On marchait dans la boue pour arriver aux amphis… ” Le campus de la Doua, tel Nanterre, est un immense chantier où se retrouvent les étudiants. Mais, en dépit de cette situation, les événements de mai surprennent la plupart des étudiants, mais aussi les acteurs de l’époque. Les violences policières contre les manifestants du quartier Latin bouleversent complètement l’attitude des étudiants. Une divergence d’appréciation apparaît sur le rôle des différentes organisations lors des débuts du mouvement. Selon P.Masson, membre du bureau de l’A.G.E.L. en 1968, le mouvement a débuté à Lyon ” par une réunion. C’était le 5 mai. Quelques jours seulement après le début de l’agitation à Paris. Le noyau dur de l’A.G.E.L. s’est retrouvé à la Doua. On a décidé de se mobiliser pour soutenir nos camarades parisiens et coordonner les actions sur Lyon. ” L’A.G.E.L. est donc présentée comme étant à l’origine du mouvement. Selon P.Maneval, trésorier de l’Amicale des Sciences en mai 1968, l’Amicale des Sciences a lancé le mouvement en Sciences et en Lettres, où les groupes gauchistes étaient incapables de mobiliser : ” C’est vraiment au moment des premiers tabassages au quartier Latin que les étudiants ont bougé. Et bon, et bien nous on a dit : il faut réagir. Sans idées préconçues là-dessus, il fallait protester, ne serait-ce que pour protester contre ce qui s’est passé. Et, au niveau de la Doua, cela n’a pas été sans peine. […] A tel point que […]les gauchistes ont été incapables de mettre en grève leurs amphis de Lettres. Ce sont des adhérents de l’Amicale des Sciences qui allaient intervenir dans les amphis de Lettres, pour que les étudiants se décident à venir à la manif.[…]Donc, on a mis en grève les amphis, on a organisé la première manif ” Il apparaît extrêmement difficile de déterminer les responsabilités de chacun dans le déclenchement du mouvement. Cependant, l’Amicale des Sciences semble avoir joué un rôle non-négligeable, puisque lors de la grève du 06.05.1968, 80 % des étudiants de sciences et de l’I.N.S.A. font grève, et seulement quelques cours supprimés en lettres. Le 7 mai, une manifestation, lancée à l’appel de l’U.N.E.F., de l’A.G.E.L. et de l’U.G.E., rassemble quelques milliers d’étudiants pour exiger la libération des étudiants arrêtés à Paris, la reprise des cours à la Sorbonne et pour protester contre la politique du gouvernement dans le domaine universitaire. Déjà, le mouvement se divise : l’Amicale des Sciences et l’A.G.E.L. s’opposent, adoptent des attitudes différentes ou s’ignorent volontairement : ” On était quand même entré en contact avec l’A.G.E.L. à ce moment là, de façon plus soutenue, pour savoir ce qu’ils comptaient faire. Bien que le courant passait très mal entre nous pour tout un tas de raisons. ” Au fur et à mesure des événements, les relations entre les deux acteurs se détériorent. Une sorte de concurrence naît entre les deux structures. Ainsi, le 9 mai, un meeting annoncé depuis quelques jours par l’Amicale des Sciences à 18h00 sur le campus de la Doua est doit se retrouver face à un autre meeting convoqué à 16h30 à l’I.N.S.A. par l’A.G.E.L. Meeting de l’A.G.E.L. qui ne se tient pas et est remplacé par une manifestation à la grande fureur de l’UD-C.G.T.. La rupture est petit à petit consommée : le 17 mai, dans un communiqué de presse, l’Amicale des Sciences U.N.E.F. et le S.N.E.Sup Sciences annoncent leur intention de ” ne plus se préoccuper de directives syndicales nationales tant que celle-ci n’émaneront pas d’instances statutairement et régulièrement réunies. “
Les événements de mai 1968 étalent au grand jour les antagonismes entre l’A.G.E.L. et des adhérents de l’U.N.E.F. (et donc de fait de l’A.G.E.L). De plus, mai 1968 fait naître chez certains adhérents, et en particulier chez ceux proches de l’U.E.C., une réflexion sur l’échec de mai : ” Le mouvement s’est enflé très vite, mais est redescendu très vite aussi. C’est là-dessus que s’accroche la pensée du renouveau de l’U.N.E.F. Elle s’accroche fortement là-dessus, c’est à dire en disant : voilà, vous avez vu, mai 68 n’a fait que traverser […] C’était l’argumentaire de l’époque pour la rénovation. Il tire la leçon du fait qu’il faut organiser le mouvement étudiant, puisque, s’il ne s’organise pas, il échoue. Mais il va beaucoup plus loin, il remonte dans l’histoire de l’U.N.E.F. […] , quand l’U.N.E.F. défendait les intérêts des étudiants […] En 68, il n’y a pas eu d’U.N.E.F. Et cela a dramatiquement manqué. On voit bien la correspondance avec les thèses politiques de l’époque : il a manqué […] , on dit du coté du P.C.F., un programme d’action pour les masses populaires […] , c’est à dire le programme commun. En correspondance avec ça, il y’avait l’idée qu’il a manqué un grand syndicat étudiant qui tienne la route et il faut le reconstruire. ” L’échec d’une véritable transformation de l’Université est imputé à l’absence d’un véritable syndicat étudiant, ce que l’U.N.E.F. a cessé d’être pour certains adhérents depuis le milieu des années 60. Par conséquent, une réflexion s’engage chez des adhérents, souvent proches de l’U.E.C. ou de la gauche non-communiste, sur les solutions à apporter pour remédier à la crise du syndicalisme étudiant. La loi Faure, issue du mouvement étudiant, et considérée par ces mêmes adhérents comme le seul acquis universitaire de mai, se greffe sur cette réflexion. Cependant, dés la rentrée universitaire 1968-1969, le B.N. rejette la participation, assimilée à une tentative d’intégration du mouvement étudiant à l’Etat.
C’est donc sur cette amorce de réflexion que s’ouvre la rentrée universitaire 1968-1969. Comme à chaque début d’année universitaire, l’Amicale des Sciences U.N.E.F. tient son Assemblée Générale. Elle marque l’apparition d’un nouvel acteur important dans la vie de l’U.N.E.F. : l’Alliance des Jeunes pour le Socialisme. Bien implantée au niveau national (elle contrôle deux A.G.E.), elle semble ne pas s’être investit jusque là dans l’U.N.E.F. à Lyon. Une nouvelle ligne de fracture s’ouvre alors entre les partisans et les détracteurs de la loi Faure. La création de l’U.N.E.F. –Renouveau en Sciences est alors engagée. Certes, elle n’a pas de structures, ne possède pas de nom, ni de ligne directrice à long terme… . Néanmoins, des adhérents jusque là dispersés se retrouvent autour de valeurs, d’idées, d’analyses. La loi Faure apparaît vraiment comme le catalyseur des divisions au sein de l’U.N.E.F. Les contours de chaque camp commencent à se dessiner, même s’ils demeurent encore flous.
L’échec de l’Assemblée Générale du 23.05.1969 et l’abandon de l’A.G.E.L.
A partir de la rentrée universitaire 1968-1969, l’U.N.E.F.–Renouveau prend forme, même si elle n’est encore qu’un vague rassemblement d’adhérents autour de quelques valeurs. Elle ne cesse cependant de s’affirmer et tente à plusieurs reprises de prendre la direction de l’A.G.E.L. Toutefois, l’échec de l’A.G. du 23.05.1969 signifie pour elle l’abandon de l’A.G.E.L.
La préparation du congrès de Marseille en décembre 1968 donne corps à l’U.N.E.F. –Renouveau. En effet, elle choque de nombreux adhérents de l’U.N.E.F. : le B.N. annonce sa tenue en novembre 1968, tandis que l’A.G.E.L., au 11.12.1968, n’a toujours pas convoqué d’A.G. ou de congrès. Le 18 décembre, une cinquantaine de militants se réunissent et lancent une campagne pour exiger la tenue d’une A.G. à Lyon et en faveur de la déclaration de l’A.G.E. de Lille.
Les élections universitaires, fixées pour février – mars 1969, sont l’occasion de donner un nom et une structure à l’U.N.E.F. – Renouveau. En effet, le 15 janvier 1969, les 8 A.G.E. animées par l’U.E.C. annoncent qu’elles présentent des listes aux élections aux conseils de gestion et créent des comités pour le renouveau de l’U.N.E.F. Le nom U.N.E.F.–Renouveau est alors celui des listes. Elles sont déposées dans quelques facultés : Sciences et Lettres. Des liaisons entre les différentes listes s’établissent et donnent une cohérence à l’ensemble. Le scrutin, qui se déroule entre le 13 février et le 24 mars 1969, suscite une forte participation de la part des étudiants : 57,6 % en Droit, 66,2 % en Médecine et Pharmacie, 54,4 % en Sciences, 47,1 % en Lettres et 69,7 % dans les unités sous dérogation . Au total, sur les 408 sièges prévus à Lyon, 371 sont effectivement attribués. Les résultats sont très encourageants pour l’U.N.E.F.–Renouveau. En effet, en dépit de ses faibles moyens et du handicap constitué par une organisation incomplète et récente, elle obtient sur l’ensemble des campus 16,5 % des suffrages (soit 1991 voix) et 19,9 % des sièges (74 sur 371). A titre d’exemple, la F.N.E.F., pourtant implantée de longue date, doit se contenter de 2,9 % des voix et de 2,1 % des sièges. De plus, l’U.N.E.F.–Renouveau ne présentait pas de listes dans tous les collèges et toutes les facultés. Droit, Médecine, Gestion, Institut du Travail, Physique Nucléaire, Etudes Italiennes et Néo-Latines, Etudes de l’Orient, Histoire de l’Art, IUT, IEP, IREPS ne rapportent aucune ou très peu de voix à l’U.N.E.F.–Renouveau. Les résultats de certaines U.E.R. témoignent par contre d’une réelle implantation, influence. Elle obtient 100 % des suffrages dans les U.E.R. de Mathématiques (382 voix sur 586 votants), de Biologie Dynamique (49 voix sur 71 votants), 71,6 % en Physique, 51,4 % en Chimie- Biochimie, 53,6 % en Sciences de la Nature, 51,6 % en Etudes Françaises, 63,0 % en Sciences Psychologiques, Sociologiques, Ethnographiques et Pédagogiques. L’U.N.E.F.-Renouveau dispose alors d’un réseau d’élus et surtout d’une légitimité tirée des urnes.
Durant cette période, elle se structure davantage : des sections syndicales (l’équivalent des C.A.) sont entièrement aux mains de l’U.N.E.F.-Renouveau comme à l’I.N.S.A. ou en Sciences, tandis que des comités pour le renouveau de l’U.N.E.F. sont fondés en Médecine et en Lettres. Jusqu’ici, l’U.N.E.F.-Renouveau, même si elle rompt plusieurs fois la discipline syndicale et prend ses distances avec l’A.G.E.L., n’est pas totalement indépendante, autonome. Ainsi, elle participe à l’Assemblée Générale du 23.05.1969 au siège de l’A.G.E.L. Elle exprime alors la volonté de faire fonctionner les instances régulières de l’U.N.E.F. et de l’A.G.E.L. Pour les Renseignements Généraux, l’A.G. ,convoquée par l’U.N.E.F.-Renouveau, a pour but de s’emparer du bureau. En effet, les E.S.U., bloqués au même moment au congrès de la M.N.E.F. ne participent pas aux débats… . L’A.J.S. bénéficie pour sa part du renfort de militants d’autres villes universitaires, et en particulier d’Anthony et de Aix- en- Provence. Trois à quatre cents militants se retrouvent vers 21 heures dans les locaux de l’A.G.E.L., rue F.Garçin. Mis en difficulté, F.Perronnet, président de l’A.G.E.L. parvient cependant à se dégager de ce mauvais pas, grâce à l’aide des E.S.U. enfin libérés du congrès de la M.N.E.F., dont la séance est, pour l’occasion, écourtée. Vers 23h30, la salle est évacuée au milieu des injures et des règlements de compte. La séance reprend une fois les cartes vérifiées. Une centaine de militants est ainsi écartée, tandis que des militants E.S.U. de différentes villes semblent pouvoir pénétrer librement dans la salle. Les débats reprennent au milieu des injures et, au petit matin, les responsables de l’A.G.E.L. affirment avoir obtenu l’exclusion des élus de l’U.N.E.F.-Renouveau. L’A.G. du 23.05.1969 est la dernière tentative de l’U.N.E.F.-Renouveau pour faire fonctionner les instances régulières. Son échec opère une modification de son attitude envers l’A.G.E.L. dans un sens plus radical. Elle abandonne désormais toute prétention sur l’A.G.E.L. et se rend indépendante de fait. Il existe alors deux U.N.E.F. à Lyon : l’A.G.E.L. affiliée à L’U.N.E.F. et l’U.N.E.F.-Renouveau.
La structuration de l’U.N.E.F.-Renouveau, organisation syndicale indépendante.
Après l’échec de l’A.G. du 23.03.1969, la structuration de l’U.N.E.F.-Renouveau progresse à nouveau et l’organisation syndicale devient progressivement indépendante. Au début, les différentes structures sont dispersées, multiples et sans liens entre elles : sections syndicales, comités pour le renouveau de l’U.N.E.F. Elles existent parallèlement aux C.A . et sont indépendantes de l’A.G.E.L. Ainsi, le comité pour le renouveau de l’U.N.E.F. de Lettres compte une centaine d’adhérents et dispose de sa propre propagande : tableau d’affichage, journal à diffusion restreinte. Des comités se créent en avril 1969 en droit et en sciences économiques et intègrent quelques membres d’Université 70 et des anciens adhérents du C.A. En septembre 1969, un nouveau pas est franchi dans la structuration de l’organisation. Une structure confédérale chapeaute désormais les associations de base au niveau de l’A.G.E. : le collectif des comités de Lyon de l’U.N.E.F. pour son renouveau. Dirigé par P.Maneval et N.Chambon, il se veut un ” gouvernement parallèle ” à l’A.G.E.L. et s’inscrit dans la suite logique de l’évolution de l’U.N.E.F.-Renouveau. Des représentants de chaque comité ou section syndicale siègent au collectif. L’U.N.E.F.-Renouveau est alors un syndicat indépendant de l’A.G.E.L. : elle a ses propres structures, son propre mode de fonctionnement interne. Lors du congrès d’Orléans, elle envoie sa propre délégation composée de trois adhérents. Ils assistent aux travaux du congrés, peut-être en concurrence avec la délégation de l’A.G.E.L..
Mais surtout, l’U.N.E.F.-Renouveau conduit ses propres actions et fait preuve d’une activité débordante. Des diffusions de tracts ont lieu dans la plupart des universités pour informer les étudiants sur l’U.N.E.F.-Renouveau, sur les différentes réformes comme les CFPM. Elle participe pleinement au mouvement étudiant de janvier – février 1970 dans les facultés lyonnaises, même si durant tout le conflit, elle s’oppose à la fois à l’A.G.E.L. et aux groupes gauchistes. L’A.G.E.L. prône, en particulier en lettres, la grève illimitée. Le 26.01.1970, lors d’une A.G. en Histoire – Géographie, l’U.N.E.F.-Renouveau s’oppose à la grève ou accepte l’éventualité d’une grève limitée et votée démocratiquement dans les amphithéâtres. Les différentes A.G. mettent aux prises l’U.N.E.F.-Renouveau avec les militants de Front – Uni, de l’AJS, de la gauche prolétarienne. En mars 1970, elle mène seule une campagne contre la sélection en médecine, contre la sélection et le démantèlement de l’U.E.R. en sciences économiques et pour le retrait de la circulaire Guichard sur les langues en lettres. A l’I.N.S.A., elle organise un référendum sur son projet de réforme des structures de l’établissement.
L’U.N.E.F.-Renouveau, à partir de mai 1969, devient de fait une organisation syndicale indépendante de l’A.G.E.L. : elle possède ses propres structures, développe ses propres analyses et actions. Cependant, de par sa participation aux congrès nationaux, elle affirme son attachement à l’U.N.E.F..
La création de l’A.G.E.L.-U.N.E.F., mai 1971.
La période du renouveau connaît sa concrétisation avec, au niveau national, le congrès de l’U.N.E.F à Paris, et , au niveau de Lyon, par la fondation de l’A.G.E.L-U.N.E.F en 1971.
Depuis son échec à l’Assemblée Générale de mai 1969, l’U.N.E.F-Renouveau se structure toujours davantage. En septembre 1969, elle se dote d’un ” collectif des comités U.N.E.F. pour son renouveau “, qui rassemble toutes les structures de l’U.N.E.F-Renouveau à Lyon. La démission du Bureau National P.S.U. le 10 janvier 1971 accélère brutalement le cours des événements.
Contrairement au niveau national où le P.S.U. se retire totalement de l’U.N.E.F en laissant face à face les deux tendances Unité Syndicale et Renouveau, le P.S.U. et les E.S.U. lyonnais décident de conserver le contrôle de l’A.G.E.L. En février 1971, à l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux fournis par la municipalité lyonnaise rue Richerand, l’A.G.E.L. annonce qu’elle rompt ses relations avec l’U.N.E.F. Elle prend prétexte de la nouvelle situation de l’U.N.E.F : démission du B.N, affrontement entre deux tendances… . L’U.N.E.F. n’est plus, pour l’A.G.E.L., ” l’organisation représentative et progressiste des étudiants “. Face à cette nouvelle situation, l’A.G.E.L. affirme vouloir garder, perdurer la tradition du mouvement étudiant issue du congrès de Grenoble en 1946… .
Dans le même temps, la situation au niveau des U.E.R. et universités devient extrêmement confuse. En effet, les deux tendances de l’U.N.E.F. tiennent des congrès séparés en février et mars 1971, à Dijon pour l’U.N.E.F-Unité Syndicale, à Paris pour l’U.N.E.F-Renouveau. La préparation des congrès est marquée par la création d’une multitude de nouveaux C.A. (phénomène déjà engagé en décembre 1969), tandis que l’U.N.E.F-Renouveau annonce en février 1971 dans plusieurs communiqués de presse ” la rénovation de C.A. “. Un communiqué de presse envoyé au Progrès le 16 février 1971 déclare : ” Les adhérents U.N.E.F. de la faculté de Droit/Sciences Economiques de Lyon, réunis en A.G. le 12 février ont décidé à l’unanimité de rénover le C.A U.N.E.F.. […]. Ceci démontre que la volonté des étudiants de recréer un syndicat de masse seul capable de lutter pour défendre les intérêts des étudiants et pour une Université démocratique n’est pas un vain mot “. En réalité , chacun est désormais chez soi et les réunions ne rassemblent pas l’ensemble des adhérents de l’U.N.E.F.. La création de C.A. U.N.E.F. par l’U.N.E.F-Renouveau se fait dans le contexte de la convocation d’une A.G. extraordinaire des présidents de C.A. à Paris le 14 février par l’U.N.E.F-Renouveau, A.G. qui décide de tenir le congrès de l’U.N.E.F. à Paris au mois de mars 1971. Il est donc nécessaire pour l’U.N.E.F-Renouveau de rassembler le maximum de C.A., gage de légitimité du congrès.
Dans ce contexte, rupture des relations entre A.G.E.L. et U.N.E.F. et préparation du congrès de l’U.N.E.F-Renouveau en mars 1971, l’U.N.E.F-Renouveau de Lyon récupère à son profit le nom A.G.E.L.. Cependant, étant donné que l’A.G.E.L. est toujours détenue par le P.S.U., elle prend le nom d’A.G.E.L-U.N.E.F, le tiret faisant toute la différence. Son premier congrès se tient à l’I.N.S.A. les 19 et 20 mai 1971 et marque l’aboutissement, la concrétisation du renouveau à Lyon. Il rassemble de nombreux C.A. (Lettres, Droit, Architecture, Conservatoire de Musique, Sciences Economiques, Sciences, I.N.S.A., Centrale, Etudes paramédicales, Médecine, Prépas) et obtient la légitimité de diverses organisations politiques ou syndicales : UD-C.G.T., U.N.C.A.L., Mouvement de la Paix, U.E.C.F., G.U.P.S., U.E.U.F., représentants des étudiants khmers.
——————————————————————————–
III. Une fondation sur des bases syndicales et sur l’acceptation de la cogestion.
La mise en place d’un programme syndical.
La mise en place d’un programme syndical répond à l’essence, à la définition même d’un syndicat, c’est à dire la défense d’intérêts communs à une catégorie. Il se compose d’un certain nombre de revendications, qui portent essentiellement sur la défense des intérêts des étudiants. Il s’inscrit tout d’abord dans le cadre de la défense des acquis de mai 1968.
La défense des acquis de mai 1968.
Elle s’appuie essentiellement sur deux revendications : l’application des réformes et la mise en place de l’autonomie des universités. La loi Faure, concédée par le gouvernement à l’issue du mouvement de mai 1968, s’attache avant tout à reconstruire l’édifice universitaire au moyen d’un certain nombre de réformes structurelles. Mais elle prévoit aussi des mesures visant à améliorer les conditions d’études : création de postes, octroi d’heures supplémentaires, mise en place d’universités ” expérimentales “… . L’application des réformes nécessite des moyens budgétaires importants, d’où la revendication de l’U.N.E.F.-Renouveau d’une augmentation du budget de l’Enseignement Supérieur.
Le deuxième acquis de mai 1968 à défendre est, hormis la cogestion, le principe de l’autonomie pédagogique des universités. Cette autonomie, accordée par la loi Faure, demeure très restreinte en raison de l’organisation très centralisée de l’Etat. En effet, le Ministère de l’Education Nationale continue à définir les programmes des études pour les diplômes nationaux et les modalités de leur sanction. Au maintien des acquis de mai, valeur nationale des diplômes, abandon provisoire de l’idée de sélection, l’U.N.E.F.-Renouveau élargit la notion d’autonomie pour revendiquer la mise en place de conseils d’orientation composés d’étudiants et d’enseignants, la création d’un contrôle continu, l’objectivité des cours et le droit à la critique.
Autonomie pédagogique accrue des universités tout en maintenant le cadre de la valeur nationale des diplômes, ce qui peut apparaître comme paradoxal, augmentation du budget et des moyens alloués à l’Enseignement Supérieur, droit de regard des étudiants sur le contenu des cours, l’U.N.E.F.-Renouveau reprend ainsi à son compte ” l’esprit de mai ” à travers ses revendications. Syndicat réformiste, elle défend ainsi les idées, modérées, d’un mouvement où les courants de pensée qui la nourrissent (en particulier les communistes) ont tenu une place marginale et à contre-courant.
Améliorer les conditions de vie et d’études des étudiants.
L’amélioration des conditions de vie et d’étude est une préoccupation et une revendication constante de l’U.N.E.F-Renouveau, puis de l’U.N.E.F.. La prise en charge des revendications matérielles, et donc profondément corporatistes, n’est pas une nouveauté pour l’U.N.E.F.. Ainsi, en 1958, elle mobilise les étudiants pour exiger la construction de locaux et pour la revalorisation des bourses. Ce sont donc des revendications catégorielles, puisqu’elles ne concernent que les étudiants.
Sur les questions concernant les conditions d’étude des étudiants, les positions de l’U.N.E.F-Renouveau ne marquent pas de rupture par rapport aux années précédentes. En fait, la différence avec le B.N. P.S.U. se fait sur l’ordre des priorités. Là où l’U.N.E.F-Renouveau considère les revendications matérielles comme le but premier d’un syndicat étudiant, les autres tendances, et en particulier le P.S.U., mettent en avant les problèmes politiques. Par exemple, le journal Etudiant de France, dans son numéro de mai 1969, aborde le problème des examens, mais le reste est consacré à des questions politiques : l’U.D.R., la guerre du Vietnam, l’Espagne, la lutte contre le fascisme et l’impérialisme. La ligne, l’orientation syndicale de l’U.N.E.F-Renouveau, centrée autour de revendications concrètes, est profondément rejetée par les autres tendances. Tout le mépris envers cette orientation se concrétise, s’exprime dans le slogan chanté par les gauchistes à chaque manifestation de l’U.N.E.F-Renouveau : ” Des gommes, des crayons, et demain la révolution “.
Les revendications de l’U.N.E.F-Renouveau demeurent assez traditionnelles. Elles s’articulent autour de deux domaines : le domaine pédagogique et le contrôle des connaissances.
Dans le domaine pédagogique, l’U.N.E.F-Renouveau s’engage très nettement en faveur de la pluridisciplinarité des études. Elle s’inscrit ainsi dans l’avant mai 1968, période durant laquelle de nombreux débats ont eu lieu autour du thème de la pluridisciplinarité. Ainsi, elle est au centre des débats du colloque de Caen en 1966. Imposée par la loi Faure de 1968 dont elle est un maitre-mot, elle ne reste pourtant souvent qu’un vœu pieux et son application est aléatoire suivant les facultés. Outre la pluridisciplinarité, l’U.N.E.F-Renouveau revendique le maintien de la valeur nationale des diplômes, la priorité des T.D. sur les C.M. dans les heures d’enseignement et le droit à la critique et à l’objectivité des cours. Le droit à la critique des cours est en particulier formulée dans les filières de Droit et de Sciences Economiques. Elle se concrétise sur le terrain par l’organisation de conférences, et ce, bien après la période du renouveau. Ainsi, en mars 1978, l’A.G.E.L.-U.N.E.F organise à Lyon III une conférence sur ” le droit tel qu’on nous l’enseigne “. L’autre grande préoccupation de l’U.N.E.F-Renouveau concerne le contrôle des connaissances. La réforme du contrôle des connaissances, revendication déjà ancienne, surgit brutalement au milieu du mouvement de mai avec l’approche des dates des examens. En effet, les étudiants débattent longuement dans les Assemblées Générales du boycott ou non des examens. A Lyon, de multiples A.G. (Lettres, Psychologie, Anglais, Histoire-Géographie…) votent le ” boycott des examens dans leur forme traditionnelle “. Le refus des examens s’accompagne de deux revendications : la création de commissions paritaires pour établir les modalités de sanction de l’année universitaire 1967-1968 et une réforme totale du système universitaire. Cependant, les positions sont extrêmement diverses et des étudiants prônent la disparition pure et simple des examens. Les revendications de l’U.N.E.F-Renouveau, en ce qui concerne le contrôle des connaissances, demeurent modérées. Favorable au maintien d’examens d’ensemble, elle demande simplement l’introduction du contrôle continu des connaissances. Les revendications de l’U.N.E.F-Renouveau, dans le domaine pédagogique et sur le contrôle des connaissances, reprennent certaines préoccupations et mots d’ordre du mouvement de mai. L’amélioration des conditions d’étude passe aussi par la création de postes de professeurs, de nouveaux bâtiments… .
Les revendications concernant l’amélioration des conditions de vie des étudiants partent toutes d’un présupposé : le refus de la sélection sociale. L’U.N.E.F-Renouveau souhaite en finir avec ” l’Université bourgeoise “, qui sélectionne les étudiants en fonction de leur origine sociale. Par conséquent, elle lutte pour la ” démocratisation de l’Université ” et porte un certain nombre de revendications : la gratuité de l’Enseignement Supérieur, le développement des œuvres universitaires et l’Allocation d’études. L’Allocation d’études est un projet déjà ancien de l’U.N.E.F.. En effet, lors du congrès de Grenoble de 1946, l’élaboration de la ” Charte de l’étudiant ” définissant celui-ci comme un ” jeune travailleur intellectuel ” entraîne simultanément la création du projet d’Allocation d’études adopté définitivement au congrès d’Arcachon. Plusieurs fois modifié, il est progressivement abandonné par l’U.N.E.F. au cours des années 60. L’U.N.E.F-Renouveau reprend l ‘Allocation d’études à son compte et lui assigne trois objectifs : mettre un terme au salariat étudiant, donner à tous les étudiants les mêmes chances de réussite quel que soit son milieu d’origine sociale et permettre à tous les jeunes d’accéder à l’Université. Cependant, les critères d’attribution sont profondément remaniés. Si, dans le projet de loi de 1951, l’Allocation d’études s’applique à tous les étudiants sans distinctions, la revendication de l’U.N.E.F-Renouveau assortit l’obtention de l’Allocation d’études de critères différents : critères sociaux en premier cycle, critères sociaux et universitaires en second cycle et critères universitaires en troisième cycle. Versée douze mois douze, indexée au coût de la vie et d’un montant suffisant pour vivre sans autres ressources, elle vise avant tout à supprimer le salariat étudiant. Des allocations complémentaires existent et son financement est élaboré dans le projet de loi de l’U.N.E.F.. L’allocation d’études constitue la revendication centrale de l’U.N.E.F-Renouveau en matière d’aide sociale.
Défendre les libertés politiques et syndicales.
La défense des libertés politiques et syndicales à l’Université est une préoccupation constante de l’U.N.E.F-Renouveau. Jusqu’en 1968, les organisations dites ” représentatives des étudiants ” par l’Etat sont celles qui siègent au Centre National des Œuvres. Ainsi, lors de la scission de la F.N.E.F. en 1961, le gouvernement De Gaulle/Debré attribue trois sièges à la nouvelle organisation au détriment de l’U.N.E.F.. Les activités politiques et syndicales sont alors tolérées, mais demeurent, en théorie, interdites. Le mouvement de mai 1968 entraîne une évolution. La mise en place de la cogestion entraîne de fait la reconnaissance des organisations étudiantes. Mais aucun cadre légal ne fixe les libertés syndicales ou politiques. L’attitude de l’administration, qui tolère plus ou moins bien les activités syndicales, est primordiale. L’exercice des libertés politiques et syndicales à l’Université n’est reconnu qu’en… 1984 avec l’article 50 de la loi Savary.
La défense des libertés politiques et syndicales garde donc après 1968 toute son actualité. A cette revendication s’ajoutent le rejet de toute ingérence policière à l’Université et le maintien des franchises universitaires
Une conception des luttes.
L’U.N.E.F.-Renouveau développe aussi une conception des luttes, portant à la fois sur la forme et sur le fond.
Elle s’appuie avant tout sur une distinction des objectifs des luttes, de leur portée. En effet, deux ” types ” de luttes sont distinguées, apparaissent : les luttes immédiates et les luttes générales.
Les luttes immédiates sont considérées comme catégorielles. En effet, leurs objectifs sont essentiellement universitaires et les acteurs sont les étudiants. Pour aboutir, elles doivent obtenir le soutien de l’ensemble des étudiants, c’est à dire engager la masse des étudiants dans l’action. La conception de ” lutte de masse ” est indissociable de celle de lutte immédiate. La ” lutte de masse ” implique la sensibilisation des étudiants aux problèmes, puis leur implication dans le mouvement. Elle affirme donc l’existence d’intérêts communs aux étudiants et la possibilité d’une élaboration de revendications communes partagées par les étudiants aux delà des divergences politiques. Ces revendications ne peuvent donc qu’être universitaires, sans préalable politique. Pour l’U.N.E.F.-Renouveau, une situation commune donne donc une base à des intérêts communs, à des luttes. Toutefois, ces luttes ne sont pas exemptes de dangers et, en particulier, du ” réformisme ” et de l’absence de perspectives globales.
Afin d’éviter ces écueils, l’U.N.E.F.-Renouveau distingue un deuxième type de luttes : les ” luttes générales, politiques “. Menées en collaboration avec les autres couches de la société, elles visent à faire aboutir des revendications de fond, comme, par exemple, ” la démocratisation de l’enseignement à tous les niveaux “. Elles nécessitent la recherche de l’unité d’action avec les syndicats enseignants ou ouvriers, comme le S.N.E.Sup. ou la C.G.T.. Toutefois, les luttes générales s’inscrivent dans un cadre précis et restreint, puisque l’U.N.E.F.-Renouveau dénonce ” l’utopie “, ” les luttes […] purement idéologiques “, sans débouché concret dans le monde universitaire. Il s’agit avant tout d’éviter le gauchisme et de se couper des étudiants.
Contrairement aux apparences, ces deux types de luttes ne s’opposent pas, ne sont pas contradictoires. Au contraire, les luttes immédiates peuvent déboucher sur des luttes ” générales “. En effet, l’existence d’une situation reconnue d’intérêts convergents, de luttes communes peuvent engendrer une prise de conscience des étudiants d’une situation plus large. Cette évolution dépasse les cadres étroits des luttes immédiates en direction des luttes générales, plus politiques.
Outre cette distinction, l’U.N.E.F. –Renouveau prône la démocratie des luttes et, en particulier, la démocratie directe : toute action revendicative doit être déterminée dans chaque amphi ou T.D.. Elle tente ainsi de s’opposer aux méthodes des groupes gauchistes : A.G. d’étudiants, comités de grève… . Ces structures sont rejetées, car jugées antidémocratiques, non-représentatives. Souvent contrôlées par les groupes gauchistes, elles offrent peu de liberté d’expression aux adhérents de l’U.N.E.F.-Renouveau. Les structures traditionnelles du mouvement étudiant sont donc rejetées.
La distinction, théorique, entre ” luttes immédiates ” et ” luttes générales ” permet à l’U.N.E.F.-Renouveau de se procurer un espace de liberté et de manœuvre entre le corporatisme, le réformisme et les visées révolutionnaires des groupes gauchistes.
La cogestion.
Enfin, la fondation de l’U.N.E.F.-Renouveau se fait sur un dernier point : la cogestion, c’est à dire la participation de l’U.N.E.F. aux élections universitaires et aux différents conseils des universités et facultés.
Une loi issue de mai 1968.
La cogestion est instaurée par la loi d’orientation de novembre 1968. Il s’agit donc d’une loi issue de mai 1968. En effet, elle répond à un certain nombre de revendications portées par le mouvement de mai 1968 : ” autonomie “, ” cogestion “. Cependant, une ambiguïté, une confusion des mots d’ordre s’est établie pendant mai 68 et après. Un fossé important sépare la revendication ” réformiste ” de cogestion et celle, contestataire et révolutionnaire, de ” pouvoir étudiant “. La loi d’orientation ou loi Faure ne peut dés lors faire l’unanimité des acteurs de mai 68, car née d’une équivoque.
Votée en octobre et novembre 1968 par l’Assemblée Nationale et le Sénat, la loi d’orientation a pour rôle essentiel de remettre en marche un système universitaire profondément déstabilisé, paralysé et décrédibilisé par la crise universitaire de mai 1968. A la suite des revendications portées par le mouvement de mai 1968, un volet de la loi est consacré à la participation ou cogestion. Outre la participation de tous les personnels à la gestion des universités, elle prévoit la présence active de délégués étudiants aux différents conseils avec les mêmes droits que les représentants enseignants et non- enseignants. Cette innovation est importante, puisqu’elle modifie et implique de nouvelles relations sociales entre étudiants, enseignants et personnels. La loi concède aussi une extension du pouvoir des conseils à travers un certain nombre de dispositions. Ainsi, elle prévoit la création d’une catégorie d’établissements publics dirigés par des conseils composés majoritairement de représentants des personnels et d’ usagers. Les conseils, surtout d’université, possèdent de nombreuses attributions : ils interviennent dans le domaine institutionnel, pédagogique, administratif et financier. Ainsi, les conseils déterminent, dans un cadre législatif fixé par l’Etat, les statuts de l’université, les structures internes (nombre d’U.E.R.). Ils peuvent aussi débattre et décider des relations avec les autres établissements, du contenu des programmes, méthodes, des modalités d’examen, des problèmes administratifs concernant la vie de l’université (contrats, constructions…), de l’élaboration, du vote et du contrôle du budget… . La loi d’orientation donne donc aux différents conseils, et en particulier au conseil d’université, de nombreuses prérogatives et un pouvoir décisionnel important. Le président d’université, élu par le conseil d’université, posséde le pouvoir exécutif, puisqu’il applique les décisions du conseil d’université.
La nouvelle loi va donc plus loin que l’ancienne revendication de l’U.N.E.F. En effet, l’U.N.E.F. milite depuis plusieurs années pour la participation des étudiants avec des compétences élargies dans les différentes institutions et conseils des universités. Cependant, elle ne demande alors qu’une participation à titre consultatif… . Ainsi, en mars 1963, la F.G.E.L. – U.N.E.F. demande la participation de deux de ses membres à l’assemblée de faculté avec voix consultative. De plus, l’U.N.E.F. s’oppose alors au principe d’élections étudiantes libres au nom de l’unicité de la représentation étudiante.
Imposée aux ” mandarins ” et aux professeurs conservateurs hostiles à l’émancipation des maîtres-assistants, la réussite de la cogestion, et donc de la loi d’orientation, dépend surtout de la réussite de cette greffe sur le monde étudiant. En effet, sans engagement massif des étudiants dans la gestion, la participation perd toute crédibilité et remet en cause l’édifice universitaire issu de la loi d’orientation.
Pour juger de la réussite ou non de ce pari, il faut s’intéresser de prés à l’évolution sur une longue période (1969-1993) de la participation étudiante aux différents scrutins universitaires.
L’élection des délégués, puis élus, étudiants a pris différentes formes depuis 1968. De 1969 à 1984, les étudiants aux conseils d’U.E.R. sont élus au suffrage universel direct, c’est à dire par l’ensemble des étudiants. En général, le scrutin se déroule sur une seule journée et les sièges sont répartis à la proportionnelle avec une prime au vainqueur. L’étalement du scrutin sur une seule journée n’encourage pas la participation massive des étudiants (nombreux sont les étudiants n’ayant cours que quelques jours) et certaines universités ou facultés se font gloire d’atteindre des taux d’abstention records. Pour le conseil d’université, le suffrage universel indirect est mis en place : les élus d’U.E.R. élisent parmi eux les élus étudiants au conseil d’université. Une interruption des élections a lieu entre 1984 et 1986 après le vote de la nouvelle loi d’orientation, dite loi Savary. En effet, les universités devant adapter leurs statuts gardent provisoirement les conseils précédemment élus. De 1986 à 1994, tous les élus étudiants, aux conseils d’U.F.R. et aux conseils centraux (Conseil d’Administration, Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, Conseil Scientifique), sont élus au suffrage universel direct. Devant les taux de participation dérisoires, des universités tentent de provoquer au sein du milieu étudiant un regain de citoyenneté, une prise de conscience, en allongeant la durée du scrutin sur deux jours ou en favorisant l’information, la publicité des élections.
La participation des étudiants connaît, de 1969 à 1994, une évolution différenciée selon les disciplines, même si, sur le long terme, une désaffection croissante apparaît nettement. On peut différencier deux évolutions différentes : les Sciences exactes et les Sciences humaines et sociales d’un coté, le Droit et la Médecine de l’autre.
Les Sciences exactes et les Sciences humaines et sociales connaissent une évolution rapide vers une indifférence quasi-générale. En effet, les élections universitaires de 1969 montrent un incontestable intérêt des étudiants. Les taux de participation sont alors très importants : près de 50 % au niveau national. A Lyon, la participation est assez massive : 49,7 % à l’université Lyon II, 44,59 % pour l’U.E.R. de Mathématiques, 50,23 % en Physique, 55,1 % en Chimie et Biochimie, 73,09 % en Sciences de la Nature, 57,25 % en Biologie dynamique, 55,55 % en Physique nucléaire. Toutefois, les taux de participation décroissent rapidement et laissent la place à un désintérêt profond et massif de la part des étudiants. Ainsi, dés 1970, le taux de participation tombe à 25,6 % à l’université Lyon II. Il demeure par la suite systématiquement inférieur à 20 %, quand ce n’est pas moins. En 1992, la participation à l’élection de l’U.E.R. de Lettres à Lyon II devient pratiquement nulle : 2,7 % des étudiants se sont déplacés pour aller voter !. La désaffection des étudiants de Sciences Humaines et Sociales et de Sciences Exactes apparaît durable et profondément ancrée : les divers mouvements étudiants ne provoquent pas de sursauts de citoyenneté étudiante ou d’intérêt pour les élections. Ainsi, en février 1974, seuls 13,4 % des étudiants se rendent aux urnes lors des élections d’U.E.R. à Lyon II. Quelques mois auparavant se déroulait le mouvement contre la suppression des sursis étudiants et contre la création du D.E.U.G… . De multiples raisons peuvent expliquer cette profonde désaffection : absence ” d’esprit de corps ” chez les étudiants de ces filières (faible intégration à l’université, absence de vie étudiante dans des campus isolés et excentrés, faible perception des enjeux, indifférence du milieu étudiant, présence réduite des élus étudiants au sein des divers conseils…) . L’influence des mouvements gauchistes prônant le boycott et refusant la participation ne semble pas jouer un rôle essentiel. Il n’est certes pas possible de mesurer l’impact de ces mouvements lorsqu’ils prônent le boycott. Cependant, il est possible d’observer, d’évaluer les conséquences d’un changement d’attitude. Or, au début des années 80, l’U.N.E.F-ID décide de participer aux élections universitaires. Cette décision n’engendre pas d’augmentation systématique des taux de participation. Ainsi, l’U.E.R. de Lettres de Lyon II enregistre un taux de participation de 7,7 % en janvier 1982 et de 7,12 % en décembre 1982, alors que l’U.N.E.F-ID passe, dans le même temps, de 0 à 7 élus sur 10.
L’évolution est très différente pour les filières de Droit et de Médecine. La participation des étudiants est, certes, minoritaire, mais elle demeure importante avec un taux régulièrement supérieur à 30 % Jusqu’en 1984. L’U.E.R. de Médecine de Lyon-Nord est une bonne illustration : le taux de participation est, hormis en janvier 1981, supérieur à 30 % : 34,8 % en novembre 1972, 41,8 en décembre 1974, 69,5 % en décembre 1976, 33,5 % en décembre 1977, 60,0 % en décembre 1979, 20,7 % en janvier 1981, 42,2 % en décembre 1982 et 51,0 % en janvier 1984. En Droit, la participation demeure importante, mais d’un moindre niveau : autour de 30 %. Cependant, elle devient beaucoup plus faible et aléatoire à la fin des années 80 et au début des années 90. A cette participation soutenue s’ajoutent les effets des mouvements étudiants. En effet, ils peuvent entraîner ponctuellement des regains de participation. La corrélation est particulièrement forte en Médecine lors des mouvements d’octobre 1975 et d’avril 1979, suivis tous deux de fortes hausses de la participation. Ainsi, le taux de participation à l’U.E.R. de Médecine Lyon-Nord passe de 33,0 % en décembre 1978 à 60,0 % en décembre 1979. La plus forte participation des étudiants de Médecine et de Droit s’explique par une situation souvent opposée à celle des facultés de Sciences Exactes ou de Sciences Humaines et Sociales. En effet, une forte cohésion entre les étudiants s’est maintenue au fil des années : les traditions ” folkloriques ” perdurent, des associations étudiantes à vocation corporatiste sont fermement implantées (ANEPF, CCEML, ACEML, AAEPL, AAPL, Corpo Lyon III), les effectifs sont réduits une fois passé l’obstacle du numerus clausus ou du premier cycle, l’intégration à l’Université est forte, une relative satisfaction à l’égard de l’Institution existe, le milieu étudiant est très structuré, les inquiétudes sur l’avenir sont faibles et la professionnalisation forte… . Tous ces facteurs favorisent un taux de participation des étudiants aux élections universitaires plus élevé.
Une évolution différente selon les disciplines apparaît : l’indifférence gagne vite les étudiants de Sciences Exactes ou de Sciences Humaines et Sociales, tandis que le Droit et la Médecine résistent plus longtemps. Cependant, une tendance de fond à une désaffection des étudiants vis à vis des différents scrutins universitaires se fait jour. Elle est accentuée par l’attitude de l’administration, (peu encline souvent à faire de la publicité pour les élections…) et par l’instauration de diverses mesures visant à réduire la représentation étudiante au sein des conseils. La cogestion s’avère donc, en ce qui concerne la participation des étudiants, un échec, puisqu’elle ne réussit pas à regrouper derrière elle la masse des étudiants. Une étude sur la participation qualitative des élus étudiants à la gestion de l’Université et des facultés serait sans doute beaucoup plus nuancée.
La cogestion érigée comme ” instrument des luttes revendicatives “.
En refusant de suivre la position adoptée par l’U.N.E.F. au congrès de Marseille, l’U.N.E.F.-Renouveau développe sur la cogestion une analyse originale au sein du mouvement étudiant. Ni collaboration avec l’administration, ni simple acte de représentation des étudiants, la cogestion est érigée comme un ” instrument des luttes revendicatives “.
En effet, la participation est jugée utile aux étudiants. La cogestion n’est pas vécue comme une résignation, un simple acte de présence. Au contraire, elle est action, lutte. Elle est jugée utile aux étudiants pour différentes raisons. Elle offre aux étudiants la possibilité d’obtenir des informations. Elus à part entière, les délégués étudiants ont accès à tous les documents rendus publics pendant les conseils. Mais surtout, la cogestion ou participation est considérée comme un instant de lutte. L’U.N.E.F.-Renouveau affirme la possibilité d’obtenir de nouveaux droits et de lutter contre les réformes néfastes dans les conseils. Ainsi, en février 1969, l’U.N.E.F.-Renouveau compte sur les conseils afin de lutter contre les aspects négatifs de la loi d’orientation et de définir ou éclaircir certains aspects imprécis.
Toutefois, la cogestion n’est pas considérée comme un moyen de lutte à part entière. L’utilisation de la cogestion par l’U.N.E.F.-Renouveau se fait dans une démarche précise. Elle devient acceptable et utilisable si des conditions particulières sont réunies. Ainsi, la corrélation est établie entre cogestion/lutte syndicale/création d’un ” véritable syndicat “. Pour l’U.N.E.F.-Renouveau, une corrélation doit s’établir entre l’action des élus dans les conseils (vote, motion…), la mobilisation des étudiants afin de soutenir l’action des élus (occupation de la salle du conseil, pétitions…), et le relais des ces actions dans les autres conseils et au niveau national. La cogestion devient un ” instrument des luttes revendicatives ” si ces 3 actions sont menées. Ainsi, l’U.N.E.F-Renouveau affirme la possibilité de luttes à partir des conseils des universités. Cette position apparaît alors comme originale, à la fois éloignée des corpos et de l’U.N.E.F., puis de l’U.N.E.F.-Unité Syndicale.
c. Le rejet du boycott.
Composante de l’U.N.E.F., la tendance Renouveau prône une position radicalement opposée à l’analyse de la cogestion développée et adoptée par l’U.N.E.F. au congrès de Marseille, c’est à dire le boycott des élections universitaires.
En effet, dés la parution de la loi Faure à la fin de l’année 1968, le B.N. et le C.N. rejettent la participation aux élections universitaires et appellent au boycott. Cette position, soutenue conjointement par le P.S.U. et l’A.J.S., est réaffirmée au congrès de Marseille en décembre 1968. A la participation, considérée comme une intégration du mouvement étudiant à l’Etat, l’U.N.E.F. oppose le contrôle du système universitaire par le mouvement étudiant en lutte. Les formes de ce contrôle ne sont toutefois pas précisées. En effet, l’U.N.E.F., étant donné son état de faiblesse, est dans l’incapacité de tenir ce rôle, tandis que la mobilisation étudiante (dont l’expression la plus visible est l’A.G.) ne dure que quelques jours ou semaines et demeure trop éphémère. Après la scission de 1971, cette analyse est partiellement reprise par l’U.N.E.F.-Unité Syndicale.
Cette analyse est rejetée par l’U.N.E.F.-Renouveau, même si un consensus s’établit sur la volonté de l’Etat d’intégrer le mouvement étudiant par l’intermédiaire de la cogestion. Le boycott n’est pas repoussé d’emblée par l’U.N.E.F.-Renouveau. Bien au contraire, il est considéré comme un moyen d’action acceptable, une ” méthode bonne “, si il vise à court terme la destruction des institutions universitaires.Mais le contexte n’est plus jugé comme favorable : le mouvement étudiant est désormais divisé, des acquis ont été obtenus après mai 1968… . Le boycott apparaît dés lors pour l’U.N.E.F.-Renouveau comme une ” absurdité “, puisqu’elle laisse les mains libres au gouvernement pour remettre en cause les acquis dans les conseils.
La participation aux élections universitaires est donc un pilier de la reconstruction de l’U.N.E.F., la cogestion devient un des piliers de l’action syndicale. Concluant à l’inverse du PSU et de l’extrême-gauche, l’U.N.E.F.-Renouveau rejette le boycott et affirme le rôle des conseils dans les luttes. Cette analyse se rapproche de celle des grandes centrales syndicales ouvrières et va constituer pendant 13 ans la ligne de scission ” officielle “, puis de séparation entre les deux branches concurrentes issues de l’U.N.E.F..
——————————————————————————–
Résumé :
La scission de l’U.N.E.F a donc deux réalités : une nationale et une locale. Au niveau national, la scission de l’U.N.E.F est vécue comme une lutte interne, entre tendances dirigées par des appareils politiques, c’est à dire l’U.E.C, l’A.J.S et le P.S.U. La situation de l’U.N.E.F. est, depuis 1963, celle d’une organisation en crise : le nombre de ses adhérents et de ses implantations diminue, les finances sont exsangues et le projet syndical en ruine… . Pourtant, l’U.N.E.F. devient un enjeu pour les partis politiques et leurs organisations de jeunesse. En effet, avec la normalisation des organisations de jeunesse comme l’U.E.C. au milieu des années 60, les débats politiques ne peuvent plus se mener dans ses structures et de déplacent vers le seul lieu de confrontation possible : l’U.N.E.F.. L’après-mai 68 est très difficile pour l’U.N.E.F., puisqu’elle échoue dans sa tentative de recomposition du mouvement étudiant et connaît une exacerbation sans précédent de ses tensions internes avec l’adoption et l’élaboration de la loi Faure. Les opposants et partisans de la cogestion s’affrontent longuement et créent une nouvelle ligne de fracture au sein de l’organisation. Le départ du B.N. contrôlé par le P.S.U. en janvier 1971 laisse face à face les courants Renouveau et Unité Syndicale, qui tiennent très rapidement des congrès séparés. A travers l’enchaînement des événements, il s’agit donc bien d’une scission entre deux tendances ayant des conceptions opposées du syndicalisme étudiant. Jusqu’au moment de la rupture, et en dépit des entorses répétées à la discipline syndicale par certaines tendances, le cadre des luttes reste l’U.N.E.F. où cohabitent au sein des mêmes instances les diverses tendances.
Au niveau local, les faits offrent une vision différente des événements. En effet, au lieu de scission, le terme de fondation serait plus adéquat. La création de l’U.N.E.F-Renouveau à Lyon se fait entre l’appartenance revendiquée à l’U.N.E.F et le rejet de l’A.G.E.L.. Vague rassemblement d’individualités plus qu’organisation structurée, l’U.N.E.F-Renouveau tente, jusqu’en mai 1969, de faire fonctionner les différentes instances de l’A.G.E.L., dont le bureau est aux mains du P.S.U.. Après l’échec de l’A.G. du 24 mai 1969, l’U.N.E.F-Renouveau se structure progressivement et devient une organisation syndicale autonome avec son propre fonctionnement interne, ses propres initiatives et sans relations avec l’A.G.E.L.. L’A.G.E.L-U.N.E.F., crée en mai 1971 et concrétisation du renouveau à Lyon, n’est donc pas issue d’une scission, mais apparaît comme une véritable fondation reposant sur trois bases : un programme syndical, une conception des luttes et l’acceptation de la cogestion.
——————————————————————————–
Chapitre 2. Milieu étudiant et syndicalisme étudiant face à la ” massification ” de l’Enseignement Supérieur et à la crise de l’Université : 1971-1994.
I. Une Université en proie à la ” massification ” de l’Enseignement Supérieur.
Une progression numérique constante du monde étudiant.
L’Enseignement Supérieur, et en particulier l’Université, connaît de 1971 à 1994 une progression constante de ses effectifs. Il ne s’agit cependant pas de la première croissance importante de cette ancienne institution. Plusieurs poussées numériques se sont déjà produites, mais aucune n’a atteint des dimensions aussi spectaculaires et sur une aussi longue durée.
Au niveau national, on observe de toute évidence un changement dans la taille de l’Université. Les effectifs étudiants passent d’une base 100 à la rentrée 1959, à l’indice 430 à la rentrée 1977 et à l’indice 721 en 1993. En un peu plus de trente ans, le nombre d’étudiants a été multiplié par 7. De 186 101 en 1959, il passe à 615 326 en 1969, 858 085 en 1980, 1 036 600 en 1988 et 1 403 827 en 1993. Durant notre période d’étude, l’Université double de volume et prend véritablement un caractère de masse. Elle a absorbé l’essentiel de la demande de diplôme après le baccalauréat, puisque les effectifs des grandes écoles n’ont pas évolué dans les mêmes proportions. On peut distinguer différentes phases de croissance, chacune caractérisées par des rythmes et des moteurs différents. Jusqu’en 1968, on assiste à la poussée, croissance la plus importante. En effet, les effectifs sont multipliés par 3 en 10 ans. (1959-1969). Le rythme de croissance annuel demeure soutenu, puisqu’il dépasse constamment 10 % par an et atteint 15 % en 1962-1963, puis en 1963-1964. Elle doit accueillir chaque année entre 20 000 et 40 000 bacheliers supplémentaires. Le baby-boom explique en partie seulement cet accroissement. D’autres phénomènes méritent d’être éclairés : l’accroissement des taux de scolarisation et le désir croissant des bacheliers de poursuivre leurs études. Les taux de scolarisation, c’est à dire ” la proportion des jeunes qui, dans chaque classe d’âge, fréquentent un établissement scolaire, et qui sont indépendants du volume démographique des cohortes démographiques “, progressent de façon continue de 1960 à 1970 pour les classes d’âges au-dessus de 16 ans. Une part croissante de jeunes ont accès au baccalauréat, puis ensuite à l’Université. Un véritable parallélisme s’opère entre deux phénomènes : la démocratisation (même limitée) de l’Enseignement Secondaire et l’aspiration d’une part croissante des bacheliers à poursuivre leurs études.
De la rentrée universitaire 1968-1969 à 1987-1988, la croissance devient plus faible et plus régulière. Certes, l’université doit encore absorber à chaque nouvelle rentrée universitaire des dizaines de milliers de nouveaux étudiants ( entre 3000 et 40 000), ce qui ne se produit pas sans heurts. Mais le plus gros de la vague est passé, et le taux de croissance demeure fort modeste : moins de 5 % par an. Une véritable ” désinflation ” du nombre d’étudiants se produit entre 1973-1974 et 1986-1987, puisque le taux de croissance annuel tombe la plupart du temps en-dessous de 2 %. La rentré 1986-1987 marque un extrême : les effectifs progressent de 0,3 %, c’est à dire de 2888 nouveaux étudiants par rapport à la rentrée universitaire 1985-1986. Cette faible croissance résulte en partie de la baisse de la fécondité à partir de 1963-1964. Après 1964 et les années de baby-boom, la situation se renverse : la fécondité fléchit rapidement pour atteindre un minimum en 1976. Elle oscille ensuite entre 1,80 et 1,90 enfant par femme, tandis que le nombre des naissances tombe à 770 000 par an pendant les années 70. (au lieu de 881 000 en 1971). La corrélation apparaît ensuite évidente : des classes d’âges moins nombreuses accèdent au secondaire, puis, éventuellement, au supérieur. Toutefois, cette explication n’est valable que pour le milieu des années 80 : les lycéens accédant à l’université en 1985 sont nés aux alentours de 1967…. .
Les véritables causes sont donc ailleurs. Les conditions d’accueil favorisent sans doute la désaffection des nouveaux bacheliers pour les universités. Mais surtout, le ralentissement de la croissance économique et l’affaiblissement des illusions sur une promotion sociale par les études universitaires apparaissent comme les principaux freins à la croissance numérique des étudiants.
La rentrée 1988-1989 marque une reprise nette de l’accroissement des effectifs étudiants. Le nombre d’étudiants passe de 989 461 à 1 036 600 en 1988-1989, 1 236 934 en 1991-1992 et 1 403 827 en 1993-1994, ce qui correspond à une hausse de 42 % !. Désormais, prés d’un jeune sur deux de 18 à 22 ans est étudiant. Ce bouleversement s’explique tout d’abord par la généralisation progressive de l’accès à l’Enseignement Supérieur. De 30 % d’une classe d’âge au début des années 70, le taux d’accès au baccalauréat explose au milieu des années 80 pour dépasser 50 % au début des années 90. En 1995, il atteint 67 %.
% de bacheliers par génération
1850 1,3a
1900 1,8a
1950 5,9 – 4,4b
1970 18,5 – 21,5b
1975 22,2 – 29,9b
1983 27,9
1987 32,8
1988 36
1992 51,2
1994 58
Source : Quid 1995, p 1332.
a. Garçons seulement.
b. Garçons – Filles.
Cet essor s’explique par le développement, à coté des bacs généraux, des bacs technologiques et professionnels, mais surtout par la volonté affichée des pouvoirs publics ” d’amener 80 % d’une classe d’âge au niveau bac “. A cela s’ajoute le souhait massivement exprimé par les bacheliers de poursuivre des études. Dans un contexte de crise économique et de chômage massif, la réussite scolaire demeure ” le meilleur passeport pour l’ascension sociale ” et la meilleur protection contre le chômage. Cependant, l’université n’est plus la seule destination des bacheliers. La diversification de l’offre d’enseignement supérieur : universités, IUT, STS, écoles d’ingénieur… , a permis d’éviter un raz de marée de bacheliers sur l’université.
L’université connaît donc, de 1969 à 1993, un changement de dimension engagé au début des années 60. L’université élitiste des années 50 et 60 cède la place à une université de masse par le nombre.
L’évolution de l’université lyonnaise s’inscrit dans ce contexte national de massification. Cependant, deux obstacles ne permettent pas une étude complète : les données lacunaires ou indisponibles pour certaines périodes comme 1968-1976, et l’alternance irrégulière de deux unités de compte : le nombre d’inscriptions ou le nombre d’étudiants. (un étudiant ayant la possibilité de prendre plusieurs inscriptions, ce qui modifie considérablement le nombre réel d’étudiants.). L’évolution nationale se reproduit à Lyon avec une croissance importante des effectifs : 57 000 étudiants en 1976, 78 000 en 1986, 102 000 en 1992, 110 000 en 1994. Elle se situe dans la moyenne nationale. Ainsi, pour une base 100 en 1976, les effectifs étudiants à Lyon atteignent 188 en 1993. ( au niveau national : 100 en 1975, 174 en 1993).
Contrairement au niveau national où deux nettes poussées peuvent être observées , la croissance des effectifs étudiants se fait à un rythme régulier, même si une légère accélération se produit de 1987 à 1994. La progression des années 1987-1994 reste néanmoins inférieure à l’augmentation des effectifs au niveau national :
Les effectifs étudiants en France, 1959-1993
Date Effectifs Indice
1959 186101 100
1963 326311 175
1967 509198 274
1969 615326 331
1970 647625 350
1975 807911 434
1980 858085 461
1981 883657 475
1982 905198 486
1983 930268 500
1984 949844 510
1985 967778 520
1986 970666 521
1987 989461 532
1988 1036600 557
1989 1080600 580
1990 1146900 616
1991 1236934 664
1992 1313208 706
1993 1403827 754
Source : FREMY (D., M.), Quid 1995, Robert Laffond, 1994, p.1329.
Elle apparaît même faible par rapport à d’autres universités. Ainsi, les universités de Lille comptent 72 500 étudiants en 1987 et 118 000 environ en 1993, soit une augmentation de 62,7 % en 6 ans…. Le cas est identique pour l’université de Limoges, de taille pourtant radicalement différente. Pourtant, la progression du pourcentage de bacheliers par génération dans l’Académie de Lyon est similaire à l’évolution nationale. Une aire de recrutement moindre des universités lyonnaises peut expliquer cette croissance ” modérée “. En effet, une ville universitaire exercent une attraction sur un territoire variable, dans lequel elle attire et draine vers elle la majorité des nouveaux bacheliers. Or, l’aire de recrutement des universités lyonnaises apparaît réduite, en raison de la concurrence d’autres pôles universitaires : Grenoble à l’est, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand à l’ouest et Dijon au nord.
Ainsi, l’université évolue profondément de 1971 à 1994. Le processus de massification de l’Enseignement Supérieur, et de l’université en particulier, amorcé dans les années 60, s’achève au milieu des années 90. A l’Université d’élite des années 50 s’est substituée une Université de masse par le nombre. A Lyon, une forte croissance des effectifs peut-être observée durant cette période, mais sans particularités notables. Elle fait cependant exploser les vieux campus du centre-ville hérités des premières années de la IIIe République. Afin d’absorber ces flots de nouveaux étudiants, de nouveaux campus sont aménagés de 1967 à 1994. Deux générations se succèdent : les campus éloignés du centre-ville durant les années 70 (Lyon I Doua débuté à la fin des années 60 et Lyon II Bron), puis réintégrés au début des années 90 (Lyon III Manufacture). Dés lors, une dichotomie apparaît entre ces deux générations de campus. Tandis que les campus intégrés au centre-ville connaissent peu de mouvements étudiants, les campus situés à Bron ou Villeurbanne, souvent construits rapidement, connaissent de multiples problèmes matériels et deviennent des zones sensibles pour la propagande et le développement des groupes gauchistes, des syndicats et des mouvements étudiants.
Une démocratisation de l’enseignement supérieur limitée.
L’université connaît, de 1971 à 1994, un phénomène de massification par le nombre. Cependant, une véritable démocratisation se produit-elle ?. Il ne s’agit pas de la démocratisation interne de l’Université (dépérissement de la hiérarchie rigide des relations entre enseignants et étudiants…), mais de la démocratisation externe, c’est à dire de son recrutement. En effet, l’accroissement des effectifs n’a pas forcément pour corollaire l’accès de toutes les classes sociales, de tous les sexes, à une formation universitaire.
La démocratisation se pose tout d’abord pour les classes sociales. Des facteurs ont favorisé au cours des trois dernières décennies l’accès de toutes les classes sociales à l’université : absence de sélection pour les bacheliers postulant à l’entrée des universités, hormis quelques filières, assouplissement du régime des examens… . Toutefois, la démocratisation sociale du recrutement se heurte à la structure même des études universitaires : complexité du cursus universitaire, coût financier, allongement de la durée des études… . La démocratisation du baccalauréat a fait sauter l’obstacle social du lycée, réservé jusqu’aux années 70 aux enfants de la bourgeoisie. Cependant, la poursuite d’études, le type de bac… différent selon les classes sociales.
Mais la démocratisation externe de l’Université ne passe pas exclusivement par l’accès de toutes les catégories sociales aux formations universitaires. Elle passe aussi par l’accès des deux sexes à l’Université. Très majoritairement composée d’étudiants dans les années 50, l’Université change profondément durant les décennies suivantes. L’inégalité entre filles et garçons se résorbe fortement durant la période 1960-1980. La population étudiante, composée de 40,0 % de filles en 1959-1960, s’équilibre pour atteindre50,0 % de filles à la rentrée 1980-1981. Cette tendance s’accentue de 1980 à 1994 et un renversement se produit. Désormais, les étudiantes sont majoritaires : 53,1 % en 1989.
Les étudiantes en France
(en % du total des étudiants)
1900 3,5
1929 22,9
1939 30
1949 33,1
1959 38,4
1967 43,5
1969 45,5
1975 47,6
1980 49,7
1981 50,5
1982 49,7
1983 50,5
1984 51
1985 51,2
1986 51,6
1987 52,2
1988 52,7
1989 53,1
Source : FREMY (D., M.), Quid 1995, Robert Laffont, 1994, p.1329.
Mais cette évolution cache mal la persistance de nombreuses inégalités. En effet, les filles font des études plus courtes et deviennent minoritaires au-delà du premier cycle et en particulier dans le troisième cycle. Elles se dirigent peu dans certaines disciplines comme certains IUT, les sciences exactes, la médecine, les sciences économiques et de gestion…. Ainsi, à Lyon II, la filière de sciences économiques et de gestion compte, à la rentrée 1996-1997, 46,1 % d’étudiantes, contre 61,8 % en Histoire et 81,7 % dans la faculté des langues.
L’Université connaît, de 1971 à 1994, une très légère démocratisation. En effet, la massification par le nombre a rendu possible un accès plus large des filières universitaires à des classes sociales défavorisées ou aux deux sexes. Cependant, des inégalités demeurent : une sélection s’opère toujours dans le choix de la filière, dans la durée des études, dans les chances de réussite ( accès ne rimant pas avec obtention d’un diplôme). Au final, l’Université des années 70 à 90 est en mutation lente, mais elle garde de nombreux traits de continuité avec le passé.
——————————————————————————–
II. Des réformes nombreuses sources de conflits et de mouvements étudiants.
Face à l’afflux de nouveaux bacheliers et à son cortège de difficultés matérielles et pédagogiques, aux mutations de la société et du marché du travail…, les ministres successifs de l’Education Nationale ont tenté, le plus souvent sans réussite, de réformer l’Enseignement Supérieur. Souvent élaborées sans concertation avec les milieux enseignants et étudiants, elles deviennent des sources de conflits et de mouvements étudiants.
L’agitation fébrile du début des années 70.
Le début des années 70 apparaît comme une période trouble, où des mouvements étudiants alternent avec des phases de résignation. La proximité de mai 1968, à travers les principaux acteurs et mots d’ordre, influence encore un mouvement étudiant en pleine restructuration, même si elle s’amenuise progressivement.
Un ” mai rampant ” persiste au début des années 70 et favorise, généralise la contestation à de nouveaux publics ou mécanismes du système scolaire : concours de recrutement des enseignants du secondaire en mai 1969, lycées techniques et généralistes de 1969 à 1974 où les C.A.L, objets d’une lutte acharnée entre les communistes de la J.C. et les groupes d’extrême-gauche, jouent un rôle de première place, fermeture provisoire de l’E.N.S. en 1971. A l’université, ce ” mai rampant ” apparaît tout d’abord lors de la grève en lettres et sciences à Lyon en 1970. En Lettres, elle dure plus d’un mois, puisqu’elle s’étend du 20.01. au 25.02. Elle trouve son origine dans la circulaire Guichard sur les examens. Elle est votée à l’initiative de l’U.E.L. (Union des Etudiants Lyonnais, considérée comme très modérée par les R.G..), afin, semble t’il, de contrer les groupes gauchistes et de contrôler le mouvement. La grève, lancée par l’U.E.L., obtient très rapidement le soutien de l’A.G.E.L. et se généralise aux trois facultés lyonnaises, c’est à dire lettres, sciences et droit. Cependant, le consensus contre la circulaire Guichard éclate rapidement et les différents acteurs adoptent des positions opposées. Les modérés, qui ont lancé la grève, développent des revendications corporatistes, propres à chaque faculté. Les groupes gauchistes dépassent le cadre étroit des revendications corporatistes et universitaires et, à la critique de la loi Faure, rajoutent des mots d’ordre politiques généraux. Enfin, les communistes, groupés au sein de l’U.E.C. craignent, selon les R.G., d’être dépassés et hésitent à s’engager pleinement. A ces divisions entre les différents protagonistes s’ajoute le pourrissement de la grève, ce qui engendre durant le mois de février des situations diverses selon les facultés et des ” alliances ” peu conventionnelles. La reprise du travail se fait rapidement en droit puis en sciences où elle est favorisée par une opposition commune à la grève illimitée A.J.S./ U.E.C./Modérés. En lettres, la grève s’éternise jusqu’à la fin du mois de février, puis une reprise s’amorce à partir du 25.02. La fin de la grève ne signifie cependant pas la fin de l’agitation. En effet, des mouvements étudiants multiples, mais de brève durée et de faible ampleur, éclatent jusqu’en mars 1970 à l’I.N.S.A., en lettres, en sciences économiques, en médecine et en sciences.
Un second grand mouvement étudiant a lieu en mars 1973 avec la lutte contre la loi Debré sur les sursis étudiants et contre la création du D.E.U.G.. La loi Debré, du nom du ministre de l’intérieur, vise à réduire, et parfois supprimer, les sursis militaires accordés aux étudiants afin de leur permettre d’achever leur cursus. Elle se trouve en conjonction avec la loi instaurant le D.E.U.G. à la place du D.U.E.S. en premier cycle universitaire. Cette conjonction va favoriser la mobilisation au-delà du monde étudiant, puisque les lycéens participent activement à ce mouvement. Toutefois, le mouvement se divise rapidement entre organisations de la gauche traditionnelle (socialistes et communistes) et d’extrême-gauche. Les manifestations des 23 et 24 mars sont à ce sujet éloquentes. En effet, une manifestation organisée par l’UD-C.A.L., le M.J.C.F., l’A.G.E.L.-U.N.E.F., l’U.G.E. et le CDJ-C.G.T. a lieu le 23 mars 1973 et draine environ 500 étudiants et lycéens. Le 24 mars 1973, une autre manifestation préparée par l’U.N.C.A.L. et l’extrême-gauche rassemble plusieurs milliers de lycéens. Dans le même temps, le mouvement s’organise hors des syndicats étudiants et lycéens, puisque des comités divers se créent au niveau local et national : ” comité de coordination lyonnaise étudiante “, ” coordination des comités contre la loi Debré “, ” commission de coordination “…. D’autres mouvements revendicatifs nationaux ont lieu : réforme d’Ornano en Architecture en septembre 1971, projet de création des CFPM en février 1972, plan Vedel en mai 1972, réforme Fontanet en février 1974.
A cette trame nationale et à ses répercussions locales, des mouvements essentiellement locaux se superposent. Ils se distinguent par leur soudaineté, leur caractère mobilisateur éventuellement important et par leur brièveté. Ainsi, un meeting organisé par le CA U.N.E.F. I.N.S.A. le 02 février 1971 afin de protester contre l’exclusion de deux élèves regroupe 800 élèves. Il est suivi du vote d’une motion concernant la pénurie matérielle et la sélection, et aboutit à la réintégration des deux étudiants. Toujours en février 1971, une grève éclate au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique et a pour objectif une amélioration des conditions de vie et d’études. Soutenue par l’U.N.E.F-Renouveau, elle aboutit à la création d’un CA U.N.E.F.. De multiples autres mouvements ont lieu : incidents à la cité universitaire de Jussieu après l’exclusion d’un étudiant africain en avril 1970, partition de l’université Lyon II et création de l’université Lyon III en décembre 1973… . Aux mouvements purement universitaires se greffent des mobilisations sur la base d’une révolte politique. Ainsi, l’U.N.E.F-Renouveau lance une journée d’action contre la guerre du Vietnam le 14 mai 1970 et organise des rassemblements, meetings, signatures de pétition, collectes… .
Dans le contexte d’une vie étudiante très instable, encore relativement politisée et militante, de nombreux conflits éclatent. Au quasi-traditionnel mouvement étudiant annuel de dimension nationale s’ajoutent de multiples conflits à enjeux locaux. Ils se greffent sur un même terreau : réformes universitaires ou concernant les étudiants, conditions de travail, autoritarisme de l’administration. Le rôle des groupes d’extrême-gauche demeure important et leur audience dépasse souvent le cercle restreint des militants et sympathisants, comme lors des manifestations contre la suppression des sursis.
La réforme du second cycle : 1976.
Après une année universitaire 1974-1975 relativement calme sur le ” front universitaire “, un interminable conflit se déclenche de mars à mai 1976. Il a pour origine le projet de réforme du second cycle dans les universités. Cette réforme s’inscrit dans le cadre plus vaste de la mise en place du nouveau cursus des études universitaires. Ainsi, en 1973, un premier cycle interdisciplinaire de deux ans est crée. Il est sanctionné par un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G.), qui remplace les anciens D.U.E.S. et D.U.E.L.. En 1974, un nouveau système est mis en place pour le troisième cycle. Désormais, le troisième cycle comprend deux grades : le D.E.A. ou le D.E.S.S. (Diplôme d’Etudes Approfondies, Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées à vocation professionnelle), puis le doctorat de troisième cycle. Dans les faits, cette nouvelle formule ne bouleverse pas les habitudes, le D.E.A. devenant souvent une première année de thèse. Cependant, une sélection s’opère entre le D.E.A. et le doctorat, puisque les habilitations consenties aux universités pour organiser le doctorat sont très nettement inférieures au nombre d’étudiants en D.E.A.. La réforme du second cycle s’inscrit donc dans un cadre beaucoup plus large de refonte du cursus universitaire. Elle crée désormais deux grades pour le second cycle : la licence atteinte en trois ans après le baccalauréat, et la maîtrise en quatre ans. Cette réforme est mise en place par un nouveau secrétaire d’Etat aux universités : Alice Saunier-Seité. Nommée en janvier 1976, elle acquiert rapidement une réputation de ” dure ” dans la remise au pas des universitaires et des étudiants. En effet, elle n’hésite pas à rompre avec le langage diplomatique de ses prédécesseurs, et en particulier de Mr Soisson. (Secrétaires d’Etat aux universités du 08.06.1974 au 11.01.1976).
Contrairement à la réforme du IIIe cycle, un mouvement étudiant se dessine rapidement et prend de l’ampleur pour devenir national. Conformément aux conflits précédents, les groupes gauchistes encadrent fortement le mouvement lors de ses débuts. Une concurrence s’établit à Lyon entre l’U.G.E.L-U.N.E.F., l’A.G.E.L-U.N.E.F .et les mouvements gauchistes. Cependant, le conflit prend rapidement une nouvelle dimension : une coordination nationale est créée avec la participation des deux U.N.E.F.. A Lyon, une alliance de circonstance se noue entre l’A.G.E.L-U.N.E.F. et la L.C.R. pour le contrôle de la coordination. Des comités de lutte gèrent le mouvement à la base avec les syndicats étudiants. Le mouvement atteint son apogée le 15 avril 1976 : les manifestations rassemblent dans toute la France 200 000 étudiants. Cependant , en dépit de ce nouveau climat, le mouvement traîne en longueur et s’enlise face à l’intransigeance du nouveau secrétaire d’Etat. Les mots d’ordre des groupes gauchistes trouvent de moins en moins d’échos chez les étudiants et le mouvement s’achève dans ” un profond sentiment de lassitude ” et sur quelques concessions du gouvernement.
Le mouvement étudiant contre la réforme du second cycle apparaît comme le ” dernier remake d’un scénario d’agitation “. En effet, le démarrage du conflit s’inscrit dans la tradition des mouvements du début des années 70 : mobilisation importante des étudiants, forte présence et contrôle des groupes gauchistes… . En dépit de quelques concessions, le mouvement marque un tournant : stratégie de pourrissement jouée par le gouvernement, perte d’influence des groupuscules gauchistes, lassitude des acteurs, réduction de la capacité mobilisatrice du monde étudiant… .
Une période de ” calme ” et de mouvements restreints à enjeux locaux : 1976-1986.
Le mouvement étudiant de 1976 ouvre une nouvelle période, qui s’étend de 1976 à 1986. Elle se caractérise par un calme relatif sur le ” front universitaire “, même si des mouvements restreints à enjeux locaux éclatent sporadiquement. Cette période de calme relatif s’explique avant tout par l’absence de réforme universitaire d’ensemble. La mise en place du nouveau cursus universitaire, très proche de la réforme Fouchet, s’est éffectuée les années précédentes : D.E.U.G. en 1973, troisième cycle en 1974, second cycle en 1976. De plus, le nouveau secrétaire d’Etat aux universités renonce à attaquer de front la loi d’orientation. La nouvelle politique universitaire se borne à une série de petites victoires successives contre ” les stipulations libérales ou démocratiques de la loi d’orientation “.
Dans ce contexte, les rares mouvements étudiants nationaux demeurent de faible ampleur ou cantonnés dans des secteurs particuliers de l’Enseignement Supérieur. En 1977, la réforme Haby, du nom du ministre de l’Education Nationale de mai 1975 à avril 1978, touche les grandes écoles. Le conflit porte principalement sur la constitution de deux conseils pédagogiques : un conseil des professeurs décidant de l’orientation des élèves et un conseil de classe purement consultatif. En 1979, un nouveau secteur est concerné : les études médicales. La réforme, élaborée par le ministre de la Santé Mme Veil, provoque une forte mobilisation des étudiants en médecine. Ainsi, à Lyon, la journée d’information et de manifestation du 21 mars place Bellecour regroupe 1000 étudiants. Une autre manifestation a lieu le 3 avril devant le Rectorat et la D.A.S.S.. Très rapidement, le mouvement se structure et se dote d’une ” coordination des étudiants “, plus ou moins proche de l’A.G.E.L-U.N.E.F. Le seul mouvement d’ampleur national et ” global ” a lieu en décembre 1979 avec le vote par l’Assemblée Nationale de l’amendement Ruffenacht. Cette mesure apparaît rapidement comme antidémocratique, puisqu’elle réduit le nombre de sièges accordés aux étudiants et donne aux seuls professeurs de rang A, les fameux ” mandarins “, le droit de candidature et d’élection au poste de président d’université. Par conséquent, les enseignants, les assistants et les étudiants sont exclus de l’élection des présidents d’université. D’autres mesures avaient précédé l’amendement Ruffenacht : application stricte du quorum pour les élections universitaires en 1975, nomination des directeurs d’IUT par le gouvernement en 1978… . La première réaction provient des conseils d’université : les conseils des trois universités lyonnaises votent la suspension des cours le mardi après-midi en signe de protestation. Une même unanimité se retrouve parmi les syndicats et associations étudiantes. Sans aller jusqu’à l’unité d’action, l’A.G.E.L-U.N.E.F, la CERRA (C.L.E.F., étudiants modérés), la Corpo Lyon III, l’UD-C.G.T., le S.N.E.Sup., le SNECS, le SNAU, le SNB, le SNEP, le SNPCEN, le SNPESB, le SNTRS et le Syndicat Autonome adoptent des positions proches et critiquent le projet. Seule l’U.N.E.F-Unité Syndicale, au nom du refus de la cogestion, appelle les élus étudiants à démissionner et dénonce le ” dernier carré de la participation Sauvage “. Mais, en dépit de ce contexte favorable, la mobilisation étudiante tarde à prendre et reste faible : la manifestation du 18 décembre 1979 organisée par l’A.G.E.L-U.N.E.F ne rassemble que quelques centaines d’étudiants. Un dernier mouvement étudiant national a lieu en avril-mai 1983. Le déclencheur universitaire de ce conflit est la préparation d’une nouvelle loi d’orientation de l’Enseignement Supérieur par le nouveau gouvernement de gauche. Profondément modifiée lors de son passage devant l’Assemblée Nationale, la première ébauche propose une sélection entre les cycles, une réforme des premiers cycles, une première expérience de contractualisation Etat / Université et de nouveaux statuts aux facultés (création des U.F.R.). Le mouvement prend rapidement un tour politique. En effet, l’U.N.I. (Syndicat de droite regroupant enseignants et étudiants) et les associations d’étudiants modérés (Corpo Lyon III) investissent rapidement le mouvement. Cependant, seuls les secteurs, filières réputées ” conservatrices ” adhérent rapidement au mouvement. Ainsi, à Lyon, le mouvement de grève touche essentiellement les facultés de droit et d’AES de l’université Lyon III. Les universités Lyon I et Lyon II demeurent à l’écart du conflit. Ce mouvement se superpose à la lutte des étudiants en médecine contre le projet de réforme des études médicales. Les mobilisations étudiantes apparaissent donc, au niveau national, plus espacées dans le temps et d’une ampleur relativement faible.
A l’inverse, de multiples conflits se développent en lien avec le contexte universitaire local. Ils ont souvent pour origine les conditions d’étude, la défense d’étudiants étrangers menacés d’expulsion ou l’instauration par une université de droits d’inscription supplémentaires. Ainsi, en décembre 1979, l’A.G.E.L-U.N.E.F, l’U.G.E. et le SNEP lancent une action, afin de protester contre l’instauration à Lyon I d’une cotisation pour le sport. Une manifestation d’un genre un peu particulier a lieu le 13 décembre rue de la République : 200 étudiants jouent au ballon sur la voie publique, puis manifestent jusqu’au Rectorat où une délégation est reçue. Les conflits peuvent parfois prendre un caractère violent. Ainsi, en juin 1977, à la suite d’une rocambolesque affaire d’ ” admissibles-recalés ” à Lyon I, un comité de défense, soutenu par l’U.G.E.L-U.N.E.F., séquestre pendant toute une nuit une soixantaine de professeurs. Les mouvements locaux ont donc un cadre restreint : faculté, filière ou même année d’étude, amphithéâtre, et peuvent posséder un fort potentiel mobilisateur.
Le mouvement étudiant de 1976 inaugure donc une nouvelle période. Une conjonction entre une capacité de mobilisation plus faible du monde étudiant et un changement de tactique du pouvoir engendre une absence de mouvements nationaux et globaux. Désormais, le mouvement étudiant s’exprime de façon plus ponctuelle et s’attache davantage à la situation locale.
Le développement de mouvements étudiants strictement universitaires.
Au milieu des années 80, une nouvelle situation voit le jour avec le développement de mouvements étudiants marqués par des revendications strictement universitaires. Elle peut apparaître comme l’aboutissement d’une longue évolution du monde étudiant. En effet, les mouvements des années 70 ont pour base la défense de grands principes, l’engagement en faveur de projets de société alternatifs ou d’une autre politique universitaire. Ces thèmes de mobilisation connaissent, à partir du milieu des années 70, un effacement progressif de leur audience. Dans le même temps, les étudiants prennent davantage de distance à l’égard des organisations politiques ou syndicales.
Cette évolution aboutit, dans les années 80 et 90, au développement de deux sentiments chez les étudiants : la peur de la récupération politique et l’importance désormais conférée aux études, synonymes désormais de réussite sociale et surtout de protection ou d’échappatoire face au chômage. Il se produit à la fois un rejet du politique et une forte capacité mobilisatrice du monde étudiant si les valeurs auxquelles il est attaché sont remises en cause, c’est à dire la liberté et l’égalité d’accès à l’Université. La mobilisation étudiante se réalise désormais sur des revendications concrètes (locaux, droits d’inscription, sélection, valeur des diplômes…) et rejette avec force le spectre de la politisation.
Les mobilisations étudiantes de la fin des années 80 et des années 90 reposent donc sur des revendications universitaires. Cet aspect apparaît clairement lors des mouvements étudiants de 1986, 1994 et 1995. La lutte des étudiants contre le projet Devaquet à la fin de l’année 1986 est à cet égard la plus significative. La mobilisation des étudiants a pour base l’opposition au projet d’Alain Devaquet, ministre de l’Enseignement Supérieur du nouveau gouvernement de droite dirigé par J.Chirac. Elaborée en mai 1986, la loi Devaquet s’inscrit dans l’orientation libérale du gouvernement : instauration de la sélection, hausse des droits d’inscription, élargissement de l’autonomie des universités. Lors de son passage devant le Sénat, elle ne suscite pas de critiques ou d’oppositions particulièrement fortes. Les syndicats étudiants tentent alors de mobiliser, mais en vain… . Tout change pourtant à l’automne 1986. Un appel à la grève lancé par une coordination nationale dirigée par l’U.N.E.F-ID lors d’Etats Généraux à la Sorbonne trouve rapidement un écho dans les universités. A Lyon, la grève débute à partir du 24 novembre 1986 dans les universités Lyon I et Lyon II, Lyon III restant hors du mouvement. Spontané, le mouvement prend rapidement de l’ampleur et se structure, s’organise sous l’impulsion de militants syndicaux, en particulier de l’U.N.E.F- ID. Ainsi, à Lyon I, l’Assemblée Générale met en place un comité de grève auquel participe le président de l’U.G.E.L-U.N.E.F- ID, Christophe Borgel. A Lyon II, des comités d’action sont crées en fonction des filières et sont chapeautés par un ” comité de coordination “. La mobilisation apparaît d’emblée extrêmement forte et se fonde presque essentiellement sur l’opposition à toute tentative de sélection à l’entrée de l’université. Un seul objectif : le retrait du projet Devaquet, sans autre proposition ou revendication. Limité dans ses objectifs, le mouvement se distingue aussi par son rejet du politique. Il se traduit par la volonté des étudiants de se distancier du politique et par une exigence de démocratie au sein du mouvement. La grève est contrôlée par l’Assemblée Générale des étudiants et un fort refus de toute récupération par une organisation politique ou syndicale se manifeste parmi les étudiants. Lors de la manifestation du 27 novembre 1986 à Lyon, qui réunit entre 20 000 et 40 000 étudiants, une consigne votée par les A.G interdit aux organisations syndicales de déployer leurs banderoles. Le mouvement étudiant de 1986 connaît en réalité deux phases : au début, la mobilisation contre le projet Devaquet est très forte et se résume au seul objectif de retrait. La mort de Malik Oussekine le 5 décembre à Paris lors de la terrible répression de la manifestation entraîne la démission d’A. Devaquet le 6 décembre et le retrait du projet le 8 décembre. Le mouvement connaît alors une seconde phase où, sous l’impulsion des syndicats étudiants, les mots d’ordre démocratiques et éthiques prennent le pas sur les revendications universitaires. Forte au début, véritable réaction émotionnelle, épidermique, la mobilisation s’affaiblit très rapidement. Certes, la manifestation organisée pour protester contre les violences policières et en hommage à Malik Oussekine rassemble plus de 25 000 étudiants, lycéens et parents à Lyon. Mais dés le 11 décembre, les cours reprennent dans les lycées et les collèges. Le mouvement étudiant de 1986 conjugue les nouveaux aspects de la mobilisation étudiante rejet du politique, peur de la récupération, importance donnée aux études, forte capacité mobilisatrice sur les questions universitaires, rôle des médias à la fois relais des revendications étudiantes et facteur d’influence sur les événements… .
Les mouvements étudiants des années 86-94 apparaissent comme l’aboutissement d’une longue évolution. Changement dans la forme tout d’abord, avec une prise de distance très nette vis à vis du politique. Cette distanciation se traduit par la systématisation des nouvelles formes d’organisation apparues dans les années 70, et en particulier des coordinations. Seules structures reconnues comme légitimes par le mouvement, elles sont fondées sur la désignation de représentants ” indépendants ” des syndicats et élus en A.G. Les structures et l’expérience des militants syndicaux sont utilisées, mais sous le contrôle de l’A.G. ou de la coordination. Les syndicats étudiants, écartés des feux de la rampe, demeurent tout de même présents. Ainsi, en 1995, la coordination étudiante élue à Lyon II comprend 3 militants de l’U.N.E.F- ID, 2 de l’U.N.E.F et 1 de Lutte Ouvrière. Les militants syndicaux, et en particulier les responsables, possèdent souvent seuls les capacités d’analyse, d’expression et l’expérience nécessaires dans ces situations peu coutumières pour la plupart des étudiants. Cependant, ils ne contrôlent pas totalement le mouvement. Mais le mouvement étudiant a aussi évolué sur le fond. Les ressorts de la mobilisation ont changé : les revendications universitaires peuvent seules désormais susciter l’intérêt des étudiants. ” L’action collective étudiante des années 80/90 exprime la force de la demande sociale d’éducation de couches de plus en plus diversifiées de la population qui s’opposent à tout ce qui viendrait entraver la liberté d’accès à l’Université ou mettre en cause les conditions de la réussite “.
——————————————————————————–
III. La place de l’A.G.E.L-U.N.E.F au sein du mouvement étudiant.
Un rôle dans l’information des étudiants.
L’A.G.E.L-U.N.E.F, mais aussi d’autres syndicats ou associations, tient un rôle essentiel dans l’information des étudiants. Curieusement, les grands mouvements étudiants révèlent souvent une inversion entre deux phases essentielles de leur déroulement : l’information et l’action. Il n’est en effet pas rare de voire des étudiants réagir à propos de rumeurs sur une réforme, puis, après, de s’enquérir du contenu. Le mouvement étudiant de 1986 est marqué par ce phénomène. Les étudiants, venus pour aller en cours le matin même, décident de se mettre en grève à l’appel des Etats Généraux de la Sorbonne et des syndicats étudiants. Or, si la plupart d’entre eux ressentent le projet Devaquet comme une menace, peu connaissent le contenu, l’ensemble de la réforme. Une seule mesure de la réforme, l’augmentation des droits d’inscription, permet de mobiliser la masse des étudiants. La véritable information se fait après, lors de l’Assemblée Générale où des textes circulent, où des militants expliquent inlassablement les dangers de la réforme et où des commissions diverses sont créées. Ainsi, à Lyon I, une ” commission de dissection du plan Devaquet ” est mise en place dés la première journée d’action. Le manque d’information s’explique avant tout par la faible implication des étudiants dans leur université, faible implication déjà mise en exergue par la faible participation des étudiants aux élections universitaires. Par conséquent, le mouvement étudiant est très épidermique, instable.
Les syndicats étudiants tiennent donc un rôle capital dans l’information des étudiants, en particulier au début de la mobilisation. Leur accès privilégié à l’information (représentation nationale, participation aux différents conseils universitaires, interlocuteurs des autorités universitaires…) les rendent inévitables dans le déclenchement d’un mouvement. De plus, ils sont souvent les seuls à disposer des capacités nécessaires pour informer les étudiants : militants et adhérents, imprimerie pour l’A.G.E.L-U.N.E.F, liens avec les grandes centrales syndicales, les partis politiques, expérience dans la rédaction d’un tract, capacités d’expression… .
Hors d’eux, la circulation de l’information à grande échelle devient extrêmement difficile. L’intervention de l’A.G.E.L-U.N.E.F pour informer les étudiants se fait selon différentes modalités. Les Assemblées Générales ne sont pas, jusqu’au milieu des années 80, le moyen d’information privilégié. En effet, ouvertes à tous, elles sont difficilement contrôlables et offrent aux groupes gauchistes la possibilité de s’exprimer et de peser sur les débats. L’A.G.E.L-U.N.E.F est donc réticente face aux A.G. : ” on commençait à faire monter la pression dans les T.D. avec des interventions… , et cela débouchait toujours sur une A.G. où se retrouvait tout le ramassis de crapules possibles […], et aussi des étudiants normaux […]. Elles ont toujours été la plaie ces A.G., parce qu’elles sont profondément antidémocratiques, dans la mesure où ne s’expriment là-dedans que les professionnels de la politique et de l’agitation, et où l’étudiant de base ne peut pas parler. “.Mais elle a son rôle, son importance, dans la mesure où elle fait prendre conscience à un mouvement de sa force.
Un changement s’opère pourtant progressivement. En 1992, l’A.G.E.L-U.N.E.F prend l’initiative de convoquer une A.G. pour informer les étudiants sur la réforme Jospin. Cette évolution provient avant tout du rôle, au sein du mouvement étudiant, dont l’U.N.E.F. veut se doter. Dans les années 70, l’U.N.E.F., même si elle n’en est pas capable, revendique la direction des luttes. Au congrès de Toulouse en 1990, l’U.N.E.F., considérablement affaiblie et à peine remise du mouvement étudiant de 1986, modifie la nature de son intervention au sein du mouvement étudiant : ” (le mouvement étudiant de 1986) nous a amené à réfléchir sur notre orientation et à décider d’inverser notre démarche. Jusque là, nous intervenions porteurs d’un projet pour l’Enseignement Supérieur et nous ne laissions aux étudiants que la possibilité de nous soutenir […]c’est le débat qui a été au centre du congrès de Toulouse en 1990 et nous a amenés à redéfinir l’U.N.E.F. comme un outil pour rassembler les étudiants “. L’U.N.E.F. redéfinit donc sa place au sein du mouvement étudiant : elle se veut un outil, un instrument pour rassembler les étudiants au lieu de les contrôler, elle se met au service du mouvement étudiant en favorisant la circulation de l’information… .
Outre les A.G., l’information se fait par les innombrables tracts ou par voie d’affichage. La réforme Fontanet en 1974 est ainsi longuement disséquée et épluchée dans les tracts : situation de l’Université, analyse de la réforme Fontanet, propositions de l’A.G.E.L-U.N.E.F.
Enfin, l’A.G.E.L-U.N.E.F informe les étudiants par l’intermédiaire des interventions en amphis ou dans les T.D. Elle tente alors de privilégier la discussion avec les étudiants et d’instaurer un dialogue. L’intervention en amphi apparaît systématique : projet de réforme des études médicales en février 1980, licenciement des vacataires en novembre 1978… . Il existe une véritable volonté de discuter et d’expliquer aux étudiants. L’A.G.E.L-U.N.E.F, mais aussi les autres syndicats et associations, assume un rôle essentiel dans l’information des étudiants.
Une incapacité à assumer et à contrôler le mouvement étudiant.
Jusqu’à la scission de 1971, l’U.N.E.F. est la seule organisation syndicale étudiante capable de diriger et d’organiser le mouvement étudiant. Après la scission de 1971, les mouvements étudiants impliquent la participation d’organisations étudiantes affaiblies et rivales. L’U.N.E.F. n’échappe pas à cette évolution et s’avère incapable d’assumer et de contrôler de bout en bout un mouvement étudiant. Cette réalité est rapidement prise en compte par l’A.G.E.L-U.N.E.F. Ainsi, lors du congrès de l’A.G.E.L-U.N.E.F de 1972, la situation est analysée avec lucidité : l’échec de la journée d’action de l’U.N.E.F. du 14 mars et la place de l’A.G.E.L-U.N.E.F est imputé à une mauvaise analyse du milieu étudiant et à une incapacité à encadrer le mouvement étudiant par manque d’adhérents… .
L’incapacité de l’A.G.E.L-U.N.E.F à contrôler les mouvements étudiants se traduit concrètement par l’apparition de structures éphémères propres au mouvement : les coordinations étudiantes… .Le conflit génère ses propres structures et responsables en dehors des organisations syndicales traditionnelles. Elles sont le plus souvent mises en place par les A.G. Ainsi, en avril 1979, une ” coordination des étudiants ” organise la lutte contre la loi Veil de réforme des études médicales. Bien que participant à la coordination, l’A.G.E.L-U.N.E.F ne détient qu’un contrôle médiocre sur le mouvement en raison de son implantation incomplète dans les CHU. L’U.N.E.F. des années 50 et 60 était capable de regrouper derrière elle les différentes sensibilités du monde étudiant et apparaissait comme la seule organisation capable de représenter les étudiants et le mouvement étudiant. Or, l’U.N.E.F. issue de la scission de février 1971 ne représente plus qu’une fraction du monde étudiant. En concurrence avec d’autres organisations et confrontée à un désir de diversité du monde étudiant, elle n’apparaît plus comme une structure apte à prendre en compte toutes les aspirations d’un mouvement revendicatif.
Si l’A.G.E.L-U.N.E.F analyse rapidement et avec lucidité son incapacité à faire démarrer et aboutir un mouvement étudiant, elle tarde à accepter la nouvelle donne. Elle garde son attitude rétive vis à vis des nouvelles formes d’organisation, attitude encore très influencée par le mythe de la ” grande U.N.E.F. “, seule organisation représentative des étudiants. Jusqu’en 1975-1976, elle fait preuve d’une très grande réticence et méfiance envers ces nouvelles formes d’organisation. Considérée comme un aveu de sa propre faiblesse, elle participe très rarement à leur mise en place. Cependant, elle modifie progressivement sa position à partir de 1973. A partir de 1975-1976, elle est beaucoup plus nuancée et pragmatique dans son attitude. Au niveau national, la grève contre la réforme du second cycle (1976) rassemble pour la première fois au sein d’une coordination nationale l’U.N.E.F. et l’U.N.E.F.-Unité Syndicale. Toutefois, le gouvernement ne reconnaît aucune légitimité à la coordination et reçoit séparément les deux syndicats. Au niveau local, une attitude pragmatique prédomine. Certes, l’A.G.E.L-U.N.E.F demeure méfiante, mais elle comprend rapidement que c’est le seul moyen de faire démarrer un mouvement. Au lieu de se retrouver en concurrence avec les coordinations, elle investit désormais des militants au sein de ces structures éphémères. A la fin des années 80, l’A.G.E.L-U.N.E.F s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étroite avec les coordinations… . En 1990, le congrès de Toulouse réaffirme cette position et l’érige en orientation syndicale.
Une indépendance vis à vis du mouvement étudiant.
Avec l’apparition de nouvelles formes d’organisation, l’U.N.E.F. collabore et s’implique de plus en plus auprès des différents acteurs du mouvement étudiant. Toutefois, l’A.G.E.L-U.N.E.F garde son indépendance vis à vis du mouvement étudiant.
La logique unitaire ne l’emporte jamais sur la logique propre du syndicat. Elle n’hésite pas, lorsqu’elle juge un mouvement contraire aux intérêts des étudiants, à s’opposer et à prôner d’autres formes d’action ou une autre orientation. Le mouvement étudiant de 1983 a particulièrement mis en exergue ce cas de figure. La grève des étudiants de la faculté de médecine en avril 1983 ne rencontre que son opposition et son hostilité. Tout en jugeant l’évolution des discussions engagées à Paris comme ” satisfaisante “, l’A.G.E.L-U.N.E.F dénie au mouvement de grève toute légitimité et, au contraire, tente d’organiser les non-grévistes. Elle dénonce pêle-mêle les piquets de grève musclés devant les CHU, les A.G. non représentatives (elles rassemblent la plupart du temps 600 à 700 étudiants sur 3000), l’impasse dans laquelle s’enfonce le mouvement… .Elle réagit même en organisant une A.G. des non-grévistes et en demandant l’intervention des autorités universitaires pour assurer le ” droit de suivre les cours “. Face au mouvement dans les facultés de Droit et de Sciences Humaines et Sociales, l’A.G.E.L-U.N.E.F s’engage encore davantage, puisqu’elle soutient ouvertement la réforme Savary. A Lyon II, elle contre les partisants de la grève (U.N.E.F-ID, C.E.L.F…) en montant une réunion d’information sur le projet de loi avec deux députés de la majorité P.S.-P.C.F. : J.J Queyranne et G Hage.
En dépit de son incapacité à lancer et à faire aboutir des mouvements étudiants, l’A.G.E.L-U.N.E.F garde une certaine indépendance et développe ses propres thèmes, fait avancer ses idées lors d’un conflit. Elle sait s’opposer avec force face à des conflits qu’elle juge inopportuns.
——————————————————————————–
Résumé :
De 1971 à 1994, l’Université évolue considérablement et connaît une ” massification “. La progression numérique du monde étudiant est constante avec une forte poussée de fièvre de 1988-1989 à 1994. Les effectifs passent de 615 326 étudiants en 1969 à 1 403 827 en 1993. Le même phénomène se produit à Lyon où les 2 puis 3 universités accueillent 110 000 étudiants en 1994, contre 57 000 en 1976. Durant notre période, l’Université double de volume et absorbe l’essentiel de la demande de diplômes après le baccalauréat. Cependant, au-delà de cette massification par le nombre, l’Université s’est encore peu démocratisée. Beaucoup plus que les classes sociales les plus défavorisées, ce sont les classes moyennes qui profitent de l’amorce de démocratisation. De multiples inégalités persistent : salariat étudiant, poursuite d’étude selon l’origine sociale, selon le sexe… . De plus, l’Université remplit de plus en plus difficilement son rôle ” d’ascenseur social ” et ne garantit plus une éclatante trajectoire professionnelle ou une protection contre le chômage.
Le milieu étudiant change aussi durant cette période. Les thèmes de mobilisation du début des années 70, c’est à dire la défense de grands principes et l’engagement en faveur de projets alternatifs, laissent progressivement la place à deux sentiments : la peur de la récupération politique et la peur de ne pouvoir rentrer dans la vie active de façon satisfaisante. A partir du milieu des années 80, le monde étudiant développe une forte capacité mobilisatrice si les valeurs auxquelles il est attaché sont remises en cause, c’est à dire la liberté et l’égalité d’accès à l’Université. le monde étudiant se mobilise désormais sur des revendications concrètes.
L’Université et le milieu étudiant des années 70 et 90 apparaissent peu favorables au syndicalisme étudiant. Pourtant, celui-ci s’adapte à ce nouveau contexte. Ainsi, l’A.G.E.L-U.N.E.F trouve très rapidement sa place au sein du mouvement étudiant. Certes, elle doit vite abandonner ses velléités de contrôle du mouvement étudiant, mais elle garde néanmoins un rôle essentiel à travers l’information des étudiants, sa place dans les coordinations… .