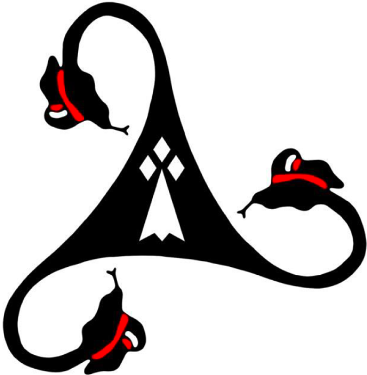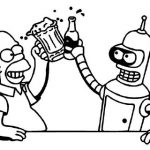Document écrit par par Thierry KESSLER, ancien étudiant en médecine de Rennes. Téléchargement du pdf en fin de page ![]()
L’Association Amicale des Étudiants en Médecine de Rennes (AAEMR) s’inscrit dans la conception apolitique de l’engagement étudiant. Elle participe à la vie de la faculté de Médecine non seulement par ses services, mais aussi par la présence de ses représentants dans les Conseils statutaires de l’université de Rennes I. L’AAEMR est également soucieuse de préserver un certain esprit estudiantin ainsi que ses traditions. L’analyse de quelques événements qui ont marqué son histoire depuis 1986 correspond, d’une certaine manière, à un album de photographie éclairé d’une expérience personnelle.
Introduction
Le monde étudiant est parfois difficile à comprendre pour celui qui ne sait pas le regarder. Il s’organise de nos jours autour de deux pôles : l’un syndical, l’autre associatif.
Leurs objectifs ne sont pas réellement antinomiques car tous œuvrent dans la défense des intérêts des étudiants. Par contre, leurs conceptions de l’engagement étudiant diffèrent. Le pôle syndical s’inscrit dans des actions plutôt conflictuelles et volontiers partisane, désireux de défendre ainsi l’ensemble des étudiants de France. Le pôle associatif se développe quant à lui sur une vision nettement plus corporatiste et apolitique, empreint d’un certain conservatisme.
Cet état de fait est l’aboutissement d’un siècle d’engagement étudiant. Il est en effet impossible d’aborder et de comprendre ces deux pôles sans références aux principaux événements historiques et sociologiques qui ont balayés l’histoire de France au XXe siècle. Certaines périodes ont contribué plus que d’autres à faire évoluer les prises de position des responsables étudiants. Contre toute attente, ce ne sont pas les manifestations étudiantes de mai 68 mais l’affirmation du désaveu du colonialisme lors de la guerre d’Algérie qui a provoqué cette scission du milieu étudiant. Par la suite, sous l’influence toujours plus grande de la politisation des structures syndicales, les conceptions partisanes et apolitiques des étudiants n’auront de cesse de s’opposer, amplifiées par une nécessité de reconnaissance par les pouvoirs publics.
L’Association Amicale des Étudiants en Médecine de Rennes (AAEMR) s’inscrit dans la conception apolitique de l’engagement étudiant. Elle participe à la vie de la faculté de Médecine non seulement par ses services, mais aussi par la présence de ses représentants dans les Conseils statutaires de l’université de Rennes I. L’AAEMR est également soucieuse de préserver un certain esprit estudiantin ainsi que ses traditions. L’analyse de quelques événements qui ont marqué son histoire depuis 1986 correspond, d’une certaine manière, à un album de photographie éclairé d’une expérience personnelle.
Plan – Sommaire
Chapitre I : Histoire du syndicalisme étudiant
1- Quelques aspects du monde étudiant avant 1907
2- L’entre-deux-guerres
3- L’occupation
4- La charte de Grenoble
5- La guerre d’Algérie
6- De la gauche extrême à mai 68
7- L’onde de choc de mai 68
8- La reconquête syndicale
9- Les grands derniers mouvements étudiants
Chapitre II : Le mouvement associatif étudiant
1- De la FNEF aux associations monodisciplinaires
2- L’ANEMF et la représentation des étudiants en médecine
3- L’association locale (la “corpo”)
– Et les étudiants
– Et la représentation universitaire
– Et les syndicats étudiants
– Et quelques actions revendicatives
– Et sa représentation nationale
– Et la tradition estudiantine
Conclusion
Chapitre premier
Histoire du syndicalisme étudiant
Quelques aspects du monde étudiant avant 1907
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’étudiant en France était considéré comme un privilégié. Issu principalement de la bourgeoisie, il bénéficiait même d’une certaine impunité. Ainsi, le jeune carabin montpelliérain, le béjaune (par contraction de bec jaune en référence aux jeunes oiseaux dont le bec est encore jaune) ne pouvait en aucune manière être mis à la porte de son logement avant la fin de ses études, était exempt d’impôts, même ses créanciers restaient à la porte ; son logeur se devait quant à lui de lui prêter son cheval pour qu’il se rende à ses cours.
Seuls quelques étudiants ayant trop abusé de leurs privilèges furent renvoyés de l’Université, pour des causes criminelles ou de mœurs (si l’on avait vu la femme d’un citoyen pénétrer dans sa chambre sans être accompagnée du recteur de l’Université). Nourri et logé, l’étudiant n’avait plus qu’à trouver son argent de poche, pour cela il avait notamment recours à deux jeux assez cruels : le “droit de barbe” et “la batacule” (Delubac H., op. cit., p.38).
Un Juif est-il rencontré en temps de carnaval par le cortège des étudiants, immédiatement il est saisi, traîné de force sur la place Saint-Pierre, et là rasé brutalement et fouetté au milieu des risées de la foule, à moins que le malheureux ne se rachète à beaux deniers comptants.
La batacule comporte la même cruauté.
Malheur à la femme impudique et malvivante, putain putante ou insigne maquerelle, qui se trouve sur le passage de la bande joyeuse. Quatre étudiants s’en emparent aussitôt, chacun se saisit d’une jambe ou d’un bras et la tenant ainsi suspendue, l’abaissent par trois fois sur le pavé contre lequel elle va frapper avec d’autant plus de violence que l’abaissement a été subit. À la troisième reprise, chacun lâche le membre qu’il tient et la patiente, meurtrie et en sang, n’a plus qu’à se relever et à demander grâce tandis que ses bourreaux s’en vont guerroyer ailleurs ou festoyer auprès de leurs belles.
À moins que la malheureuse ne se soit rachetée en payant un droit de rançon fixé par le vice-légat lui-même, à un écu par femme.
La révolution française allait faire disparaître ces mœurs condamnables. En effet, le décret du 15 septembre 1793 mit fin à l’enseignement supérieur en ces termes laconiques : Les facultés de théologie, de médecine, des arts et de droit sont supprimées sur tout le territoire de la République.
La loi du 10 mai 1806, voulue par Napoléon, créa l’Université Impériale de France, et permit l’unification définitive de l’enseignement supérieur, ses décrets d’application instituant quatre ordres de facultés (Lettres, Sciences, Droit et Médecine).
Les premières décennies de la Troisième République connurent de profondes réformes de l’enseignement supérieur. Les changements socio-économiques survenus en France renforcent l’attirance pour les diplômes universitaires et les carrières qu’ils ouvraient. Le recrutement universitaire connut à cette époque une croissance considérable. La Troisième République comptait imposer l’intégration sociale à travers l’éducation, l’Université étant censée effacer les divisions sociales et religieuses. Selon les responsables de l’époque, la sociabilité étudiante passait par la mise en place d’associations étudiantes comme il en existait en Allemagne ou en Angleterre.
Jusqu’alors, par crainte d’opposition et de violences étudiantes coordonnées, les autorités universitaires et politiques rendaient extrêmement difficile la constitution d’organisations étudiantes.
C’est en 1876 qu’un groupe d’étudiants de Nancy fonde sans trop de difficultés, un cercle d’étudiants, et installe même une bibliothèque. Évitant soigneusement les discussions politiques ou religieuses, ce cercle se transforme en association, regroupe près de la moitié des étudiants de la ville et devient un modèle pour les étudiants des autres villes.
Ainsi naissent des Associations Générales des Étudiants (AGE) à Lille en 1878, à Bordeaux en 1882, à Paris en 1884, à Toulouse en 1886, à Lyon, Nantes et Montpellier en 1888. À la fin de 1888, la France compte déjà quinze AGE.
En cette année 1888 se tient également à Bologne (Italie) un congrès d’étudiants célébrant le VIIIe centenaire de la création de cette université. De nombreuses AGE y participent ainsi que d’autres associations d’étudiants des différents états européens.
L’AGE de Paris se nomme alors tout simplement l’A. Elle est fondée en 1884, après de nombreuses manifestations devant le bureau du journal le Cri du Peuple qui avait fait paraître un article insultant pour l’étudiant. Il déclarait en effet qu’il ne s’affirme guère que par une indécence de babouin greffée sur une bêtise de rhinocéros (Daniel G., op. cit., p.6). L’A entreprend alors de défendre les intérêts corporatifs des étudiants et reçoit même quelques subventions gouvernementales. Elle compte parmi ses membres fondateurs des personnalités comme Emile Zola, Jules Ferry ou encore Félix Faure. Elle évite toute controverse politique et religieuse et flirte même avec des personnalités proches du pouvoir, ne déviant jamais de la voie de la prudence et de la respectabilité. Pourtant, en 1893, après un bal d’étudiants particulièrement scandaleux, plusieurs membres honoraires sont contraints à la démission ; en effet quelques femmes à peine vêtues avaient été présentées, ce qui choqua fortement les ligues puritaines (Weisz G., op. cit., p.35).
L’affaire Dreyfus qui divise la société française en 1894 ne parvient même pas à ébranler cette position de neutralité, ce qui vaut à l’A un discrédit de la part des deux parties. Du point de vue politique, le pouvoir de l’époque considère pourtant que ces associations sont des échecs puisque de nombreux groupes politiques leurs font concurrence dans le milieu étudiant, ces AGE n’organisant que des bals de charité au lieu de stimuler le goût de la vie en commun et l’habitude de l’action de groupe. Les étudiants en médecine parisiens déclarent alors que l’A ne représente pas leurs intérêts et créent leur propre société indépendante en 1896 : L’Association Générale des Étudiants en Médecine de Paris (AGEMP). Cette initiative est suivie peu après par les étudiants en pharmacie.
Les étudiants en médecine et en droit ont déjà à l’époque un goût très vif pour la protestation. Les brutalités policières contribuent alors aux déchaînements des passions. Ils s’identifient volontiers aux partis progressistes et réagissent souvent violemment lorsqu’un enseignant progressiste est révoqué ou lorsqu’un professeur trop proche d’un régime qu’ils méprisent, est nommé. Un professeur d’anatomie se retrouve même séquestré dans son laboratoire, les étudiants l’accusant d’autoritarisme et de favoritisme dans le choix de ses assistants (Weisz G., op. cit., p.41 : une cible constante de protestation étudiante fut, par exemple, Adolphe Nicholas, nommé professeur d’anatomie en 1907. Selon les rapports de police, des manifestations pour protester contre sa nomination semblent avoir été organisées par quelques agrégés parisiens furieux d’avoir été évincés pour le poste en faveur de quelqu’un qui avait été recruté à la faculté de médecine de Nancy.).
La loi sur la liberté d’association préparée par Pierre Waldeck-Rousseau alors qu’il était président du Conseil et ministre de l’Intérieur est promulguée le 1er juillet 1901. Elle met fin au système de l’agrément du gouvernement, nécessaire pour les associations de plus de vingt personnes.
Une association royaliste dirigée par Charles Maurras voit le jour en 1902 : l’Action Française (AF). L’AF ne représente que peu d’étudiants mais exploite leurs griefs à ses propres fins. Les étudiants en médecine et en droit aspirant à s’intégrer à la bourgeoisie, ils se sentent particulièrement menacés par la politique radicale d’éducation (réforme du baccalauréat en 1902 et “Nouvelle Sorbonne”). L’AF parvient alors à canaliser le mécontentement diffus et parvient, aidée de petits groupes extrémistes, à établir un climat de violence et de chaos sur la rive gauche.
L’exemple le plus patent reste les événements de février 1902. Un règlement entré en vigueur trois ans auparavant accroissait les difficultés à se présenter aux examens après un premier échec. Les étudiants devaient attendre trois à six mois avant de pouvoir repasser leurs épreuves, ce qui pour certains reculait l’obtention du diplôme de médecin au-delà de 27 ans, âge limite pour l’exemption partielle du service militaire. Une commission de réforme créée pour l’occasion par les étudiants en médecine en profite alors pour revendiquer la gratuité des cours, des conditions d’études plus favorables dans les laboratoires, ainsi que l’admission des étudiants dans les Conseils d’université. Le désir de cogestion apparaît à ce moment dans les revendications étudiantes. Devant le refus de l’administration d’abroger le règlement incriminé, les manifestations se poursuivent toute l’année, les étudiants carabins ferment la faculté en janvier 1903 et demandent la démission du Doyen pour sévérité excessive en matière de discipline. Ils sont bientôt rejoints par les étudiants en droit et de l’école des beaux-arts dans une manifestation massive de plus de 2000 personnes. La police arrête près de 200 personnes, le préfet de police écrit dans un rapport fin janvier, une fois le calme revenu, que peu d’entre eux étaient étudiants et que l’agitation avait été fomentée par des groupes nationalistes et antisémites (Weisz G., op. cit., p.39).
Ce malaise des étudiants en médecine et en droit est avant tout l’expression d’une crise évidente de la formation et de la surpopulation qui atteint les facultés parisiennes à cette époque. Les mauvaises conditions d’études, l’insalubrité des logements étudiants, le manque de moyens alloués à l’université poussent les étudiants à se regrouper pour se défendre.
C’est ainsi que les 3 et 4 mai 1907 se réunissent à Lille de nombreux représentants des AGE de France et fondent l’Union Nationale des Associations Générales Étudiantes communément appelée l’Union Nationale des Étudiants de France (UNEF). L’UNEF aura une position prépondérante dans l’histoire du syndicalisme étudiant au cours du XXe siècle.
L’entre-deux-guerres
Les cursus universitaires définis entre 1880 et 1914 ne vont que peu évoluer dans l’entre deux guerres. Par contre les variations des effectifs sont spectaculaires. En 1914, la mobilisation des soldats touche le milieu universitaire (étudiants et enseignants) et aboutit à une baisse de 74 % des effectifs. Le retour aux effectifs d’avant guerre ne se produit qu’à la rentrée 1920. Par la suite, on assiste, durant cette période de l’entre-deux guerres, à un doublement du nombre d’étudiants (en partie consécutif à un accès plus important des femmes à l’enseignement supérieur), plus spécifiquement au profit des facultés de lettres et de sciences, sans qu’aucune politique gouvernementale n’intervienne en faveur de la construction de locaux ou de logements étudiants. L’UNEF fait alors du développement de l’Université et de la représentation étudiante en son sein, l’essentiel de son action revendicative.
L’UNEF, par l’intermédiaire des AGE s’intéresse de près aux revendications étudiantes au sortir de la guerre 1914-1918. En effet, le monde étudiant sort profondément traumatisé des épreuves de cette guerre. Les étudiants anciens combattants réintègrent les facultés dans un esprit très revendicatif, désirant améliorer leur condition sociale. Dans de nombreuses villes, les AGE sont alors à l’origine de la création de restaurants universitaires (comme à Lyon, Lille, Dijon, Grenoble ou Strasbourg) à partir de 1921, mais aussi de cités universitaires au bénéfice des étudiants les plus démunis. Les locaux des AGE se transforment en véritable maison de l’étudiant rendant des services multiples (bureau de placement, polycopiés, tarifs réduits, office de sport, office du tourisme universitaire-OTU…) (Cluzel A., La lente maturation des organisations étudiantes, site internet transfac); certaines possèdent même un bar et des salles de travail. Les AGE sont considérées comme des cercles où se développe la camaraderie, où sont perpétuées certaines traditions estudiantines (Monchablon A., Les Cahiers du GERME, spécial N°3, site internet du GERME). Sous la pression des dirigeants de l’UNEF, le ministère de l’Instruction publique inscrit à son budget dès 1921, un crédit alloué aux œuvres sociales étudiantes.
En effet, depuis la fin de la guerre, l’image de l’étudiant au sein de la société a fortement évolué. Au cours des années vingt, en conséquence de l’élargissement social du recrutement universitaire, l’étudiant favorisé, issu des classes bourgeoises, se fait proportionnellement plus rare. Il est rejoint par de nombreux étudiants, moins favorisés, obligés de travailler le soir pour subvenir à leurs études, logés dans des conditions insalubres. La société française découvre alors ce que d’aucuns appelleront “l’étudiant pauvre”. Cette notion provoque l’inquiétude dans la presse étudiante puisque L’Etudiant Français, journal des étudiants de l’Action Française, ainsi que Les Nouveaux Etudiants, journal de l’Union Fédérale des Étudiants (UFE, association parisienne fondée en 1926, proche du parti communiste, et, bien que peu représentative, concurrente de l’UNEF à l’époque) s’en émeuvent (Fischer D., op. cit., p.29). Les sommes allouées par le gouvernement pour les œuvres sociales étudiantes deviennent alors de plus en plus importantes, et une commission des recteurs est bientôt créée afin de gérer ces fonds. Durant cette même période, le ministère de l’Instruction publique inscrit à son budget le prêt d’honneur, prêt sans intérêt, accordé aux étudiants en difficulté, et remboursable une fois les études terminées. La paupérisation du milieu étudiant préoccupait donc quelque peu les pouvoirs publics.
Mais, plus grave encore que cette paupérisation, l’UNEF se rend compte que l’état de santé des étudiants se dégrade. En effet, la tuberculose fait des ravages dans les universités. Une fondation est donc décidée au congrès de l’UNEF à Clermont-Ferrand en mai 1923 : la Fondation Sanatorium des Etudiants de France à Saint-Hilaire-du-Touvet près de Grenoble. Le journal de l’AGE de Bordeaux rendait compte ainsi de la résolution adoptée (Bordeaux Étudiant, Novembre 1924, in Fischer D., op.cit p.42):
Il faut aux étudiants tuberculeux une maison à eux ! Une maison où ils mèneront leur cure dans une atmosphère morale qui en favorisera les résultats, où ils trouveront les ressources leur permettant de concilier avec leur état et son traitement la continuation au moins partielle de leurs études (…). Il y a plus : pour certains d’entre eux, les étudiants en médecine, le sanatorium en leur rendant la santé, leur dispensera les moyens d’apprendre à la rendre à autrui.
Pour autant sa construction fut longue et difficile puisque le sanatorium étudiant ne reçut ses premiers malades qu’en 1933 en raison des nombreux problèmes de financement des travaux et malgré une mobilisation forte des étudiants par le biais d’organisations de quêtes, de souscriptions, de bals, de spectacles, de kermesses. Cette action sociale de l’UNEF au bénéfice des œuvres universitaires lui vaut l’honneur d’être reconnue d’utilité publique le 10 mai 1929. Cette reconnaissance attire l’attention de certaines organisations politiques sur le monde étudiant. C’est pourquoi sont alors successivement créées en 1929, l’Union des Étudiants Communistes (UEC) et la Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC), elle-même calquée sur l’organisation de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne fondée en 1927. L’UEC et la JEC ne sont pas réellement concurrente de l’UNEF. Il s’agit plutôt de courants de pensée qui marqueront de leur influence les débats au sein de l’UNEF.
En plus de son action sociale, l’UNEF veut faciliter l’accès de tous à l’Université française, quelles que soient les ressources. Certes la gratuité de l’enseignement secondaire, la mise en place des œuvres universitaires, la féminisation des études supérieures (plus difficilement acceptée par les professeurs que par les étudiants) y ont contribué. Mais au-delà, ce que veut obtenir l’UNEF, c’est la démocratisation de l’institution universitaire. Il est vrai que depuis 1921, les étudiants sont représentés dans les conseils de discipline des facultés, mais ils désirent surtout participer à la gestion des universités par le biais des conseils centraux, et avec voix délibérative ! Ce principe de cogestion des universités est refusé par le ministère de l’Instruction publique, et restera une revendication essentielle de l’UNEF.
Pourtant l’UNEF connaît bien les rouages du fonctionnement de la IIIe République.
Jamais elle n’eut besoin de faire descendre les étudiants dans la rue pour accéder à ses revendications. Hormis le désir de cogestion, l’attitude de l’UNEF consiste à satisfaire les intérêts matériels des étudiants en étant très proche des pouvoirs publics, s’organisant comme un véritable groupe de pression. Cette attitude bienveillante des responsables étudiants à l’égard du pouvoir en place, associant des revendications corporatives et un certain apolitisme, est appelé le corpolitisme (Néologisme emprunté à Fischer D., op. cit.) et vaudra à l’UNEF de vives critiques à la Libération.
L’occupation
Le corpolitisme de l’UNEF ne se modifie pas sous l’occupation allemande. L’UNEF continue à exister comme auparavant, ne prenant position ni au moment de la déclaration de guerre, ni lors de la défaite, ni au moment des déportations, ni à la Libération (Borella F. et De la Fournière M., op. cit., p.44). L’objectif de l’UNEF est clair : conserver les avantages sociaux acquis pendant l’entre-deux-guerres et s’adapter au nouveau régime en place afin que les étudiants souffrent le moins possible de la nouvelle situation, il s’agit de maintenir l’UNEF pour maintenir les œuvres (Propos tenus en 1939 par Rosier A., directeur du Bureau Universitaire des Statistiques (BUS), in Fischer D., op. cit., p.47).
Malgré cette bienveillance envers le régime de Vichy, l’UNEF, comme de nombreux autres syndicats, se voit frappée en 1941 par un décret de dissolution, son origine républicaine lui étant reprochée. Ce décret ne sera jamais signé. Cependant cet épisode contribue fort probablement à pousser quelques dirigeants de l’UNEF à accepter le maréchalisme, et à épouser les thèses de la Révolution Nationale, c’est-à-dire d’enrôler, de discipliner, de modeler la jeunesse. Ainsi, des responsables de l’AGE de Montpellier vont jusqu’à proposer que le secrétaire général de l’AGE soit nommé et rémunéré par le recteur, et que le président de l’UNEF le soit par le ministre de l’Instruction publique.
Cette proposition est fort heureusement repoussée par une majorité des représentants des AGE.
L’UNEF participe alors au “rêve vichyssois” de créer au sein de l’Université une communauté des maîtres et des étudiants vivant ensemble une grande partie de l’année. Dans l’intention de contrôler davantage encore la jeunesse étudiante dans l’organisation corporative de la société, le gouvernement de Vichy fonde le 11 novembre 1940, à Paris, la toute première maison d’étudiants, qui abrite une corporation fédérant toutes les associations étudiantes existantes. Afin de réduire l’influence de l’UNEF au sein de l’Université, le gouvernement de Vichy met en place, en 1941, le Service National des Étudiants (SNE), structure ayant pour but de rallier le monde étudiant au régime en leur assurant une formation morale et civique. L’UNEF perd alors sa participation aux œuvres, ainsi que la précieuse subvention d’État.
Dans le souci de préserver son existence légale, l’UNEF ne cesse de donner des gages de bonne conduite au régime Pétainiste. L’AGE d’Alger est ainsi à l’initiative, au congrès de Tain en 1941, du numerus clausus envers les étudiants juifs (fixé à 3 %) (Fischer D., op. cit., p.47). Toujours dans le même esprit, les dirigeants de l’UNEF ne s’opposent pas à l’instauration du Service du Travail Obligatoire (STO) mais tentent simplement d’en atténuer les conséquences et l’application sur le monde étudiant.
Cependant, il serait inexact de considérer l’UNEF comme une organisation qui a collaboré. En effet, elle soutient clandestinement la “marche à l’étoile”, manifestation étudiante sur la tombe du soldat inconnu organisée par François de Lescure le 11 novembre 1940, faisant suite à l’arrestation du professeur Langevin quelques jours auparavant (Témoignage de F. de Lescure (père de l’ancien PDG de canal +) in Merceron S., Les Cahiers du GERME n°1, site internet du GERME). De même, l’AGE de Grenoble entretient clandestinement des relations étroites avec le maquis du Vercors. D’une manière générale, les AGE (et donc l’UNEF) peuvent être critiquées pour leur passivité politique, alors qu’à titre individuel, de nombreux étudiants entrent dans la Résistance ou la clandestinité. Les étudiants issus de la JEC et de l’UEC payent même un lourd tribu, de nombreux camarades disparaissent au combat. Ces deux courants, à l’origine en octobre 1943 de l’Union des Étudiants Patriotes (UEP) fondent en février 1945, en association avec l’UNEF et la Fédération Française des Étudiants Catholiques (FFEC), l’Union Patriotique des Organisations Étudiantes (UPOE).
Ainsi, à la Libération, les autorités administratives, loin de vouloir dissoudre l’UNEF, se refusent tout de même à lui rendre sa place d’avant-guerre, malgré une excellente implantation de l’association dans les universités puisque 20 000 étudiants en sont toujours membres par le biais des AGE. Le 16 mai 1945, le décret “Capitant”, du nom du ministre de l’Éducation nationale du gouvernement provisoire, ouvre la possibilité aux étudiants d’élire des représentants pour assister à certaines réunions des conseils d’université, avec uniquement un droit de parole, sans voix délibérative. Mais, contrairement à la cogestion des œuvres de l’entre-deux-guerres, ces étudiants ne sont pas issus des rangs de l’UNEF mais de ceux de l’UPOE. Les dirigeants de l’UNEF, mécontents de cette situation, reprochent alors à l’UPOE son caractère parlementaire qui conduit à la paralysie de l’organisation. La cogestion étudiante instaurée par le décret “Capitant”, leur paraît également très insuffisante.
C’est pourquoi, l’UNEF juge nécessaire de rompre avec le corpolitisme de l’entre-deux guerres, responsable à ses yeux de l’attentisme frileux pendant l’Occupation, et adopte le 24 avril 1946, à Grenoble, une orientation nettement plus syndicale et contestataire.
La charte de Grenoble
Le congrès de Grenoble, le 24 avril 1946, est le premier congrès de l’UNEF de l’après-guerre. Les dirigeants de l’organisation étudiante font table rase de l’attitude de l’UNEF depuis sa création et s’orientent vers une action plus syndicale. Ils veulent en effet participer à l’effort de reconstruction du pays, et rendre à l’étudiant la place qu’il mérite au sein de la société. Ils élaborent un texte référence du syndicalisme étudiant : la charte de Grenoble (annexe 1).
Dans son article premier, la charte revendique que l’étudiant est un jeune travailleur intellectuel. Jeune, l’étudiant a droit à une prévoyance sociale particulière dans les domaines physiques, intellectuel et moral. Il est demandé à la société de reconnaître et protéger l’étudiant, sans que celui-ci en soit marginalisé. Jeune, l’étudiant a le devoir de s’intégrer à l’ensemble de la jeunesse nationale et mondiale. Dans le contexte de guerre froide qui s’est installée depuis 1945, l’étudiant se doit de participer aux associations nationales et internationales afin de promouvoir un idéal pacifiste. L’UNEF est d’ailleurs à l’origine en 1946, de l’Union Internationale des Étudiants (UIE) (L’UIE est la résultante de l’idéal pacifiste du milieu étudiant de l’immédiate après-guerre. Une prise de pouvoir progressive des étudiants communistes l’engage, au début de la guerre froide, de plus en plus en faveur du bloc de l’Est. L’absence de dénonciation du “coup de Prague” en février 1948 aura pour conséquence le retrait des organisations étudiantes de l’Ouest, dont l’UNEF en 1949. Elle ne représentera plus, dès lors, que les étudiants communistes. D’après Fischer D., op. cit., p.149-161).
Travailleur, l’étudiant a droit au travail et au repos dans les meilleures conditions et dans l’indépendance matérielle, tant personnelle que sociale. L’étudiant doit donc être reconnu comme partie de la fraction active de la société, et donc bénéficier des mêmes avantages sociaux, notamment de la sécurité sociale. Travailleur, l’étudiant a le devoir d’acquérir la meilleure compétence technique. De cette notion d’étudiant travailleur découle une revendication forte de l’UNEF dans l’immédiate après-guerre: l’allocation d’études ou présalaire.
Intellectuel, l’étudiant a droit à la recherche de la vérité et à la liberté, ainsi qu’il se doit de chercher, de propager et de défendre la vérité (…), de défendre la liberté contre toute oppression, ce qui, pour l’intellectuel, constitue la mission la plus sacrée. Il est en effet primordial d’éviter les errements connus durant la Seconde Guerre mondiale. Intellectuel, l’étudiant se doit donc de s’engager, de faire partager et progresser la culture et de dégager le sens de l’histoire. Ceci laisse entendre la volonté d’intervenir dans la vie politique au nom du devoir moral de l’intellectuel et de réformer la société.
Pour autant, au sortir du congrès de Grenoble, l’Université est à reconstruire. Professeurs comme étudiants, toutes les composantes de l’enseignement supérieur s’accordent à constater l’inadaptation de l’Université. En effet, les locaux sont exigus, certains sont insalubres, les pénuries de matériel et de personnel sont flagrantes, la formation des étudiants est médiocre (hormis dans les facultés dites professionnelles : Médecine, Pharmacie, Droit), la formation des chercheurs est insuffisante.
L’UNEF, devant ce sévère constat, se fait le porte-parole des contestations étudiantes en faveur de l’amélioration des conditions matérielles d’étude. Ainsi, lorsqu’il est question, en mai 1947, d’augmenter les droits d’inscription et de réduire fortement les crédits alloués aux bourses, ce sont plusieurs milliers d’étudiants qui descendent dans la rue pour s’opposer à la réforme du premier gouvernement de la Quatrième République. Devant cette preuve de force et après deux jours de paralysie de l’Université, non seulement le gouvernement Ramadier revient sur sa décision mais il annonce en plus le doublement du taux des bourses.
Malgré la charte de Grenoble, l’UNEF ne s’obstine pas dans une contestation syndicale systématique, même si la diversité du recrutement estudiantin sous-entendue par la charte de Grenoble, tarde à être admise, faute de moyens. Il est vrai que se retrouvent à la tête de l’UNEF des étudiants issus de la JEC (les jécistes), du mouvement radical ou encore socialiste. Cette composante majoritaire prône une attitude gestionnaire et apolitique pour régler les conflits étudiants (encore appelée tendance majo). Seule la composante UEC, présente dans quelques AGE, se montre nettement plus activiste et prône une politisation du monde étudiant (ou tendance mino). Les étudiants communistes se montrent très actifs pour défendre leur vision de la guerre froide, leur soutien à l’URSS, leur position sur la décolonisation, leurs opinions syndicales et culturelles. Ainsi, fin 1947, ce ne sont pas moins de 24 cercles d’étudiants communistes qui ont été créés à l’Université, cercles où se déroulent des débats passionnés. Un journal est alors publié, Clarté, dont le lectorat dépasse largement les confins du communisme.
Dans ce contexte, en mai 1947, les dirigeants du Rassemblement du Peuple Français (RPF), afin de contrer la propagande communiste au sein des facultés, fondent le Groupement National des Etudiants RPF. La greffe gaulliste prend en quelques mois à l’Université et offre à certains étudiants, et pour quelques années une alternative crédible au communisme.
L’UNEF reste à l’écart de ces discours partisans. Fidèle à la tendance majo, elle gère les dossiers étudiants dans un apolitisme total. D’ailleurs, les discours gaullistes ou communistes ne passionnent guère la majorité des étudiants, l’instabilité chronique de la Quatrième République ne favorisant pas la politisation de masse du milieu étudiant. Elle obtient en 1948 la création de la sécurité sociale étudiante : la Mutuelle Nationale des Étudiants de France (MNEF) voit le jour.
Cependant, ses relations avec le ministère de l’Éducation nationale se tendent parfois. Ainsi, en décembre 1953, devant l’insuffisance des crédits de l’Éducation nationale, plusieurs milliers d’étudiants se rassemblent devant la Sorbonne et sur le boulevard SaintMichel. À peine le cortège est-il constitué qu’a lieu une violente charge de la police (Le président de l’UNEF de l’époque, J.M. Mousseron fut même blessé lors de cette charge, in Fischer D., op. cit., p.121). Ces brutalités émeuvent fortement la presse et l’opinion publique, ce qui pousse le gouvernement radical-socialiste à octroyer une substantielle augmentation des crédits. Du fait de l’augmentation des effectifs universitaires, l’État fait certes un effort considérable en faveur des œuvres universitaires et de l’octroi des bourses à partir de 1952. Mais en 1955 le gouffre financier de la guerre coloniale en Indochine amenuise d’autant les budgets (Fischer D., op. cit., p.122-124) ; les crédits restent nettement insuffisants face aux besoins de l’enseignement supérieur.
Dans ce contexte, la nécessité d’une rémunération étudiante anime alors les débats, les AGE parisiennes de médecine, sciences et droit (alors dirigée par Jean-Marie Le Pen) se montrant plus que réservées.
La question coloniale commence aussi, à partir de 1955, à intéresser le monde étudiant.
Ainsi, au sein de l’UNEF, les jécistes et les étudiants radicaux se rapprochent des thèses anticolonialistes soutenues par les étudiants communistes depuis 1946. La Fédération Nationale des Étudiants Socialistes, dont Michel Rocard est le nouveau secrétaire général, affiche ouvertement son anticolonialisme et rallie à sa cause de nombreuses AGE. Un homme politique, Pierre Mendès France, soulève alors une vague d’espoir chez cette jeunesse peu intéressée par la politique de la Quatrième République, politique confisquée par les appareils partisans.
Ce radical socialiste, auréolé par son passé de résistant, séduit le monde étudiant.
L’éphémère président du Conseil porte quant à lui un grand intérêt à l’enseignement supérieur. En réponse à un courrier de l’UNEF peu avant son investiture (Fischer D., op. cit., p.83), il s’engage à dégager les moyens matériels indispensables à l’Université et affirme sa volonté d’aider la jeunesse à se préparer à faire la France de demain. Dans son “message à la jeunesse” en 1955, il écrit (Velluet C., op. cit., p.113) :
On dit souvent, selon une formule un peu banale, mais vraie, que vous êtes le sang nouveau qui peut revivifier la nation. Si demain les responsabilités doivent vous incomber, il n’est pas trop tôt pour en assurer d’ores et déjà une part, et plus importante que vous ne croyez. Mais il faut le faire très vite.
Sinon, un jour, vous trouverez écrasante la charge des hypothèques que vous avez laissé accumuler sur vous. Cela arriverait immanquablement, si vous permettiez que se gaspille et se perde la force vive dont vous disposez, si prenant prétexte de ce que l’État vous ignore ou vous néglige souvent, vous vous détourniez de la chose publique (…). Ainsi vous ne pouvez pas vous borner à répéter À quoi bon ?, vous devez vous employer dès maintenant à faire changer ce qui doit être changé.
Le Mendésisme pousse alors la jeunesse à comprendre les évolutions du monde qui l’entoure et représente certainement un signe avant-coureur d’une phase idéologique nouvelle.
Peu après la chute du gouvernement Mendès France, l’UNEF obtient le 16 avril 1955, gain de cause sur l’une de ses revendications principales des années cinquante. Elle obtient la cogestion paritaire du Conseil National des Œuvres, devenu depuis peu un établissement public doté d’une autonomie financière, ainsi que la création des 28 Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Sociales (CROUS). Toutefois, l’UNEF s’investit à peine dans les réformes qui restructurent l’Université de 1954 à 1958.
L’allongement des études, la création du propédeutique (Année de culture générale obligatoire pour les bacheliers candidats à la licence de 1948 à 1966.), la mise en place d’un troisième cycle dans les filières scientifiques et littéraires, la réforme des études médicales avec la création des Centres Hospitalo-Universitaires, la naissance du CNRS, le début de professionnalisation de certaines filières avec quelques stages en entreprise, rien ne retient l’attention de l’UNEF. Pourtant, lors du congrès de Grenoble en avril 1959, l’UNEF critique fortement l’inadaptation des structures de l’Université et réclame une réorganisation complète de l’enseignement supérieur et une décentralisation, et une politique de construction adaptée. Enfin, elle réaffirme ses revendications principales : l’allocation d’études et la cogestion des universités.
Cependant, depuis 1958, l’UNEF ne se contente plus de soutenir les intérêts du monde étudiant. Sous l’influence des jécistes et des radicaux en son sein, elle milite ouvertement en faveur de la décolonisation pacifique de l’Algérie. La politisation du monde étudiant semble de plus en plus inéluctable et la guerre d’Algérie va définitivement scinder l’UNEF.
La guerre d’Algérie
L’UNEF se s’intéresse donc à la question algérienne qu’à partir de 1958. Il est vrai que dans les années 1930, elle n’a pas remis en cause la “France de 104 millions d’habitants”, contrairement à sa concurrente directe, l’UFE, organisation d’obédience communiste.
Pourtant, l’UNEF participe déjà, dans la cour de la Sorbonne, à la première journée anticolonialiste le 21 février 1949, en commémoration du soulèvement des étudiants indiens contre l’empire Britannique l’année précédente. Le discours de son président n’en reste pas moins très prudent, se tenant à des principes universels de justice et d’égalité. Il est vrai que sans remettre en cause son action gestionnaire et apolitique, l’UNEF se doit, selon la charte de Grenoble, de défendre les intérêts des étudiants d’outre-mer, étudiants réunis depuis peu par un comité de liaison sous la présidence d’un jeune réunionnais,
Jacques Vergès. Au sein de l’UNEF, la présence d’un vice-président issu d’une association d’outre-mer est cependant considérée comme inutile par Bernard Pons, président de l’AGE de Montpellier et chargé des affaires coloniales à l’UNEF (Les étudiants d’outre-mer étant français, ils n’avaient donc pas besoin, d’après lui, d’une représentation particulière au sein de l’UNEF).
Comme nous l’avons déjà vu, la pensée mendésiste contribue dès 1955, à faire évoluer la position des étudiants sur le fait colonial (L’inflation du budget militaire (30% du budget national en 1956) par rapport au budget de l’Éducation nationale (9% à la même époque) conduit également les étudiants à s’intéresser aux questions politiques. Daniel G., Fischer D., Merceron S., Monchablon A., Raeis O., Tranoy S., Histoire des associations étudiantes françaises, site internet ifrance, p.18). Les étudiants jécistes et les radicaux sensibles à l’anticolonialisme prennent le pouvoir au sein de l’UNEF en juillet 1956. Associés aux étudiants communistes, la tendance mino devient donc majoritaire. Réaffirmant les principes de la charte de Grenoble, la JEC considère désormais que le syndicalisme étudiant, tout en restant indépendant des partis politiques, se doit d’être un syndicalisme engagé. Il s’agit là de la véritable fin du corpolitisme de l’UNEF, et le syndicat étudiant rentre alors dans le camp des opposants à la guerre d’Algérie.
En 1957, alors que l’opinion publique n’imagine pas encore une indépendance de l’Algérie, les jécistes dénoncent les méthodes de répression du gouvernement de Guy Mollet sur ce que l’on appelait encore pudiquement les événements d’Algérie, méthodes rapportées par les étudiants mobilisés. L’UNEF entretient également à cette période des relations ambiguës avec la toute nouvelle Union Générale des Étudiants Musulmans d’Algérie (UGEMA), à tendance fortement nationaliste, qui s’avère être une antenne du FLN (Fischer D., op. cit., p.221). Mais les relations entre les deux organisations cessent lorsque l’UGEMA demande à être reconnue comme association nationale et donc à remplacer l’UNEF sur le sol Algérien. On devine là, les limites de l’engagement du syndicat étudiant.
Le retour de De Gaulle en mai 1958 est considéré dans le milieu étudiant comme un danger pour la République. Ce fervent tenant de l’Algérie Française dans la pire tradition coloniale cristallise le monde étudiant contre la guerre d’Algérie. L’engagement de l’UNEF contre le pouvoir en place ravive alors la position de 18 AGE de la tendance majo qui menacent de faire scission si une certaine neutralité n’est pas respectée. Cette promesse de neutralité des dirigeants de l’UNEF ne sera pas tenue.
En août 1959 éclate l’affaire des sursis (Fischer D., op. cit., p.231). Le gouvernement veut en effet limiter, par décret, le report d’incorporation au contingent à 25 ans, sans attendre l’achèvement du cycle universitaire en cours. Plusieurs milliers d’étudiants sont alors menacés de prendre part au conflit. La mobilisation étudiante est donc très forte à la rentrée universitaire, les AGE de la tendance majo soutenant l’UNEF pour faire reculer le gouvernement. La représentativité de l’UNEF s’en trouve renforcée dans le monde étudiant, quelques grandes centrales syndicales rejoignent les positions de l’UNEF pour une solution négociée avec le FLN. L’UNEF devient alors un pôle de résistance à la guerre d’Algérie, et s’engage ouvertement en faveur de l’indépendance de l’Algérie. Le gouvernement retire son décret en mars 1960.
Dans la foulée, par mesure de rétorsion, le gouvernement supprime ses aides financières au syndicat. Cela dérange peu une UNEF qui compte désormais près de 100 000 adhérents (Au début des années soixante, près de 100 000 étudiants sur 215 000 possèdent la carte UNEF). La participation de l’UNEF à toutes les manifestations contre la guerre d’Algérie aux côtés des principales centrales syndicales enseignantes et ouvrières en 1961 lui font caresser le rêve de devenir une avant-garde fédératrice des forces de gauche.
Cependant, cette radicalisation de la tendance mino entraîne de manière inéluctable la radicalisation de la tendance majo, ce qui aboutit à la scission en juin 1961 (cette scission fut notamment l’œuvre des offices techniques de droit et de médecine restés aux mains de la tendance majo), et à la création de la Fédération Nationale des Etudiants de France (FNEF) fondée sur les bases d’un apolitisme affirmé.
Au moment de la signature des accords d’Évian en mars 1962, le rêve de la “grande UNEF” s’est donc envolé, l’organisation étudiante voit apparaître en son sein une gauche extrême, en rupture totale avec le pouvoir en place. La guerre d’Algérie a définitivement transformé la représentation étudiante.
De la gauche extrême à mai 68
Le traumatisme des guerres coloniales touche à sa fin. La croissance spectaculaire des effectifs de l’enseignement supérieur, que certains nomment sa massification, et l’entrée de l’extrême gauche au sein de l’Université conduisent de manière inexorable aux événements de mai 1968.
L’attitude militante des étudiants jécistes au sein de l’UNEF, leur position ouvertement anticolonialiste, valent à la JEC la réprobation de sa hiérarchie, c’est-à-dire de l’épiscopat français. L’assemblée des cardinaux tente donc entre 1960 et 1965 de reprendre en main l’organisation étudiante. Il en est de même pour les étudiants issus de l’UEC. La hiérarchie du PCF ne peut tolérer plus longtemps la critique ouverte du stalinisme que font les étudiants communistes.
Vidée de ces deux principales composantes de la tendance mino, séparée depuis peu de sa tendance majo, l’UNEF (qui revendique au sortir de la guerre d’Algérie la moitié des effectifs étudiants) s’affaiblit au fil des années, alors que les étudiants n’ont jamais été aussi nombreux.
L’accroissement des possibilités de scolarisation dans l’enseignement secondaire contribue, au même titre que l’allongement des cursus, la reprise démographique du baby-boom et la féminisation, à la massification des études supérieures. Les effectifs ont plus que doublé de 1960 à 1968, et l’Université atteint les limites de ses capacités d’accueil.
L’UNEF édite en 1964 son Manifeste pour une réforme démocratique de l’enseignement supérieur. L’autorité professorale est remise en cause, le contrôle continu y est préféré à la sanction des examens, les groupes de travail universitaire remplacent les cours magistraux, l’Université révolutionnaire doit remplacer l’Université libérale existante.
Devant la montée proportionnelle des classes moyennes, l’UNEF y réaffirme sa revendication d’allocation d’études, complétée par une allocation pour le logement, identique à celle dont bénéficient certains ouvriers dans les HLM (Fischer D., op. cit., p.268).
Le gouvernement Pompidou refuse d’entendre parler de ces allocations et préfère axer sa politique sur un effort massif de construction de cités universitaires, de nombreuses facultés. Il a pour sa part déjà préparé une réforme de l’enseignement supérieure : la réforme Fouchet. Les cursus sont désormais organisés en trois cycles, la spécialisation scientifique et professionnelle des filières est instaurée, la sélection à l’entrée de l’Université, un temps proposée, est finalement abandonnée. Malheureusement, faute de moyens, elle accroît le déficit d’encadrement dont souffre déjà l’Université, et, la rigidité du cadre pédagogique qu’elle entraîne, favorisent le mécontentement des étudiants.
En réponse à ce refus du ministère d’accorder une allocation d’étude, le syndicat
s’enferme dans une politique de contestation globale ; on parle même de “syndicaloterrorisme” (Il s’agit de mettre en place des “structures de déséquilibre” (jargon marxiste)in Daniel G., Fischer D., Merceron S., Monchablon A., Raeis O., Tranoy S., Histoire des associations étudiantes françaises, site internet ifrance, p.21) . C’est la politique du pire, dont le but est de saboter les mécanismes d’aide aux étudiants pour en prouver l’inefficacité et en demander le remplacement par des mécanismes nouveaux tel un présalaire. Cette attitude a de lourdes conséquences puisque la cogestion du Centre National des Œuvres (CNO) s’en trouve entravée. Le gouvernement décide alors de réformer le fonctionnement de ce Centre, en diminuant la part des étudiants dans sa gestion. L’attitude contestataire de l’UNEF remet donc en question des conquêtes de ses actions syndicales passées.
De 1965 à 1968, de nombreux groupements politiques d’extrême gauche s’engouffrent dans les espaces politiques laissés vacants par la JEC et l’UEC. Ainsi, le départ des contestataires de l’UEC entraîne la création en 1966 de deux organisations rivales, la Jeunesse Communiste Révolutionnaire (JCR- tendance Trotskiste) et l’Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Léninistes (UJCML- tendance Maoïste) ; ces étudiants restant tout de même attachés aux grands principes démocratiques. Avec d’autres groupuscules gauchistes, dont les étudiants sympathisant du PSU, ils prennent le pouvoir au sein de l’UNEF par une forte infiltration encore appelée “entrisme”. Ils parviennent également à pousser à la démission certains dirigeants d’AGE influentes au sein de l’organisation étudiante. C’est ainsi que Brice Lalonde est remercié du bureau de la Fédération Générale des Étudiants en Lettres (FGEL) à la Sorbonne. Ces groupuscules orientent alors l’UNEF vers une “gauche syndicale” et désirent avant tout transformer le potentiel militant étudiant en un syndicalisme orienté vers une restructuration de la société sur des bases révolutionnaires. Cependant, la stérilité des discours théoriques, les tentatives de rapprochements avec les syndicats ouvriers font fuir la grande majorité des étudiants. Les effectifs de l’UNEF fondent comme neige au soleil et de nombreuses AGE sont en décomposition (Historique du mouvement syndical à Lyon et en France, site internet de Lyon-UNEF, p.9. L’UNEF connaît même à cette période de graves problèmes de trésorerie).
Dans l’année 1967, les événements internationaux pèsent sur le monde étudiant. Che Guevara est assassiné en Bolivie, Israël déclenche la Guerre des Six Jours, la guerre du Vietnam est à son paroxysme. Les étudiants manifestent à Rio, Berlin, Madrid ou encore Tokyo contre l’impérialisme américain. Quant aux étudiants américains, ils remettent ouvertement en cause la politique de leur gouvernement. En France, le monde étudiant n’échappe pas non plus à la dichotomie issue de la guerre froide. Ainsi se forment dans de nombreuses facultés des “comités Vietnam”, l’opposition contre l’impérialisme américain étant organisée par les étudiants révolutionnaires et conduisant souvent à des affrontements avec les étudiants pro-américains ou de l’extrême droite.
De nombreux courants de pensée naissent à cette période. L’antipsychiatrie, courant né à Londres, fait son apparition en France sur le thème de la violence de la psychiatrie comme outil de la répression sociale de la folie, trouvant une certaine écoute parmi les étudiants depuis la création des Bureaux d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU). Un autre courant, le courant libertaire se distingue par le désir d’émancipation sexuelle qui frappe les cités universitaires, se heurtant aux valeurs morales du gaullisme. Les étudiants libertaires, souvent proches des courants anarchistes et gauchistes, prônent la liberté sexuelle, contestent le mariage, la famille, l’éducation, l’organisation de la société.
Ils sont adeptes du “flower power” et manient à qui mieux mieux la dérision, l’art du détournement et du contre-pied. Bien que minoritaire au sein de l’Université, le courant libertaire fera les beaux jours de l’insolence de la jeunesse étudiante de mai 68.
En ce début 1968, la France s’ennuie comme le titre Le Monde. À la faculté de Nanterre, les étudiants écrivent sur certains murs : Ne vous emmerdez plus, emmerdez les autres !,
L’imagination au pouvoir, A toi l’angoisse, à moi la rage. Certes, le 20 mars, quelques étudiants manifestent, à l’appel du “comité Vietnam”, contre la guerre, mais rien ne laisse présager ce qui va venir. À la suite du saccage de la devanture de l’agence American Express, la police intervient et arrête quelques manifestants dont un étudiant de Nanterre.
C’est l’émoi parmi les militants de la faculté, qui exigent sa libération. Celle-ci n’étant toujours pas intervenue le 22 mars, un groupe d’étudiants de toutes tendances,confondues, emmené par Daniel Cohn-Bendit, décide d’occuper les locaux administratifs de la faculté. Ils appellent dans un manifeste à discuter de tous les problèmes du moment à l’Université où doit, selon eux, se développer l’action. Leur camarade est libéré dans la nuit. Pour autant, le mouvement du 22 mars poursuit son action tout au long du mois d’avril, organise des Assemblées Générales (AG), perturbent des cours, clament des maximes (Il est interdit d’interdire), éditent un bulletin (le premier contient la recette du cocktail Molotov). Ainsi créée, l’agitation de la faculté risque d’aboutir à n’importe quel moment à des affrontements avec des étudiants d’extrême droite, c’est pourquoi le doyen Grappin décide la fermeture de sa faculté le 2 mai, espérant ainsi rétablir le calme avant les examens.
Le vendredi 3 mai, l’UNEF proteste contre la fermeture abusive de la faculté de Nanterre et appelle à la grève. La contestation sort donc du campus et gagne le quartier latin où unmeeting est organisé à la Sorbonne. La rumeur d’une agression par des étudiants d’extrême droite agite l’auditoire. La décision d’occuper la Sorbonne est prise, les étudiants préparent leur défense en empilant des tables et des chaises. L’affrontement n’aura pas lieu mais les forces de police reçoivent l’ordre de faire évacuer les lieux et procèdent à trois cents interpellations. La Sorbonne, une fois évacuée, est fermée. La colère s’empare alors des étudiants, qui, au cri de libérez nos camarades, sont bientôt rejoints par des milliers d’autres. Ainsi s’enclenche le cycle provocation-répression mobilisation. Dans l’après-midi ont lieu de violents affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants et, à la tombée du jour, le quartier latin ressemble à un véritable champ de bataille.
Sur les six cents manifestants interpellés, treize sont inculpés et quatre sont condamnés à de sévères peines dans les quarante-huit heures (trente-deux mois de prison ferme). Le mouvement s’organise et demande alors, en plus de la libération et de l’amnistie des étudiants, la réouverture de la Sorbonne et le retrait des forces de polices du quartier latin, lequel est devenu depuis ce 3 mai une zone interdite aux étudiants. Les journalistes s’indignent de cette intervention de la force publique, matraque à la main, à la Sorbonne, haut lieu de culture, et qui, dans la tradition universitaire, bénéficiait jusque-là d’une certaine forme d’extraterritorialité.
Le lundi 6 mai, tandis que Daniel Cohn-Bendit passe avec certains de ses camarades en conseil de discipline, la révolte des étudiants parisiens gagne la province. Les villes de Bordeaux ou de Nantes voient aussi leurs étudiants battre le pavé. Il faut dire qu’elles avaient déjà été secouées en février 1968 par des manifestations en faveur de la liberté sexuelle et l’autogestion des cités universitaires, les étudiants réclamant également une augmentation des bourses et refusant un enseignement “à la solde d’une économie capitaliste”. Puis, dans les jours suivants, ce sont les étudiants de Lille, Lyon, Toulouse, Rennes qui entrent en rébellion, avant d’être rejoints par les étudiants de la France entière. Pendant ce temps là, les affrontements avec les forces de l’ordre redoublent à Paris. Les étudiants dépavent les rues (Sous les pavés, la plage), retournent et brûlent des voitures, invectivent les forces de l’ordre (CRS / SS). Les interpellations pleuvent.
L’escalade de la violence pousse quelques intellectuels à organiser un comité de soutien aux étudiants emprisonnés. Le 10 mai, la faculté de Nanterre est rouverte, mais les enseignants refusent de reprendre les cours tant que les étudiants arrêtés les jours précédents ne sont pas relâchés et amnistiés. Alors que la grève gagne les établissements secondaires, une manifestation s’improvise en fin d’après-midi et profitant d’une absence de barricade, s’engouffre dans le quartier latin. Dans la soirée, en attendant que les forces de l’ordre interviennent, les étudiants édifient des barricades avec tout ce qui est à portée de leurs mains (pavés, grilles, voitures, palissades). Ils sont bientôt aidés par certains habitants du quartier qui en profitent pour vider leurs caves ou leurs greniers. Organisant ainsi les défenses autour de la Sorbonne, les étudiants ont l’impression de réécrire l’histoire, ces barricades de la “commune étudiante” devenant le symbole d’une certaine liberté. La reconquête du quartier latin par les forces de police n’intervint que tard dans la nuit, de 2h15 à 6 heures, les forces de l’ordre traquent, matraquent et asphyxient les étudiants. Mais l’assaut se solde par de nombreux blessés de part et d’autre.
Devant les brutalités policières, une manifestation est organisée le lundi 13 mai. Elle réunit à paris plus de cinq cent mille personnes, et pour la première fois depuis la guerre d’Algérie, elle associe les étudiants et les travailleurs. Les manifestations sont également très suivies en province et on peut compter en fin de journée plusieurs millions de manifestants. Parallèlement, les mots d’ordres de grève se multiplient, et, en quelques jours, le pays est paralysé par une grève générale.
En ce 13 mai, la Sorbonne est également rouverte. Elle est de suite occupée par les étudiants qui la déclarent “Université autonome et populaire” ouverte aux travailleurs. À l’image des Comités d’Action Lycéen existant depuis novembre 1967 (CAL souvent issus des “comités Vietnam” de base), des Comités d’Action Populaire (CAP), souvent organisés par la JCR, se montent au sein des facultés. Ces comités sont une expérience de démocratie directe où les participants refont le monde jusque tard dans la nuit. Ils désirent, adoptant les revendications de l’extrême gauche, lutter contre la société, lieu d’aliénation de l’individu. Cependant, ces CAP demeurent avant tout des réunions où l’utopie est maîtresse. Deux devises de mai 1968 peuvent résumer l’esprit de ces CAP :
Créer (une nouvelle société) ou mourir ou encore Soyez réalistes, demandez l’impossible!.
Ce 13 mai marque enfin le début de la phase sociale du mouvement de mai 68. Le mouvement étudiant est alors dépassé par le mouvement ouvrier. La France compte alors plus de neuf millions de grévistes. Les négociations salariales aboutissent le lundi 27 mai à la signature des accords de Grenelle, mais les partis de gauche (hormis le PC) se déclarent prêts à assumer le pouvoir.
Le 30 mai, De Gaulle prononce une courte allocution d’une extrême fermeté, laçant un appel à l’action civique des Français. Ce ne sont pas moins de cinq cent mille personnes qui défilent quelques heures plus tard à Paris, répondant ainsi à son appel. C’est la décrue du mouvement, et, en quelques jours, les grèves et les occupations d’usines cessent. Le calme revient à l’Université. Daniel Cohn-Bendit est expulsé de France.
Le mai étudiant s’éteint, l’imagination n’a pas atteint le pouvoir. Pour autant, le pouvoir gaulliste semble avoir entendu certaines doléances estudiantines puisqu’il prépare durant l’été une vaste réforme de l’enseignement supérieur.
L’onde de choc de mai 68
La réponse politique à la crise universitaire ne tarde pas. Le ministre de l’Éducation nationale, Edgar Faure, se rend compte qu’il est illusoire de penser que les étudiants, dont la contestation a envahi les rues au printemps, réintégreront leurs amphithéâtres à l’automne comme si de rien n’était. Il élabore donc durant l’été une réforme de grande ampleur de l’Université1, réforme promulguée le 12 novembre 1968. Quant aux organisations étudiantes, désavouées par leur base, elles s’enferment dans une voie sans issue : l’extrême gauche.
La réforme Faure fait éclater les vieux cadres d’une Université datant de la Troisième République. L’instauration des Unités de Valeur (UV), des travaux dirigés, la mise en place d’un contrôle continu confèrent à la formation universitaire une certaine souplesse. Les contenus pédagogiques ne sont plus imposés mais élaborés entre enseignants concernés. Enfin, la disparition des cinq grandes facultés se fait au bénéfice des Unités d’Enseignement et de Recherche (UER), regroupées au sein d’une université. Mais l’innovation la plus importante de la réforme Faure répond à une veille revendication étudiante : la participation de leurs représentants avec voie délibérative au sein des Conseils d’UER et d’université. Au même titre que les enseignants, personnels administratifs et techniques, les étudiants peuvent désormais participer à la cogestion de l’Université. Une nouvelle démocratie universitaire entre dans les faits par l’élection d’un Conseil représentatif, ce Conseil élisant lui-même en son sein, un président.
Pour autant, l’UNEF, toujours aux mains des gauchistes, réagit négativement à cette réforme. Dans l’esprit de mai 68, elle répond : Élections, piège à cons! Elle appelle même au boycott de ces élections, considérant que sa participation entraînerait son intégration. Elle refuse donc par cet acte une mesure demandée depuis la charte de Grenoble.
Mais l’UNEF n’est plus seule sur le terrain syndical. Un tout nouveau syndicat, issu des remous secondaires au mai étudiant, voit le jour. L’Union Nationale Interuniversitaire1 (UNI) n’a pas de programme précis pour l’amélioration du monde étudiant, son seul credo est de soutenir une politique de droite en luttant contre le gauchisme qui s’est installé dans l’Université et en refusant l’esprit de mai 682.
Les premières élections universitaires ont lieu en février et mars 1969. Malgré le boycott de l’UNEF, la participation étudiante est massive, allant de 40 % à 60 % suivant les UER3. Elle dépasse même les 60 % dans certaines UER de médecine, droit ou sciences économiques. Les élus étudiants issus de ce premier scrutin sont alors majoritairement des membres de l’UNI ou des indépendants issus du mouvement associatif. La démocratie universitaire donne ainsi sa légitimité à la loi Faure, discréditant par la même occasion la position de l’UNEF vis-à-vis de cette réforme.
Il faut dire qu’à cette période, l’unité de l’UNEF est fictive. En effet, l’UNEF n’est plus qu’une addition de factions politiques gauchistes. Une ligne de clivage s’instaure entre l’UEC (en faveur d’une participation étudiante dans les Conseils)4 d’une part et l’Alliance des Jeunes pour le Socialisme (AJS), les Étudiants Socialistes Unifiés (ESU issu du PSU), les maoïstes, marxistes-léninistes, les trotskistes (JCR), les lambertistes (OCI) et autres anarchistes d’autre part. Au cœur de ces combats internes se trouve le rôle que doit jouer l’UNEF parmi des étudiants : rôle syndical ou politique. Au centre des débats, l’organisation étudiante s’interroge toujours sur sa participation aux élections étudiantes. L’attitude figée des partisans et des opposants à cette participation conduit à la deuxième scission de l’UNEF en 1971 avec la création de l’UNEF-Renouveau (principalement tenue par l’UEC) et l’UNEF-Unité Syndicale (UNEF-US aux mains de l’OCI et l’AJS).
L’UNEF-Re souhaite alors reconstruire le syndicalisme étudiant par le biais des élections universitaires, alors que l’UNEF-US voit en ces élections une gestion bourgeoise de l’Université. Ce clivage participation/ boycott des élections marquera le mouvement étudiant durant près d’une dizaine d’années.
La présence de ces organisations gauchistes au sein de l’Université fait entrer tous les conflits sociaux dans les débats estudiantins, débats qui tournent d’ailleurs souvent à l’affrontement direct avec l’UNI et l’extrême droite1. Ainsi, la contraception, l’avortement, l’attentat de Munich en 1972, l’assassinat de Salvador Allende en septembre 1973, la fermeture des usines Lip, l’extension du camp militaire dans le Larzac sont autant d’éléments utilisés par l’extrême gauche pour agiter le monde universitaire. Les étudiants sortent parfois de leur campus pour attaquer telle ambassade à la bombe… de peinture ou pour manifester contre la guerre du Vietnam ou le régime franquiste. Pour autant, il faut tout de même signaler que cette agitation universitaire est surtout parisienne. Dans les universités de province, les deux armes favorites du gauchisme, l’occupation des locaux des facultés ou l’entrave à la libre circulation des personnes, sont plutôt utilisées afin d’obtenir une décision des instances universitaires ou afin de lever une sanction jugée inadmissible.
Quoi qu’il en soit, ces actions contestataires extrémistes ne mobilisent que peu d’étudiants en fait, et le cycle révolutionnaire finit par s’épuiser au milieu des années 1970, ouvrant alors la voie à une recomposition du syndicalisme étudiant.
La reconquête syndicale
Au milieu des années 70, l’UNEF est donc divisée et affaiblie. Il faut d’ailleurs parler désormais des deux UNEF tant un clivage profond les oppose. La grande organisation étudiante à l’origine de la charte de Grenoble, ou du moins ce qu’il en reste, n’est plus en mesure de jouer un rôle dans le monde étudiant. Pire, un autre syndicat, l’UNI, regroupant des enseignants et des étudiants de droite, domine le terrain syndical. Il est même particulièrement bien implanté dans les UER à tendance conservatrice comme les facultés de médecine, droit ou encore pharmacie.
L’UNEF-US reste en concurrence avec l’UNEF-Re, alors majoritaire, leurs débats idéologiques restant souvent éloignés des attentes des étudiants. L’image des deux UNEF reste ternie par le gauchisme récent duquel elles tentent de sortir. Pour preuve, la réaction étudiante à la réforme universitaire de Jean-Pierre Soisson et d’Alice Saunier-Séïté en 1976, ne se développe plus à l’initiative des organisations syndicales mais de “coordinations” dont les membres sont élus en Assemblée Générale (AG). Certes, les deux UNEF rejoignent rapidement le mouvement de grève lancé par ces coordinations, mais elles n’en acceptent l’alliance qu’à l’expresse condition d’en être les stratèges. Il leur faudra ensuite réfléchir à de nouvelles formes d’action syndicale. C’est ainsi qu’est fondé le Mouvement d’Action Syndicale (MAS), structure plutôt réformiste se situant entre le mouvement syndical et le parti politique.
Il faut dire que cette année 1976 correspond au début de l’investissement massif des partis politiques dans le monde étudiant. Certes, les gaullistes se retrouvent déjà au sein de l’UNI, certes l’UNEF-Re est dominée par les communistes depuis le départ de sa composante AJS, mais les autres organisations politiques importantes ne sont pas représentées. Les étudiants mitterrandistes décident alors de créer le Comité d’Organisation pour un Syndicat des Étudiants de France (COSEF), tandis que les étudiants centristes fondent le Comité des Étudiants Libéraux de France (CELF), d’obédience giscardienne. Il est désormais clair que, pour les responsables politiques, la conquête du pouvoir passe aussi par la conquête du monde étudiant.
A l’image du Parti Communiste Français (PCF), l’UNEF-Re est en perte de vitesse. Probablement, la défaite des forces de gauche aux élections législatives de 1978 (suite au refus de désistement du PCF) y a-t-elle contribué. Quoi qu’il en soit, l’UNEF-Re se retrouve de plus en plus isolée face aux organisations de la gauche non communiste, le MAS, le COSEF et l’UNEF-US. Elle perd même successivement le contrôle des CROUS et de la MNEF en 1979. Lors du congrès de l’UNEF-US à Nanterre les 3, 4 et 5 mai 1980, la gauche non communiste fusionne pour former l’UNEF-Indépendante et Démocratique (UNEF-ID), élisant à sa tête un membre de l’OCI, Jean-Christophe Cambadélis1.
La volonté de trancher avec le passé gauchiste est évidente, néanmoins, l’indépendance affirmée se transforme en un soutien sans condition après l’élection de François Mitterrand en mai 1981. Quittant la voie de la contestation systématique, l’UNEF-ID renoue avec l’esprit de la charte de Grenoble, créant à nouveau des services étudiants, participant régulièrement à des négociations, la proximité idéologique du pouvoir politique en place l’y invitant. Elle présente même des candidats aux élections universitaires de 1982, revenant ainsi sur une position de boycott maintenue depuis les lendemains de mai 68.
De son côté, sous l’impulsion des étudiants UEC, l’UNEF-Re est renommée en 1982 UNEF-Solidarité Étudiante (UNEF-SE), tentant ainsi de faire oublier ses obédiences communistes afin de séduire un plus grand nombre d’étudiants.
Cependant, le poids des deux UNEF est plus institutionnel que représentatif. En effet, l’époque où la moitié des étudiants est adhérente à l’UNEF est bel et bien révolue. Tous syndicats confondus, les étudiants militants ne représentent que 7 % des effectifs totaux en 1982. Pour autant, cela n’empêche pas les deux UNEF de participer aux négociations préalables à l’introduction de la réforme Savary. Cela leur permet d’obtenir enfin la reconnaissance de l’exercice de la liberté syndicale à l’Université2 qui jusque là n’était toujours pas officielle. Cette réforme des universités est jugée inacceptable par la majorité des étudiants, notamment sur la diminution de la représentation étudiante au
sein des conseils ainsi que sur le risque de “secondarisation” du premier cycle. Les manifestations étudiantes se suivent sous la direction d’une coordination se proclamant apolitique ; les deux UNEF ne participent que très mollement au mouvement1, et pour cause.
Parallèlement, afin de raviver le militantisme de base, quelques anciens de l’UNEF dont Julien Dray (un temps secrétaire général du MAS) et Harlem Désir, fondent en 1984 le mouvement contre le racisme “SOS-Racisme”. Ce mouvement s’implante remarquablement dans les lycées avant de séduire bon nombre d’étudiants. Il s’agit d’un véritable vivier où les premières armes du militantisme se forgent, où peuvent être formés les dirigeants syndicaux de demain.
Un changement de majorité intervient à l’Assemblée nationale en mars 1986. Presque soulagée, l’UNEF-ID, alors nettement prépondérante, retrouve la voie de la contestation, et s’engage dans la lutte contre le projet Devaquet.
Les derniers grands mouvements étudiants
L’UNEF-ID vient juste de rompre définitivement avec l’OCI lorsqu’elle s’engage dans la bataille contre le projet Devaquet. Ce projet est d’inspiration moins libérale que ne le souhaitait la droite traditionnelle, ce qui fait craindre à son instigateur une opposition de l’UNI et certains “ultras” de l’Université. La réforme Devaquet réaffirme le caractère national des diplômes, plafonne des droits d’inscriptions (ce qui n’était pas prévu par la loi Savary en 1984)2. Il s’agit aussi de permettre des réorientations en cours de cycle, par la création de passerelles et d’unités de valeur.
En effet, le système français attire massivement les jeunes bacheliers, mais les rejette aussi massivement après deux échecs du premier cycle. La plupart ne tenteront pas une autre filière de formation de l’enseignement supérieur et en ressentiront de la rancœur.
Dès le mois de juin, l’UNEF-ID, relayée par l’UNEF-SE, organise la désinformation sur ce projet, s’appuyant davantage sur des inquiétudes que sur des données objectives. En effet, à la rentrée suivante, en octobre 1986, les rumeurs les plus folles circulent sur l’université : l’appel à des fonds privés, l’augmentation exorbitante des droits d’inscriptions, une sélection universitaire renforcée par une sorte de réorientation, la perte du caractère national des diplômes (due à une privatisation plus ou moins forte de l’université concernée)1 … Tous les ingrédients d’un conflit universitaire sont réunis, mais l’UNEF-ID reste prudente, ne voulant pas se perdre en débat idéologique, erreur qui lui avait été fatale dans l’après mai 68.
Le 13 novembre 1986, la mobilisation étudiante se forme à l’université de Paris-Villetaneuse. Elle gagne en quelques jours de nombreuses universités de Paris et de province. Dans chaque faculté, des AG se réunissent, des coordinations se montent. Fin novembre, un gros contingent de lycéens se joint au mouvement étudiant. L’UNEF-ID, aux commandes depuis le début des manœuvres, perd rapidement la main au profit des coordinations apolitiques qui demandent purement et simplement le retrait du projet Devaquet.
Elles reçoivent alors le soutien du CELF, d’obédience centriste. Les manifestations sont impressionnantes, le 27 novembre, plus de deux cent mille étudiants manifestent à Paris et quatre cent mille en province, le 4 décembre, ce sont plus de cinq cent mille jeunes qui battent le pavé dans la capitale. Quelques-uns seront même blessés à l’issue de la manifestation par des tirs tendus de bombes lacrymogènes ou par des contacts trop directs avec les CRS. Pour autant, des affrontements naissent également dans certaines facultés (pour exemple les facultés de droit de Paris-Assas, de Nantes ou de Rennes) ou des commandos de l’UNI ou du Groupement Universitaire de Défense (GUD affilié à l’extrême droite) organisent des expéditions punitives. Mais il faut la mort tragique d’un étudiant, Malik Oussekine, le 6 décembre 1986, pour faire reculer le gouvernement Chirac.
En définitive, ce n’est donc pas le combat syndical de l’UNEF-ID qui a fait échouer le projet mais les simples conséquences d’une brutalité policière inadmissible. Le projet Devaquet est retiré par le Premier ministre le 9 décembre, la coordination nationale se dissout le 10 décembre à l’issue d’une dernière manifestation en mémoire du jeune étudiant. Mais longtemps les gouvernements successifs resteront prudents face au milieu étudiant, se gardant de la moindre réforme de grande ampleur.
Malgré cette prudence vis-à-vis des étudiants, le gouvernement Balladur commet une erreur en 1994. En effet, en février 1994 sort un décret sur le Contrat d’Insertion Professionnel (CIP). Afin de lutter contre le chômage et de pallier la baisse de l’activité économique que connaît le pays depuis trois ans, le CIP permet l’embauche de jeunes, dont le niveau d’étude est de bac +2, à un salaire inférieur au SMIC s’il est au chômage depuis plus de 6 mois. L’émoi est vif, notamment dans les lycées et les IUT2, et, une fois de plus, les coordinations prennent le pas sur les organisations syndicales. De la défense d’un système universitaire égalitaire en 1986, les étudiants doivent désormais préserver la valeur sociale de leur diplôme en 1994 afin d’obtenir un emploi normalement rémunéré. La mobilisation étudiante est importante contre ce décret, surtout dans les filières professionnelles, ce qui conduit le gouvernement à retirer son projet.
Cependant, lors des mouvements sociaux de la fin 1995 contre la politique d’austérité du gouvernement Juppé, les étudiants descendent à nouveau dans la rue, non pas contre un projet de loi mais simplement pour demander des moyens supplémentaires pour l’Université, rappelant par-là même, les combats de leurs prédécesseurs dans les années 1950.
Ainsi, le mouvement syndical est né pratiquement avec le siècle. D’abord emprunt de bienveillance à l’égard du monde politique, il participe à la fondation de nombreuses structures universitaires au bénéfice des étudiants. Puis, une fois la crise de conscience de la Libération passée, le syndicalisme étudiant devient plus revendicatif, permettant ainsi de défendre au mieux les intérêts des étudiants. La guerre d’Algérie politise nettement le milieu étudiant, ce qui aboutit à l’éclatement de l’UNEF. L’Université se retrouve dans les années 1960 en proie à une massification, tandis que le syndicat étudiant, attiré de plus en plus par les thèses de l’extrême gauche, se bat pour une réforme profonde du système universitaire, une allocation d’études et une cogestion des universités. La crise de mai 68 intervient alors que rien ne l’annonçait. l’UNEF y joue un rôle presque négligeable, mais au sortir, elle se trouve gangrenée par l’extrême gauche qui l’éloigne encore plus des intérêts étudiants. Dans le milieu des années 1970 on assiste à une forte politisation du milieu étudiant puisque chaque parti politique a désormais son syndicat, cette situation créant une certaine confusion parmi les étudiants qui ne se reconnaissent plus dans ces structures. L’UNEF-ID reste le syndicat majoritaire mais ses prises de position ne sont plus fonction des intérêts étudiants mais de l’alternance politique que connaît le pays. Les étudiants sont devenus méfiants envers les structures syndicales et préfèrent s’organiser en coordinations apolitiques. Loin des revendications de la charte de Grenoble, c’est l’incertitude de leur avenir et de la valeur des diplômes qui amène les étudiants d’aujourd’hui à l’action militante. La massification des études a fait disparaître les revendications statutaires, l’Université n’étant plus qu’une période de transition avant de rentrer dans la vie active.
Pour autant, une alternative au syndicalisme étudiant est née de la première scission de l’UNEF en 1961 : le mouvement associatif étudiant, issu de la tendance majo de l’UNEF, fortement attaché à son apolitisme et à la défense des intérêts des étudiants qu’il représente.
Chapitre II
Le mouvement associatif étudiant
De la FNEF aux associations monodisciplinaires
Comme nous l’avons vu, le traumatisme de la guerre d’Algérie a provoqué une scission au sein de l’UNEF en juin 1961. La tendance majo de l’UNEF n’accepte pas les prises de position du syndicat étudiant sur les événements en Algérie, lui refusant une compétence quelconque à exprimer l’opinion politique des étudiants. Les étudiants dissidents considèrent en effet qu’il n’est pas du ressort d’un syndicat étudiant de prendre ouvertement parti contre la guerre d’Algérie en proposant une paix négociée avec le FLN, même si à titre personnel, cette solution leur paraît souhaitable.
La Fédération Nationale des Étudiants de France (FNEF) est donc fondée le 28 juin 1961 à Montpellier. Se revendiquant d’un apolitisme strict, elle regroupe à son origine notamment les AGE de Montpellier, Paris-droit, Aix-en-Provence, Nice, Toulouse et quelques offices techniques de l’UNEF1 comme les fédérations des étudiants en médecine, en commerce, en droit, en chirurgie dentaire ou encore en pharmacie. Cependant, cette volonté de ne pas participer au débat colonial qui agite la société française les fait passer pour des partisans de l’Algérie Française. Certains étudiants nationalistes, certains étudiants anticommunistes et certains membres de l’Action Française (AF) tentent même d’infiltrer la FNEF, voulant ainsi assouvir leur désir de “casser du gauchiste”2. En réponse à ces actions, entre novembre 1961 et mars 1962, le Front Uni Antifasciste3 (FUA) organise régulièrement dans la quartier latin des meetings et des manifestations contre ces groupes d’extrême droite. Le passage de l’AF et d’autres groupuscule fascisant reste éphémère à la FNEF mais renforce la désaffection de nombreux étudiants pour cette toute nouvelle fédération.
Quoiqu’il en soit, le gouvernement voit plutôt d’un bon œil la création de la FNEF, et compte bien favoriser ce recrutement d’étudiants afin d’affaiblir l’UNEF, devenue pôle de résistance à sa gestion du conflit algérien. C’est ainsi que la FNEF se voit dotée de subventions généreuses de la part du ministère de l’Éducation nationale alors que sa légitimité n’est pas encore reconnue officiellement. Cela permet à ses dirigeants d’argumenter les positions apolitiques de la FNEF dans de nombreuses villes afin de mieux s’implanter à l’Université. L’ancienne tendance majo réaffirme le principe des traditions humanistes de l’Université de France, son respect de la liberté d’expression et de la personnalité humaine. Par contre, la FNEF désire redéfinir une forme de syndicalisme étudiant. Elle reproche tout d’abord à l’UNEF ses positions sur le conflit algérien, qui, au-delà de l’action politique, a provoqué pour la première fois de son histoire une rupture de dialogue avec le gouvernement en place. Mais, de plus, elle remet en cause la charte de Grenoble et sa définition du jeune travailleur intellectuel, préférant un étudiant libre, futur cadre de la nation à cet étudiant improductif, charge économique pour sa famille et la nation1. En effet, la FNEF prône le renforcement des œuvres universitaires devant la massification de l’enseignement secondaire, mais s’oppose à la notion d’allocation d’études demandée par l’UNEF.
Dans les mois qui suivent la fin du conflit algérien, le clivage est si important, les dirigeants sont si radicalisés sur leurs positions qu’aucun rapprochement ne peut être envisagé entre les deux organisations étudiantes. Ceci conduit la FNEF à créer dans de nombreuses villes des Fédérations d’Étudiants (Fédé) pour contrer les AGE restées aux mains de la tendance mino de l’UNEF2. Ce combat interne qui s’organise, l’orientation gauchiste de l’UNEF, l’orientation libérale et droitière de la FNEF conduisent à l’affaiblissement de ces deux organisations. Les associations locales d’étudiants (Bureau Des Étudiants -BDE, les corporations d’étudiants – corpos, et autres associations d’étudiants) sont, pour l’essentiel, nettement moins politisées que leurs organisations de ville (AGE, Fédé) ou nationales et ne se reconnaissent plus dans les AGE, Fédés, à l’UNEF ou à la FNEF. De nombreuses associations locales (principalement les corporations) décident alors de se fédérer en fonction de leur filière d’enseignement, utilisant ainsi les offices techniques de l’UNEF préexistants.
Les offices techniques sont nés à l’UNEF à la fin des années 40. Ainsi intégrés à l’UNEF, celle-ci pouvait alors contrôler leur aspiration à une certaine indépendance concernant leurs problèmes professionnels. Jamais ces offices n’ont obtenu de reconnaissance nationale. Leur participation à la création de la FNEF leur permet donc de s’organiser afin d’obtenir cette reconnaissance tant souhaitée. Ainsi naissent entre 1962 et 1964 l’Union Nationale des Étudiants en Médecine de France (UNEMF), l’Union Nationale des Étudiants en Droit Économie et Sciences Politiques (UNEDESEP), l’Union Nationale de Étudiants en Chirurgie Dentaire (UNECD), l’Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France (ANEPF) et d’autres encore1. Ces associations monodisciplinaires ne sont que peu représentatives à leur début, les associations locales restant en effet très méfiantes à l’égard de toute structure nationale. Elles se réclament pourtant d’un apolitisme strict, se séparant rapidement de la FNEF devenue seulement une force d’opposition au gauchisme de l’UNEF.
Cependant, l’UNEMF ne représente que la moitié des étudiants en médecine, l’autre moitié étant représentée par l’Association Générale des Etudiants en Médecine de Paris (AGEMP), toujours affiliée à l’UNEF et aux mains de l’UEC. Cela contribue à paralyser toute revendication des étudiants en médecine et à rendre peu crédibles les responsables étudiants. En 1964, la tendance majo finit par l’emporter au sein de l’AGEMP, la sortant du gauchisme universitaire ambiant, ce qui rend alors possible la fusion des deux structures en novembre 19652. Ainsi se crée l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France (ANEMF), organisation représentative des étudiants en médecine et toujours très active de nos jours.
L’ANEMF et la représentation des étudiants en Médecine partir de 1965, l’ANEMF s’attache à mieux représenter ses étudiants. Comme la majorité des associations monodisciplinaires, elle s’inscrit dans des revendications corporatistes, ce qui lui attire les foudres des syndicats traditionnels, très politisés. En effet, fidèle à la tendance gestionnaire et apolitique, elle ne participe pas au mouvement révolutionnaire qui anime le monde étudiant d’avant mai 68. Totalement indépendante de l’UNEF et de la FNEF, de nombreuses associations d’étudiants en médecine (les corporations) adhèrent rapidement à l’ANEMF. Celle-ci obtient la reconnaissance de sa représentativité en 1966 lors de son élection au bureau de l’International Fédération of Medical Students Associations (IFMSA)1.
Mais la reconnaissance de l’ANEMF est aussi bien évidemment nationale puisqu’elle participe aux projets de réforme de l’enseignement médical. Durant les événements de mai 68, elle se garde bien de donner la moindre consigne, même si de nombreuses facultés de médecine se mettent en grève. Les revendications des étudiants en médecine pendant le mai étudiant sont loin d’être révolutionnaires mais portent plus spécifiquement sur un statut d’élève assistant2 pour les étudiants carabins. Ce statut préparé par l’ANEMF est obtenu peu de temps après.
La réforme Faure offre à l’ANEMF la possibilité de présenter des candidats aux élections universitaires. Alors que la FNEF et l’UNEF ont boycotté le scrutin, elle y obtient des résultats à la hauteur de sa représentativité, ce qui accroît sa notoriété parmi les étudiants en médecine.
Après mai 68, la crise interne de l’UNEF dépasse le simple cadre du syndicat. La MNEF, gérée par l’UNEF, perd peu à peu son rôle de structure au service des étudiants pour devenir progressivement une structure au service d’une politique révolutionnaire. Elle se retrouve bientôt face à un déficit financier conséquent. Refusant cette escroquerie dont sont victimes les étudiants, quelques associations membres de l’ANEMF décident de créer des mutuelles régionales indépendantes. Ainsi naît à Lyon et à Grenoble, en 1970, la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Rhône-Alpes (SMERRA). L’expérience s’avère concluante et en quelques années, d’autres sociétés mutualistes se développent dans le Nord-Ouest (SMENO), dans le Sud-Ouest (SMESO), dans la Région Parisienne (SMEREP) ou encore en Bretagne Atlantique (SMEBA). Devant cette nouvelle concurrence, et comme s’apaisent les débats politique dans l’Université, les étudiants ESU et UEC de l’UNEF décident de reprendre en main la MNEF dans le milieu des années 1970, et de lui rendre sa fonction initiale de sécurité sociale étudiante. Les deux structures coexistent toujours, la MNEF est cependant devenue la Mutuelle des Étudiants (ME) depuis l’année 20001.
L’ANEMF participe depuis la réforme Faure à toutes les échéances électorales universitaires. Afin de diminuer l’influence de l’UNEF-Renouveau, elle décide de s’associer à d’autres structures apolitiques pour les élections au Conseil National des Etudes Supérieures Et de la Recherche (CNESER) ou au Centre National des Œuvres Universitaires et Sociales (CNOUS). Ainsi se créent en 1971 la Liste Indépendante de Défense des Intérêts des Étudiants (LIDIE) avec les associations des grandes écoles, puis en 1976 le Comité de Liaison des Étudiants de France (CLEF) regroupant les associations monodisciplinaires et les grandes écoles, transformée en 1982 la Confédération Nationale des Étudiants de France (CNEF)2. Malgré le regroupement de ces forces associatives indépendantes, les structures successives n’obtiennent que la deuxième place aux différents scrutins, toujours derrière les deux UNEF mais loin devant les autres syndicats.
La CNEF est non seulement une confédération mais aussi une centrale d’achats pour les corporations d’étudiants. Cependant, la vigueur retrouvée de certaines AGE ou Fédé de ville, une fois débarrassées de leur orientation politique, va provoquer sa chute. Il est en effet bien plus facile pour une corpo de se fournir dans une structure associative au sein de sa ville plutôt que dans une centrale parisienne. Ainsi, sous l’impulsion des corpos, les AGE de Nantes, Toulouse, Rennes et bien d’autres villes renaissent de leurs cendres. Certaines qui ont perduré durant le bouillonnement politique des années 70, comme à Strasbourg, se tournent résolument vers le monde associatif, garant de l’apolitisme dont elles se réclament désormais.
Le renforcement des AGE au détriment de la CNEF (qui disparaît en1986), la reprise de l’UNEF-ID par des étudiants socialistes plus modérés que leurs aînés, la première cohabitation, la lutte contre le projet Devaquet, tous ces éléments finissent par affaiblir la représentation des associations indépendantes. Il faut attendre les élections au CNESER et au CNOUS de 1989 pour voir réapparaître une liste indépendante, la liste Défense des Étudiants, regroupant les principales associations monodisciplinaires (ANEMF, ANEPF, UNEDESEP, UNECD) associées aux plus grandes Fédés ou AGE (Lille, Strasbourg, Montpellier, Nantes).
La loi d’orientation de 1989 prévoit de consacrer “une représentativité nationale” aux organisations étudiantes ayant des élus au CNESER ou au CNOUS. L’appréciation de cette représentativité, jusque là établie par le ministère de l’Éducation nationale, se voit remplacée par un critère objectif : les résultats électoraux. Afin de bénéficier de subventions pour la formation de leurs élus, les associations locales ou monodisciplinaires doivent donc se regrouper au niveau national1.
La réponse apportée est la création de la Fédération des Associations Générales d’Étudiants (FAGE)2, à l’instigation de l’AGE de Strasbourg, en 1989, associée durant un temps aux associations monodisciplinaires (FAGEM)3. La FAGE est immédiatement considérée comme une structure conservatrice par certains syndicats étudiants car elle prône le maintien de certaines traditions comme la faluche4. La liste indépendante “Associations Étudiantes” (AE) soutenue par la FAGE arrive en tête des élections au CNESER en 1994, pour la première fois depuis 1971 l’UNEF n’est plus en tête d’un scrutin national. Cependant, il faut remarquer la méfiance de certaines associations monodisciplinaires (pharmacie, droit, biologie, bientôt rejoints par médecine) face à cette hégémonie de la FAGE dans le mouvement associatif. En effet, la FAGE se veut la représentante de toutes les associations d’étudiants de France, sans leur accord ou leur adhésion. Les associations monodisciplinaires la soupçonnent alors de vouloir recréer une sorte de grande UNEF, une structure certes représentative mais énorme, soucieuse de s’occuper de tous les problèmes généraux de l’enseignement supérieur (logement, bourses, droits d’inscription, formation, débouchés professionnels…), mais peu encline à défendre les intérêts corporatifs de certains de ses membres. Un doute est même porté sur l’apolitisme de ses principaux dirigeants, ou du moins sur leur total désintérêt personnel à participer aux réunions ministérielles. L’ANEMF, l’ANEPF, la Fédération Nationale des Étudiants en Biologie (FNEB), l’UNEDESEP se retrouvent donc, à partir de 1996 sur une liste indépendante appelée “Promotion et Défense des Étudiants” (PDE), concurrente de la liste “Associations Étudiantes” représentant la FAGE et les autres structures associatives. Le résultat de ces élections confirme la bipolarisation du monde étudiant avec d’une part l’UNEF-ID, majoritaire, et d’autre part les associations indépendantes. Par contre l’UNEF-SE et l’UNI sont en net recul.
L’opposition entre la FAGE et les principales associations monodisciplinaires aboutit parfois à des situations ubuesques puisqu’une même corpo peut être membre d’une fédération de ville affiliée à la FAGE et en même temps membre d’une association monodisciplinaire hostile à cette même FAGE1. Des tentatives de rapprochement sont donc entreprises depuis cette date.
Ces oppositions entre différentes associations ont tendance à gêner la compréhension du monde associatif, surtout pour l’étudiant peu attentif. Par contre, il reste une structure dans laquelle il se reconnaît plus facilement, son association locale, sa corpo. Cette structure de base du mouvement associatif est en effet le lien direct entre les étudiants et les organisations nationales, FAGE ou association monodisciplinaire, mais aussi avec les instances universitaires locales.
L’association locale (la “corpo”)
La corporation des étudiants porte le nom, dans notre faculté, d’Association Amicale des Étudiants en Médecine de Rennes (AAEMR). Elle a été fondée en 1980, prenant ainsi la suite de l’Union Rennaise des Étudiants en Médecine (UREM) dissoute à la fin des années 1970 suite au départ de son président, dont la rumeur prétend qu’il s’est auparavant emparé de la “caisse”.
L’AAEMR est régie par la loi sur les associations de juillet 1901, ses statuts sont deposes à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Entre 1983 et 1987, elle se trouve en concurrence avec une autre association, Polygam, dont le seul but est de diffuser des polycopiés de cours aux étudiants. En 1987, sous l’impulsion de son président, Nicolas Velmans, elle récupère cette activité primordiale pour les étudiants, et l’AAEMR devient alors une structure indispensable à la vie de la faculté de médecine, maillon essentiel des relations estudiantines.
Se revendiquant d’un corporatisme pur, on peut considérer qu’elle est héritière de la tendance majo des années 60, tant elle n’a de cesse d’affirmer son apolitisme. L’AAEMR n’existe que par et pour les étudiants, ce qui lui vaut parfois la critique de rester close sur elle-même et sur la faculté1. Certains qualifient même son attitude corporative de sectaire2. Pour autant, même si quelques étudiants en médecine critiquent l’utilité d’une telle structure, la majorité d’entre eux ne remettent aucunement en cause son utilité au sein de la faculté.
Elle est un lieu de réflexion, de convivialité et de défense des intérêts collectifs des carabins rennais. Même si elle reçoit quelques subventions de la faculté de médecine, elle assume parfaitement son autonomie et sa forte volonté d’indépendance.
Elle est dirigée par un bureau élu à chaque rentrée universitaire. Ce principe démocratique est un élément moteur de son dynamisme puisqu’il pourvoit régulièrement au remplacement de ses membres dirigeants. Certes, cela peut nuire temporairement à son efficacité, mais les anciens membres du bureau restent toujours disponibles pour pallier la moindre difficulté si besoin. Elle accepte en son sein tout volontaire, même s’il ne présente aucune expérience ou qualification particulière, le principal étant de former une équipe unie, dynamique, et riche de projets. Il faut cependant noter que le dynamisme de l’AAEMR ne tient souvent qu’à quelques individus1.
La corpo est un véritable lieu de socialisation, permettant à ses membres de se forger un esprit civique critique, tant la volonté d’intégration au sein de la faculté y sont prépondérants. Le président est plutôt considéré comme un animateur du groupe ; l’autorité et la hiérarchie sont souvent mal ressenties au sein de l’association. Pour autant, chaque membre s’attache à son rôle (trésorerie, secrétariat, démarches commerciales, gestion de dossiers), se souciant régulièrement d’en informer les autres membres ; le bureau est toujours attentif à ce que la communication interne soit constante et efficace. Certains critiquent le manque d’organisation au sein de la corpo, laquelle nuit à son activité. Il faut tout de même conserver à l’esprit qu’il s’agit d’un petit groupe de volontaires et que si ses dirigeants se transforment en petits chefs d’entreprise, inquiets de leurs résultats et de leurs bilans, le caractère convivial et d’entraide risque de disparaître.
Nous allons maintenant analyser divers événements survenus dans la vie de la corpo depuis 1986 et qui illustrent quelques-unes des activités de l’AAEMR. Nous allons décrire ses relations locales, nationales, ses prises de position, la pérennité de l’esprit paillard.
L’AAEMR et les étudiants
Il existe deux types d’étudiants au sein de l’AAEMR, les engagés et les consommateurs. Les engagés prennent des responsabilités au sein de la corpo, même les plus minimes, une fois leur concours de PCEM1 obtenu. Ils expriment certainement par cet engagement associatif leur désir de vivre pleinement leurs études et non pas de les subir2, leur volonté d’agir en étudiant pleinement responsable au sein d’une structure reconnue par les instances universitaires, ou encore leur refus de l’anonymat. Pour éclairer ces aspects, nous n’avons trouvé qu’une seule étude et encore est-elle très critiquable1.
Quelle que soit la raison profonde de leur engagement, la grande majorité des étudiants ne connaissent pratiquement rien du fait associatif en entrant à la corpo. C’est pourquoi les anciens représentants de l’AAEMR leurs proposent souvent leur aide, dans le souci de faire partager leur expérience acquise en partie “sur le tas”, mais se gardent bien de reproduire le schéma enseignant-enseigné, cette formation ne devant pas entraver le libre arbitre et l’autonomie de décision des nouveaux engagés. En effet, il n’est pas souhaitable d’avoir une association étudiante dirigée dans l’ombre par des anciens membres, même si ceux-ci ont pour eux l’expérience, tant le renouvellement de ses membres est essentiel à son dynamisme.
Afin d’améliorer leur efficacité, les responsables de la corpo bénéficient également de quelques week-end de formation organisés par l’ANEMF2, financés par le biais des subventions ministérielles accordées aux associations étudiantes nationales possédant des élus au CNOUS ou au CNESER. Mais il n’est pas toujours aisé de travailler sur sa formation associative le week-end en plus des études médicales, si prenantes. Il en résulte souvent des lacunes d’ordre juridique ou de gestion, fort heureusement sans grande conséquence le plus souvent.
Pour la grande majorité des engagés, l’objectif n’est pas de se professionnaliser mais simplement d’être compétent dans leurs activités associatives. En effet, rares sont ceux qui travaillent à la corpo à des fins personnelles, l’utilisant comme tremplin afin de se faire connaître. Les activités sont plutôt considérées comme un bol d’air, un dérivatif aux études. Les engagés s’en retrouvent d’autant plus enrichis dans leurs relations humaines, leurs aptitudes à prendre des responsabilités, leur capacité à effectuer un travail en équipe, à favoriser l’entente et le compromis. Cet espace de convivialité qu’est la corpo favorise une forme de solidarité entre ses membres qui tend à suspendre l’esprit de concurrence qui règne sur les bancs de la faculté en première année et pour certains de ceux qui préparent le concours de l’internat. On peut même prétendre que ce caractère convivial et un certain refus de la hiérarchie correspond en fait à une volonté de réintroduire une forme d’égalité des chances1. Mais cette convivialité, essentielle au bon fonctionnement de l’association, ne doit pas occulter le travail effectué par ces engagés au bénéfice de tous les étudiants.
Les consommateurs de la corpo bénéficient en effet de nombreux services, leur permettant ainsi de mieux vivre leurs études et d’accéder plus facilement à la “culture” nécessaire, en complément des enseignements de la faculté, à l’obtention du diplôme tant convoité. Après l’adhésion à l’AAEMR, dont le tarif est fixé avec tact et mesure, les consommateurs ont accès aux nombreux polycopiés de cours, aux annales par années ou par discipline, aux livres de conférence d’internat, au matériel médical du parfait externe et au guide de l’externe édité par l’ANEMF. Le tout, bien évidemment, à un prix défiant toute concurrence.
De plus, forte de 600 à 1000 adhérents suivant les années, la corpo négocie régulièrement des tarifs préférentiels auprès de quelques prestataires de services, que ce soit pour les études (photocopieurs, librairies…) ou pour les loisirs (pin’s, sweat-shirt, salles de sport, bars…). Les étudiants peuvent également lire régulièrement la prose souvent paillarde, parfois pamphlétaire de certains d’entre eux au travers de certaines publications qu’elles se nomment Poil à Gratter, Prurit ou aujourd’hui La Carabine.
La corporation des étudiants a aussi pour vocation de faire vivre et de rendre attrayant un campus quelque peu aseptisé et monochrome. Elle organise donc régulièrement des soirées étudiantes afin de resserrer les liens entre les différentes promotions d’étudiants.
Sous la présidence de Dominique Dupré, l’AAEMR est également à l’origine des “Olympiades de la Santé”, journée de compétitions sportives plus ou moins sérieuses entre les étudiants de toutes les filières de santé (les équipes sont pluridisciplinaires), suivie d’une soirée d’une convivialité légendaire.
Le grand moment de cette activité festive se situe à la mi-décembre avec, depuis 1987, l’organisation d’une soirée annuelle : le “Punch Médecine”. Cette soirée regroupe, dans les locaux de la faculté, près d’un millier d’étudiants, en grande majorité des carabins, avec quelques délégations des facultés de médecine du grand Ouest (Brest, Angers, Nantes, Tours, Caen, Rouen et même Bordeaux) et d’ailleurs, et fait le prestige de l’AAEMR par le biais d’une organisation impeccable. Pour des raisons encore obscures, les instances universitaires ont demandé, voici quelques années, que cette soirée soit renommée “Gala Médecine”, puis, avec quelques boniments à l’appui, ont refusé purement et simplement son déroulement dans l’enceinte de la faculté en 20011.
Certains responsables universitaires voudraient étouffer toute vie étudiante sur leur campus qu’ils ne s’y prendraient pas autrement…mais à vouloir régner sur une faculté aseptisée, vidée de sa source originelle que sont les étudiants, l’empereur devient un froid technocrate, responsable de la lente agonie d’une faculté fantôme. Mais l’empereur se doit de se rappeler que les élus étudiants représentent un quart des voix au sein du Conseil de faculté…
L’AAEMR et la représentation universitaire
Depuis l’instauration de la loi Faure après les Événements de mai 68, les étudiants sont représentés dans les Conseils de facultés et d’université, avec voix délibérative1. Forte d’un désir de participer à la vie publique de la faculté de médecine et de l’université de Rennes I, l’AAEMR présente régulièrement des candidats aux élections universitaires. Celles-ci se déroulent tous les deux ans, mais malheureusement, la participation étudiante reste très faible. Est-ce par méconnaissance, par désintérêt ou simplement par la conviction que les étudiants ne peuvent rien changer à leur condition d’étude, toujours est-il que la majorité des étudiants ne perçoit pas le rôle primordial que peut jouer la corpo par le biais de cette représentation étudiante. Pourtant, cette présence de l’AAEMR au sein du conseil de faculté et des Conseils centraux de l’université, permet à ses représentants de prendre en charge eux-mêmes leurs demandes, sans la médiation de structures politiques traditionnelles (les syndicats étudiants) moins soucieuses des particularités et des spécificités des études médicales.
Lors des élections au Conseil de faculté, la liste soutenue par l’AAEMR se retrouve régulièrement confrontée à une ou plusieurs listes d’étudiants indépendants. Ce pluralisme est souhaitable en application des principes de bases de tout processus démocratique. Cela rappelle aux étudiants associatifs que même s’ils sont fortement représentatifs, ils se doivent d’écouter et de représenter les aspirations de tous les étudiants en médecine, y compris celles des étudiants non-adhérents de la corpo et celles des étudiants qui lui sont même hostiles.
Ce travail de conciliation est cependant moins délicat qu’il n’y paraît. En effet, il n’est pas rare de croiser dans le local de la corporation des étudiants issus de listes indépendantes. Sans avoir été des dirigeants de l’association, ils ont souvent participé à un projet, une organisation ou encore au journal des étudiants. Les élus étudiants se connaissent donc bien, souvent depuis plusieurs années et, qu’ils soient associatifs ou indépendants, partagent la même volonté de faire évoluer les situations au bénéfice des étudiants. Ils se réunissent régulièrement avant les sessions plénières du conseil de faculté afin de définir, s’il y a lieu, une position commune. Il est vrai que souvent, les débats n’y sont tous pas passionnants, qu’ils font souvent référence à des décisions ou à des conflits datant de plusieurs années, que les informations sur les orientations nationales des études médicales sont souvent plus rapidement relayées par l’ANEMF que par les instances universitaires. Les élus étudiants ont souvent l’impression d’apporter leur caution morale des décisions qui ne leur sont pas soumises, que ce soit pour l’approbation du budget de la faculté ou pour la révision des effectifs hospitalo-universitaires. Pour autant, il existe deux moments essentiels de la vie démocratique de la faculté où les élus jouent un rôle primordial : l’élection du Doyen de la faculté, et la révision annuelle du fascicule de contrôle des connaissances, c’est-à-dire les conditions d’obtention des examens.
L’élection du Doyen est un moment important de la vie de la faculté. Le Conseil désigne en son sein, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, son président. L’exercice du décanat se joue souvent à quelques voix près, et le vote des étudiants peut influer sur le choix définitif du doyen. En effet, les étudiants des premier, deuxième et troisième cycles représentent un quart des voix, soit 10 voix sur 40. Et là où les différents représentants des personnels et enseignants de la faculté sont souvent divisés, il n’est pas rare de voir les étudiants unanimes. C’est pourquoi un candidat, par l’intermédiaire de son premier assesseur, nous a un jour contacté, inquiet du score qu’il avait obtenu, pensant que les étudiants l’avaient désavoué alors que la défection était parmi les siens. Un autre candidat au décanat n’a pas hésité à tenter de séduire les élus étudiants, allant jusqu’à les rencontrer dans un bar “branché” pour leur exposer les grands points de sa politique étudiante, pour rappeler son souci permanent du dialogue avec les étudiants, pour affirmer son respect pour le travail des associations sur le campus. Une fois élu, en partie grâce à ce vote étudiant, la désillusion fut importante lorsque l’on se rendit compte que les promesses restaient lettres mortes et que la démocratie universitaire s’étiolait.
La découverte d’une trahison est douloureuse ; malgré un renouvellement important, l’étudiant en médecine est connu pour ses prouesses de mémorisation.
Un autre moment important pour les élus étudiants est la révision annuelle du contrôle des connaissances. Une certaine expérience est nécessaire pour s’assurer du contenu de ce fascicule de près de 200 pages où la moindre ligne peut se transformer en un piège lors de la validation des enseignements. Non pas que le corps professoral souhaite sanctionner les étudiants, mais leur désir de former des étudiants omniscients peut conduire à des conditions de validation inacceptables, sources d’échec certain. Ainsi, en 1995, devant la volonté du Conseil de faculté de voir les étudiants valider leur année par l’obtention de la moyenne à chacune des épreuves de l’année1, il a fallu que nous et Emmanuelle Cadic nous démenions lors d’un Conseil d’université pour faire invalider cette décision, arguant du fait que toutes les autres composantes de l’université ne demandaient que la moyenne générale annuelle assortie d’une note éliminatoire. Après de longues négociations, nous avons finalement obtenu gain de cause, et ces conditions de validations sont actuellement toujours les mêmes, c’est-à-dire le moyenne générale annuelle assortie d’une note éliminatoire inférieure à 7/20.
Comme on le voit, le rôle joué par les élus aux conseils d’université, bien que moins connu, est tout aussi essentiel. Le Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) et le Conseil d’Administration (CA) valident en effet une partie des décisions prises en Conseil de faculté. Là encore, la majorité des débats reste essentiellement techniques, et le rôle des élus étudiants se résume souvent à la surveillance du respect des droits des étudiants.
Par ailleurs, il existe à l’université un budget spécifique géré par les élus étudiants, le Fonds d’Amélioration de la Vie Etudiante (FAVE) en faveur des projets étudiants. Une fois par mois, les élus associatifs, indépendants et syndicaux se réunissent afin d’étudier les différents projets déposés (le plus souvent par des associations étudiantes). L’attribution de subventions relève de critères bien définis. Le projet doit en effet permettre d’améliorer des locaux étudiants ou des conditions d’étude, de favoriser les échanges au sein de l’université de Rennes I ou avec d’autres universités étrangères. Mais le projet ne doit pas avoir de vocation commerciale, et l’attribution d’une subvention ne doit pas pallier les éventuelles déficiences financières du ministère de l’Enseignement supérieur. C’est pourquoi les projets sollicitant l’obtention de matériel d’étude ou entrant dans le cadre de stages universitaires obligatoires sont tous refusés. La Commission d’Amélioration de la Vie Étudiante (CAVE) qui gère ce fonds prélevé sur chaque inscription à l’Université (environ 50 francs par étudiant) est souvent le siège d’âpres discussions, les élus syndicaux sont plutôt favorables à des projets de grande ampleur, concernant l’ensemble de l’université, alors que les élus associatifs soutiennent volontiers des petits projets, utiles chaque jour aux étudiants. Ceci peut conduire certaines années à une relative inaction de la CAVE, une part importante du FAVE restant alors inutilisé.
Pour autant, on peut considérer que les rapports entre les élus associatifs et syndicaux restent cordiaux, devenant même parfois amicaux. Leur but est en effet identique : œuvrer dans l’intérêt des étudiants. Par contre, les rapports entre les appareils, syndicats étudiants et corporations, sont la plupart du temps inexistants ou deviennent clairement conflictuels à l’approche d’un scrutin.
L’AAEMR et les syndicats étudiants
Comme nous l’avons déjà vu, deux syndicats sont majoritaires dans le monde politique étudiant : l’UNEF-ID et l’UNEF-SE. L’attitude peu constructive et plutôt conservatrice de l’UNI ne lui donne que peu de poids parmi les étudiants. Pour exemple, certains de ses militants, dont deux d’obédience villieriste, se sont présentés à l’élection du Conseil de la faculté de médecine, ainsi qu’aux Conseils centraux de l’université en 1993. L’absence de culture syndicale sur le campus a conduit un certain nombre d’étudiants à leur accorder leur vote alors même qu’ils pensaient voter pour des candidats indépendants et apolitiques. Toujours est-il qu’une fois élus, les représentants de ce syndicat se sont fait remarquer par une passivité extrême voire par un absentéisme régulier lors des conseils de faculté. Ils n’ont que rarement participé aux réunions entre les élus, leur représentant au CA de l’université n’a quant à lui, jamais siégé. La manœuvre est claire, recueillir des voix et donc des sièges afin d’obtenir pour leur structure politique une subvention selon leur représentativité, sans se soucier des intérêts étudiants.
L’attitude des deux UNEF est plus directement inspirée de leur histoire gauchiste. Faite d’alternance entre déstabilisation et infiltration, elle manipule le milieu étudiant surtout depuis la fin des années 80 et la montée du mouvement associatif. Cette attitude reste cependant peu efficace envers des structures apolitiques refusant le discours conflictuel incarné par les syndicats. C’est pourquoi une partie des militants de l’UNEF-ID propose, lors d’un congrès en 1994, un texte fédérateur devant aboutir à la création d’une Confédération de la Jeunesse Scolarisée (CJS)1, regroupant les deux UNEF, les associations et corporations d’étudiants, les associations monodisciplinaires. Ce texte est alors refusé par les congressistes car il implique une réorientation du syndicat vers les activités de services et une réelle indépendance politique. Cette tentative d’infiltration globale du monde étudiant étant rejetée, l’UNEF-ID poursuit alors sa politique de déstabilisation.
Prenons pour unique exemple un fait récent : la manifestation du 8 mars 2001 devant les locaux de la faculté de médecine de Rennes. Prétextant une certaine misogynie lors d’un article paru trois mois auparavant dans le journal étudiant de la faculté (La Carabine, éditée par l’AAEMR), une manifestation “spontanée” s’est organisée devant la faculté en cette “Journée de la Femme”. Les médias locaux avaient été prévenus bien à l’avance, les étudiants présents venaient des campus des facultés de Lettres ou de Sciences (fiefs rennais de l’UNEF-ID), les mégaphones utilisés étaient marqués UNEF-ID. Cette manifestation s’est déroulée moins de trois semaines avant le renouvellement du collège étudiant au sein des conseils de faculté et d’université… il est regrettable que devant cette manipulation, les responsables universitaires n’aient pas jugé utile de soutenir l’association apolitique présente sur leur campus, fragilisant un peu plus, par leur silence, la place de la corporation au sein de la faculté.
Les dirigeants de la corporation doivent donc toujours rester vigilants, car une charge plus violente que les autres peut un jour faire basculer l’AAEMR dans le syndicalisme, par le biais d’une infiltration savamment orchestrée. Ce fut d’ailleurs le cas, entre autres, pour les corporations d’étudiants en médecine de Nantes en 19832, de Clermont-Ferrand en 1991. En effet, assimilant apolitisme et conservatisme, corporatisme et dérive droitière, critiquant le manque d’engagement lors des mouvements étudiants et un esprit insuffisamment revendicatif, l’UNEF-ID peut un certain temps faire illusion et s’emparer des bureaux dirigeants des associations d’étudiants, faisant naître ainsi un climat conflictuel dans des facultés jusque alors assez tranquilles. Cependant, les corporations, et notamment l’AAEMR, savent prendre leurs responsabilités lorsqu’elles considèrent que les intérêts des étudiants en médecine sont en jeu, et peuvent alors, si nécessaire, mobiliser leurs adhérents ainsi que les autres carabins.
L’AAEMR et quelques actions revendicatives
Les facultés de médecine sont plutôt des lieux calmes, peu animés par les syndicats et d’opinion assez conservatrice. Pour autant, les carabins n’hésitent pas à défendre leurs intérêts lorsqu’ils considèrent que ceux-ci se trouvent menacés. Ces actions revendicatives ne reçoivent pas toujours l’appui de la corporation des étudiants, soucieuse d’éviter de remettre en cause le consensus interne et la neutralité externe qui lui a permis de se développer1.
A l’automne 1986, à l’appel des deux UNEF, de nombreux étudiants se sont émus puis mobilisés contre le projet Devaquet. La formation des étudiants en médecine ne paraît pas directement concernée par ce texte, mais l’avenir des étudiants en première année recalés à l’issue du concours, semble être menacé par une prétendue privatisation des différentes filières de l’Université. C’est pourquoi, répondant à des appels par voie d’affichage dans l’enceinte de la faculté, nous, en compagnie de Gaëtan Legaillard et de Céline Faizant, nous retrouvons à une Assemblée Générale (AG) dans l’amphithéâtre Chateaubriand à la faculté des Lettres. Des syndicalistes étudiants, orateurs de talents, se succèdent à la tribune et parviennent à nous convaincre de la nécessité de relayer les informations dans les amphithéâtres de la faculté de médecine.
Après une première AG regroupant principalement des étudiants de PCEM 1, il est décidé de procéder à un vote sur la participation des étudiants en médecine à ce mouvement en votant la grève. À la demande de l’AG, le vote se déroule à bulletin secret, devant le grand amphithéâtre (aujourd’hui amphithéâtre Marcel Simon), la carte d’étudiant servant de carte d’électeur, son poinçonnement attestant du vote effectué. Malgré le poids du concours de fin d’année, une grève de trois jours est votée à la faculté. Afin de pouvoir éditer des tracts indiquant à tous les carabins les inquiétudes des étudiants de première année, nous avons sollicité l’aide de l’AAEMR. Cette aide nous est refusée, la corpo ne voyant dans ce projet de loi aucun élément susceptible de remettre en cause l’avenir des étudiants en médecine. De plus, l’agitation provoquée en cette première cohabitation gouvernementale par des syndicats de gauche semble agacer nombre d’étudiants des années supérieures, l’AAEMR reste alors, par ce refus, fidèle à sa conduite apolitique. Les tracts sont donc édités grâce à une quête auprès des étudiants concernés.
Mais les conflits d’intérêts entre les étudiants de première année et ceux qui ont déjà réussi le concours, conduit à un isolement de la nouvelle génération au sein de la faculté. La nécessité d’assister aux cours pour obtenir ce concours aboutit rapidement à un essoufflement du mouvement de grève, les étudiants de PCEM 1 continuant tout de même à participer aux nombreuses manifestations organisées. Le projet Devaquet est retiré à la suite de l’événement tragique que nous avons déjà évoqué. À la fin de ce mouvement étudiant, la carte d’adhérent à l’UNEF-ID nous a été offerte, peut-être pour tenter une implantation à la faculté de médecine ; nous l’avons refusée.
Au printemps 1993, un autre courant de protestation envahit la faculté de médecine de Rennes. Suite à la diminution de nombreux étudiants du fait d’une sévérité drastique du numerus clausus, le Conseil de faculté décide d’obliger les étudiants de quatrième année à effectuer des stages d’externes durant l’été. Sous couvert d’une amélioration de la formation, il compte ainsi pallier les difficultés de fonctionnement que connaissent de nombreux services hospitaliers durant la saison estivale. Pour les étudiants le problème est double : non seulement aucune rémunération n’est prévue pour ce stage, mais en plus, il n’existe aucune couverture sociale ni protection juridique lors de ces stages1. La colère monte parmi les étudiants et, à l’initiative de Cynthia Garignon et de Yann Lebrun, une AG est organisée, aboutissant au vote d’une grève solidaire des stages hospitaliers, de la quatrième à la sixième année. En effet, de nombreux étudiants profitent des vacances d’été pour occuper de petits emplois qui leur permettent de poursuivre leurs études. Ces conditions de stages sont donc inacceptables en l’état.
L’AAEMR soutient alors les revendications de ces étudiants, participe aux différentes AG, prête ses locaux et son matériel, mais n’intervient pas directement dans les négociations avec la faculté ou avec la direction du CHU. Elle ne peut officiellement s’opposer à ce qui est présenté comme une amélioration de la formation des étudiants. Fort heureusement, les autorités administratives tendent une oreille attentive aux difficultés que pourraient rencontrer les étudiants lors de ce stage, et s’emploie à répondre leurs demandes. Une ligne budgétaire est donc créée afin de les rémunérer et de leur octroyer une protection juridique pour les actes effectués. Le statut d’étudiant hospitalier est donc accordé au CHU de Rennes à partir du quatrième trimestre de la quatrième année universitaire de médecine.
Mais pourquoi une telle différence de statut entre les externes de quatrième année et les autres, le travail effectué étant identique. Les externes participent tous aux gardes, aux activités de soins et de tenue des dossiers médicaux, quelle que soit leur année. L’ANEMF s’est déjà inquiétée de cette situation depuis de nombreuses années2, mais la réponse du ministère de la Santé est toujours la même : les étudiants de quatrième année ne participent ni aux gardes, ni aux activités de soins puisque seuls les étudiants hospitaliers y sont autorisés. Les nécessités de bon fonctionnement des services hospitaliers sont donc délibérément ignorées par le ministre des Affaires Sociales, Jacques Barrot et le secrétaire d’État à la Santé, Hervé Gaymard. Les étudiants de quatrième année restent donc sans rémunération, ni protection juridique pour les actes effectués.
Cette situation absurde amène une nouvelle fois les étudiants en médecine à s’opposer au ministère de la Santé au printemps 1996, les négociations entreprises par l’ANEMF depuis plusieurs années étant inefficaces. Ainsi, une fois les examens passés, les étudiants votent une grève dans presque toutes les facultés de médecine, désirant démontrer par leur absence des services hospitaliers leur rôle effectif, et donc, faire pression auprès des instances administratives des CHU afin d’obtenir du ministère un statut uniforme pour les externes ainsi qu’une revalorisation des tarifs de garde. Le bras de fer avec l’administration dure quinze jours. L’AAEMR apporte son soutien aux étudiants, ses dirigeants et d’anciens membres décident d’organiser chaque matin, à la fin de l’AG quotidienne, une évaluation de tous les terrains de stages fréquentés par les étudiants. Plus d’un millier de réponses est ainsi collecté1, elles sont analysées puis regroupées dans un rapport remis fin juin au Doyen. Les conclusions de ce rapport et les critiques des étudiants à l’encontre de certains stages sont si virulentes qu’il nous est demandé de ne le diffuser ni à l’ensemble du corps professoral, ni à la presse comme nous l’avions initialement prévu. En retour, nous obtenons que certaines remarques soient prises en compte afin d’améliorer, dans les années qui suivent, l’accueil et la formation dans les services hospitaliers mis en cause. Ce sera chose faite.
Quant au statut des étudiants de quatrième année, l’ANEMF obtient la promesse du ministère d’organisation dans un bref délai de nouvelles négociations, ainsi qu’une petite revalorisation du tarif des gardes. Le mouvement s’étiole donc au début de la période estivale. Mais les étudiants doivent de nouveau organiser un mouvement de grève en avril 2000 pour que finalement l’extension du statut d’étudiant hospitalier soit définitivement accordé aux étudiants de quatrième année.
La corporation des étudiants ne s’engage donc dans un conflit que lorsque les intérêts des étudiants en médecine sont directement menacés, sur le plan local au sein du CHU ou de la faculté de Médecine, ou sur le plan national, en association avec les corpos des autres facultés au sein de l’ANEMF.
L’AAEMR et sa représentation nationale
L’ANEMF est une association représentative des étudiants en médecine depuis 1989. Elle se trouve régulièrement en contact avec les ministères de la Santé et de l’Éducation nationale, et un de ses représentants siège à la Commission permanente du Conseil National de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CNESER). Trois structures participent au fonctionnement de cette association monodisciplinaire. Deux d’entre elles correspondent à un pouvoir exécutif, le bureau et le Conseil d’Administration (CA) et la troisième est de type législatif, l’Assemblée Générale de l’association1.
Le bureau est composé de neuf membres, élus en assemblée générale pour un an. Il représente l’ANEMF auprès des ministères, de la presse, de toute autre structure nationale. Le bureau participe également à la gestion des affaires courantes et définit l’orientation de l’ANEMF face aux réformes des études médicales ou à la politique de santé décidée par le ministère de tutelle.
Le CA est composé des présidents et présidentes des associations affiliées. Il se réunit quatre à cinq fois par an afin de délibérer sur la majeure partie des actions et décisions de l’ANEMF. Lors de ces votes, leurs voix sont pondérées par le nombre d’étudiants admis au numerus clausus dans leurs facultés d’origine, afin de mieux représenter l’ensemble des étudiants. Sur un nombre de 39 corporations d’étudiants en médecine existant en France, 38 sont adhérentes à l’ANEMF, ce qui lui confère une très forte position face aux instances de l’État pour la défense des intérêts des étudiants en médecine. Pour garder cette efficacité, l’ANEMF doit se garder de toute attitude partisane. La tentation existe cependant à l’occasion de débats houleux au sein du CA lors de périodes de conflit ou lorsque le ministère ne prête qu’une oreille distraite aux revendications des étudiants.
L’Assemblée générale de l’ANEMF se réunit deux fois par an, à la fin de l’année universitaire pour élire le bureau, et à l’automne, lors d’un congrès afin de définir la politique générale de l’ANEMF et d’écouter les rapports des nombreuses commissions de travail (réforme des études médicales, orientations pédagogiques, préparation à l’internat, évaluation des stages, organisation des gardes, stages à l’étranger…). Certaines personnalités, notamment des conseillers proche du ministre de la Santé, un représentant du Conseil National du Concours de l’Internat (CNCI) ou encore un membre de la Conférence des doyens, sont également invités à participer à ce congrès afin de débattre directement avec les étudiants présents.
Pour diffuser ses informations, l’ANEMF dispose, en plus des représentants de chaque corporation, de quelques publications comme La Lettre aux Assos, La Lettre aux Élus et encore Avenir Médical, trimestriel destiné à un plus large public. Elle a également participé à la rédaction et à la publication du Guide de l’Externe et du Guide des Urgences Médico-Chirurgicales.
L’ANEMF est donc une association efficace et reconnue, dont le travail est apprécié non seulement par tous les partenaires institutionnels mais aussi par une grande majorité des étudiants ou, du moins, ceux qui connaissent son existence. Il faut en effet déplorer que bon nombre d’étudiants “consommateurs” au sein des corpos, ne connaissent pas cette structure essentielle, ou se désintéressent du travail accompli.
Mais l’ANEMF ne se contente pas d’avoir une action nationale. Elle est représentée de longue date au sein de l’International Federation of Medical Student Association (IFMSA) dont le but est de promouvoir les échanges internationaux des étudiants en médecine et de comparer les modalités d’enseignement dans différents pays à travers le monde. Malheureusement, la masse du travail nécessaire à l’obtention du concours de l’internat ainsi que la barrière des langues retiennent souvent l’enthousiasme des étudiants français pour partir à l’étranger. En ce qui concerne la coopération européenne, l’ANEMF a accueilli fut un temps, au sein de son bureau, le coordinateur national de l’European Medical Student Association (EMSA) avant que celle-ci ne devienne caduque.
L’EMSA est fondée en 1990 sur l’initiative d’étudiants belges, sur un modèle fédéraliste similaire à l’American Medical Student Association (AMSA). Elle peut être définie comme une association monodisciplinaire à l’échelle de la CEE, regroupant toutes les associations locales d’étudiants en médecine, un coordinateur national représentant chacun des douze états membres. Au titre de la participation de la faculté de médecine de Rennes au projet ERASMUS (programme d’échange entre étudiants de la communauté européenne), l’AAEMR a été conviée à l’assemblée constitutive en janvier 1990 à Louvain-la-Neuve près de Bruxelles. Eric Mener, ancien président de la corpo est alors mandaté pour la représenter. À son retour, son enthousiasme est grand pour cette nouvelle structure, tant les idées défendues sont nouvelles. Le principal projet de l’EMSA est d’aboutir à une harmonisation des cursus de formation médicale à travers l’Europe afin d’obtenir non pas une équivalence de diplôme final, mais une équivalence de chaque année validée, et de permettre ainsi une plus grande mobilité des étudiants en médecine. L’AAEMR décide donc de participer activement à ce projet, et, les années suivantes, nous nous rendons à plusieurs reprises à Bruxelles afin d’apporter aux débats les explications nécessaires à la compréhension de la formation médicale en France.
Malheureusement le but s’avère hors d’atteinte tant la diversité des modalités d’enseignement est importante au sein de la communauté européenne, et aucun gouvernement des états membres ne semble intéressé par ce projet. L’EMSA se rend alors compte que ses idées sont peut-être trop en avance sur la réalité de la construction européenne. Elle limite alors son action à une simple coordination entre les associations locales d’étudiants1. Une ouverture précoce aux pays de l’Est de l’Europe (les associations présentes au sein de l’EMSA représentent alors plus de vingt états) l’oriente dans une simple politique d’échanges internationaux tant la demande des pays de l’Est est forte. Ceci la fait directement entrer en concurrence avec l’IFMSA. De plus, certaines rumeurs circulent sur les ambitions politiques de certains membres du bureau exécutif, voulant utiliser l’association comme un tremplin. Son action devenant inefficace, son bureau n’étant plus digne de foi, la plupart des associations étudiantes des états membres de la CEE la quittent2, l’EMSA n’est plus représentée au bureau de l’ANEMF. Le projet de l’EMSA était vaste et somme toute utopique, mais un jour peut-être l’EMSA réapparaîtra-t-elle afin de le mener à bien.
Que ce soit au sein de l’ANEMF, l’IFMSA ou encore l’EMSA, les étudiants engagés dans les corpos participent à de nombreux congrès. Les discussions y sont souvent riches, la confrontation des expériences essentielle. Pour autant, l’heure venue, ces étudiants n’oublient pas qu’ils sont aussi des carabins, ils arborent alors leurs faluches et entonnent quelques chansons paillardes, fidèles à une tradition rabelaisienne.
L’AAEMR et la tradition estudiantine
La tradition estudiantine est restée forte dans les facultés de médecine. Elle permet à l’étudiant de se reconnaître au travers d’un groupe1, et probablement l’aide à exorciser les premiers contacts avec la maladie ou la mort. Le port de la faluche est une de ces traditions. La faluche2 est la coiffe des étudiants. Cette tradition remonte au congrès de Bologne (Italie) en juin 1888 où les étudiants français, comparant la pauvreté de leur costume sombre et les costumes multicolores des autres délégations étrangères, décident d’adopter le béret des étudiants bolonais ; il en rapportent l’usage en France. Tout étudiant, quelle que soit sa discipline, peut l’arborer.
Longtemps la faluche est régie par un code transmis par oral ; les premières transcriptions écrites sont assez récentes puisqu’elles datent des années 19603. Elle tombe en désuétude après les événements de mai 68, puis réapparaît dans les facultés de médecine, pharmacie, art dentaire, droit et sciences économiques au milieu des années 804. Elle renaît à l’AAEMR en 1985 sous l’impulsion de Nicolas Velmans, premier Grand Maître de la faluche dans la faculté. En effet, en 1986 est définie dans une nouvelle actualisation du code la notion de Grand Maître, garant de la tradition au sein de sa faculté et chargé de décerner certains insignes. Il est parfois accompagné d’un assistant, le Grand Chambellan, pour accomplir sa tache. Le Grand Maître est nommé par son prédécesseur, ce qui conduit au fil des ans, à une véritable filiation adoptive. Mémoire du folklore, il anime les soirées étudiantes et contribuent au maintien des traditions étudiantes dans la faculté.
La faluche est un béret de velours noir. Certains détracteurs y voient une origine militaire, ce qui est faux. D’une part, dans les écoles militaires, les étudiants portent des calots et non pas des bérets, d’autre part, à la différence des bérets militaires, la faluche est ceinturée à sa base d’un ruban aux couleurs de la faculté (velours rouge pour les facultés de médecine)1. Sur ce ruban sont portés les initiales de l’étudiant, son surnom s’il en a un, la série de son baccalauréat et son année d’obtention, l’insigne de la discipline (initialement pour les facultés de médecine une tête de mort sur des fémurs croisés puis de nos jours un caducée) et enfin le cursus universitaire. Le cursus est symbolisé de la sorte : une étoile par année d’étude, dorée si l’année est validée, argentée si elle est redoublée, la tête de vache symbolise l’échec aux examens de la première session, la tête de mort l’échec total dans la discipline ou au concours d’entrée. Des palmes sont également portées pour les diplômes obtenus. Depuis la réforme de la loi Faure, un ruban allant du frontal à l’occipital, de couleur jaune, traduit l’élection de l’étudiant dans un Conseil avec, à son extrémité une grenouille par année d’élection. Celle-ci est dorée pour le Conseil d’Université, argentée pour le Conseil de faculté.
L’apparition de badges et autres insignes sur le velours noir semble remonter aux années 1940. La présence sur ce même velours d’écussons et de rubans aux couleurs de la ville natale et de la région où siège l’université de l’étudiant datent du milieu des années 1960 ; ces couleurs étant fortement inspirées de l’héraldique médiévale2. Les insignes distinctifs deviennent de nos jours de plus en plus nombreux. Nous en retiendrons quelques-uns : le cochon pour l’étudiant bizuté, le coq pour l’étudiant “fort en gueule”, la chouette pour l’oiseau nocturne, l’épi de blé et la faucille pour la chance aux examens, la bouteille de bordeaux pour une soirée par trop arrosée, le bacchus lorsque l’étudiant se montre plus digne dans l’ivresse, le pendu pour l’étudiant marié, la faux pour un décès survenu lors d’une nuit de garde…ces mêmes insignes sont utilisés par nos amis belges pour couvrir leur penne traditionnel.
Tout étudiant après le baccalauréat peut devenir un faluchard. Il faut cependant noter qu’une grande majorité d’entre eux se retrouve dans les facultés. Il n’existe pas de rite initiatique à proprement dire, l’impétrant est simplement baptisé par un parrain, celui-ci lui remet alors un premier badge en guise de filiation. Ses seuls devoirs sont de connaître le code de la faluche, de rester digne quelles que soient les circonstances et de respecter son Grand Maître et ses condisciples. Il doit cependant avoir un esprit suffisamment ouvert pour répondre aux quolibets par des explications aimables sur les raisons de son appartenance à un groupe qui porte de manière si ostentatoire un béret étudiant.
Lors de congrès ou de réunions d’étudiants, la connaissance du code de la faluche permet une lecture rapide de celle-ci, et participe, de ce fait, au rapprochement de faluchards qui ne se connaissent pas. Lorsque cette rencontre devient sympathique et amicale, lorsque les centres d’intérêts des faluchards sont identiques, lorsqu’ils ont partagé la bonne chère et parfois l’ivresse, il n’est pas rare de voir ces faluchards échanger les insignes de leur corpo d’origine ou s’offrir un pin’s en souvenir. Certaines faluches se parent alors d’une multitude de petits badges, marques d’autant de rencontres enrichissantes.
Dans certaines facultés, il existe parfois, à l’envers du velours noir un jardin secret, le potager, symbolisant les exploits sexuels de l’étudiant durant ses soirées festives. Ainsi peut-on lire dans le code de la faluche daté de 1976 cette précision cocasse1 :
Tout étudiant ayant, au cours de sortie, repas ou soirée, tiré un coup en bonne et due forme, devra mettre à l’intérieur de sa faluche : une carotte, signe de son acte valeureux et digne du grand baisouillard qu’il est, pour une pipe dûment accomplie un poireau, et pour l’enculage un navet. Ceci sous l’œil attentif des anciens, dignes contrôleurs des actes accomplis. Pour tout dépucelage, il aura droit, suivant l’endroit, à deux légumes placés en X.
Fort heureusement très peu d’étudiants sont concernés par ce potager, véritable atteinte à la dignité humaine. À notre connaissance, il n’en a existé aucun à la faculté de médecine de Rennes. Mais cet article témoigne d’un esprit paillard, d’une certaine grivoiserie que l’on peut retrouver dans les chansons d’étudiants ou de salles de garde.
Les paillardes sont entonnées en groupe et renforce sa cohésion. Qu’elles soient anciennes ou récentes, elles chantent la sexualité, s’amusent de l’adultère, égratignent l’autorité comme celle du curé ou du gendarme, plaisantent le coup de pied de Vénus, ou raillent la maladie. Ces chansons sont fort nombreuses, réunies en un bréviaire. Les airs sont connus de plusieurs générations de carabins. Qui ne connaît De profundis morpionibus, La Petite Charlotte, Les Stances à Sophie, Le Pou et l’Araignée, l’Hôpital Saint-Louis, ou notre favorite Le Plaisir Des Dieux…
Quelques carabins ont tenté d’organiser une chorale paillarde à la faculté de médecine en 1989, mais, malgré l’aide précieuse du Professeur François Picard, elle ne vécut qu’une seule année, la majorité des étudiants présents jugeant ces répétitions trop rébarbatives. Pour autant, les airs sont régulièrement fredonnés à l’AAEMR, dans les repas d’étudiants et certaines soirées, participant ainsi à leur transmission orale. Il faut cependant noter que tous les chanteurs ne se valent pas…
Cependant, cette tradition paillarde tend à s’estomper. L’esprit grivois associé à un certain ivresse de la rhétorique semble disparaître. C’est pourquoi en avril 1993, en compagnie de Jean-François Gautier, Grand Maître à l’époque, et d’Emmanuelle Cadic, alors vice-présidente de l’AAEMR, nous avons fondé l’Association des CArabins Rennais Initiés aux Épreuves Nocturnes (ACARIEN) afin de promouvoir dignement la parole de maître François Rabelais et d’assurer la pérennité de son subtil esprit. Cette association s’ouvre à tous les étudiants de la faculté de médecine de Rennes, ainsi qu’à tous les médecins issus de cette même faculté, pour peu qu’ils se reconnaissent dans l’œuvre rabelaisienne et qu’ils aient validé un dossier initiatique. Le nouveau membre est alors coopté par les anciens. Elle organise régulièrement des diners-débats, et ses membres rivalisent de bons mots ou de contrepèteries, maniant habilement l’art de décaler les sons. Les étudiants membres de cette association, souvent autrefois engagés à l’AAEMR ou anciens élus dans les conseils de faculté, espèrent ainsi lutter contre la disparition de cette tradition séculaire qu’est la paillardise.
Car une autre tradition très ancienne a récemment disparu : le bizutage. Son origine remonte au Moyen Age, puisque dès le XIIIe siècle, puis dans l’Ancienne France, l’affirmation corporatiste de l’Université isole les étudiants du reste de la société1. Ils ont leurs propres mœurs et coutumes, le milieu estudiantin est alors organisé en “nation”, regroupant les étudiants selon leur origine nationale ou régionale.
Par leur fonctionnement, ces “nations” peuvent être considérées comme des confréries puisqu’il existe des obligations de solidarité entre ses membres et qu’elles accordent aux plus anciens un pouvoir hiérarchique. La fin de l’adolescence, la séparation du milieu familial consacrent l’entrée du jeune novice dans sa vie d’homme, et le pousse à affirmer des valeurs viriles dans un monde exclusivement masculin. Le temps des études est alors considéré comme une période transitoire où l’étudiant est débarrassé des contraintes familiales et pas encore assujetti aux contraintes professionnelles. Son appartenance au groupe est donc soumise à un rite initiatique, à une suite codifiée d’épreuves d’où la violence n’est pas exclue. Une fois la cérémonie terminée, le novice s’acquitte d’une dîme destinée à financer la consommation de vin du groupe, puis est coopté par les anciens dans un joyeux banquet. Déjà à l’époque, Erasme s’insurge contre cette tradition, la qualifiant d’ineptie cruelle, alors que Luther se déclare favorable à cette initiation, prologue aux difficultés que l’étudiant peut rencontrer dans la vie2.
Ce rite initiatique, ce bizutage, a traversé les siècles jusqu’à nos jours. Son déroulement est assez codifié. La séparation physique des novices du reste de la communauté est considérée par certains sociologues comme une mise à mort sociale, l’organisation structurée des anciens donne une illusion de force aux jeunes étudiant qui ne se connaissent pas encore, le déguisement amplifie un sentiment d’irréalisme. Les épreuves évaluent des qualités telles que le courage, le sang-froid, l’endurance physique et morale, les transgressions sexuelles sont fréquentes, amplifiées par des actes mimés, l’intégrité corporelle peut être mise à mal (coupe de cheveu, maquillage)3. Rares sont ceux qui refusent de participer à ce rite initiatique, probablement par peur d’être rejeté du groupe4. Une fois terminée, cette épreuve probatoire est souvent suivie d’une cérémonie de réconciliation établissant ainsi l’objectif final du rituel, le lien social entre les anciens et les novices. Pourtant, assez bien accepté par l’immense majorité des étudiants, l’aspect tribal du bizutage inquiète certains groupes de pensée. la rentrée 1997-1998, une campagne de presse encore plus agressive à l’encontre du bizutage que les années précédentes, quelques exactions inacceptables qualifiées de “dérapages” avec “atteinte à la dignité humaine” conduisent le ministre de l’Éducation nationale, Claude Allègre, et la ministre déléguée à l’Enseignement scolaire, Ségolène Royal, à transmettre une circulaire à tous les responsables d’établissement de l’enseignement supérieur. “L’instruction concernant le bizutage” explique1 :
Chaque année le ministère de l’Éducation nationale est informé de vexations, d’humiliations, de brimades ou d’actes dégradants imposés à des élèves ou des étudiants. Ces pratiques de bizutages, présentées par leurs adeptes comme un rite initiatique, ne sauraient durer.(…)Il apparaît en effet que très souvent, de jeunes élèves ou étudiants se plient à des traditions présentées comme un puissant vecteur d’intégration et se résignent à effectuer ou à subir certains actes par crainte de représailles.
Puis elle énumère les dispositions législatives à l’encontre du bizutage : violences entraînant une incapacité de travail (due à un stress ou à un choc émotionnel), violences avec préméditations, agressions sexuelles, non-assistance à personne en péril, non-dénonciation de mauvais traitements ou encore privations infligées à une personne particulièrement vulnérable… En conclusion elle appelle à la fin des pratiques de bizutages avec cet argument final :
Seule la fermeté permettra de mieux assurer la dignité des élèves et des étudiants, et d’éviter que les plus fragiles d’entre eux ne renoncent à des études ou ne recourent aux pires extrémités telles que le suicide, pour échapper à des pratiques d’un autre âge.
La loi du 17 juin 1998 fait du bizutage un délit, même en l’absence de violences ou de menaces, et engage la responsabilité pénale de personnes morales, donc des associations organisatrices en plus des individus impliqués.
Cette décision de suspendre le bizutage fait grand bruit dans les universités, et notamment à la faculté de médecine de Rennes. Cette interdiction n’est pas comprise. L’AAEMR, souvent aidée des Acariens, participait régulièrement à l’organisation du bizutage depuis 1989. Aucun dérapage n’a été rapporté dans notre faculté malgré les allégations d’une certaine presse. Certes l’ambiance était paillarde, certes certains jeux pouvaient avoir une petite connotation sexuelle, mais en aucun cas il n’était porté atteinte
la dignité humaine. Les novices étaient volontaires pour participer aux jeux, et la date du bizutage leur était souvent communiquée à l’avance. Une plainte fut cependant enregistrée par le secrétariat de la vice-présidence du campus. Les parents d’une étudiante trouvaient choquant que leur fille ait pu voir un homme nu dans un amphithéâtre…
De plus, nombre de novices bizutés remerciaient par la suite les organisateurs car ils se sentaient mieux intégrés dans la faculté et connaissaient désormais des étudiants des années supérieures. Le lien social créé par le bizutage était réel, et ce rituel traditionnel était organisé, à la faculté de médecine de Rennes dans une ambiance bon enfant, empreinte d’humour et de dérision, les organisateurs étant souvent nettement plus ridiculisés que les novices.
Mais déjà depuis plusieurs années les syndicats étudiants, et principalement l’UNEF-ID faisaient campagne à chaque rentrée contre le bizutage avec des tracts précisant qu’il n’existe pas de bizutage intelligent, et se proposant de porter plainte en lieu et place des étudiants. Ce syndicat rendait souvent les corpos responsables de certains dérapages qui n’avaient jamais existé. Nous pouvons considérer que, puisque l’arsenal juridique existait déjà à l’époque pour condamner les auteurs de conduites violentes et autres brimades, l’interdiction pure et simple du bizutage sous pression de quelques syndicats étudiants tend à déstabiliser le monde associatif.
En effet, les difficultés de recrutement de nombreuses associations, telle que l’AAEMR en connaît aujourd’hui, sont probablement secondaires au fait que les nouveaux étudiants ne ressentent plus cet appartenance au groupe des carabins. Un lien social important a été rompu. Au sein de notre faculté, les soirées au sein d’une promotion, les fêtes étudiantes- 70 -se font plus rares et attirent moins de personnes, les étudiants paraissent moins altruistes…Nous sommes alors en droit de penser que cette suppression d’une pratique traditionnelle relève plus d’une action politicienne réfléchie afin d’affaiblir une grande partie du monde associatif étudiant que la conséquence d’une prise de conscience tardive de la violence censée régner sur les campus français lors de la rentrée universitaire.
Et s’il n’est évidemment pas envisageable d’accorder aux étudiants une impunité similaire à celle des étudiants du XVIIIe siècle, le Béjaune montpelliérain trouverait tout de même ses études beaucoup plus ternes de nos jours, tant les traditions et l’esprit paillard ont tendance à s’estomper dans nos facultés.
Conclusion
Le monde étudiant a fortement évolué depuis la création des premières AGE à la fin du XIXe siècle. L’UNEF, la première organisation nationale des étudiants, initialement corporatiste, s’est transformée peu à peu en une représentation syndicale. Deux événements de l’histoire de France ont contribué à cette évolution : l’occupation allemande durant le deuxième guerre mondiale et la guerre d’Algérie. Les orientations du syndicat étudiant se font, au fil du temps, de plus en plus politisées, tendant vers une vision révolutionnaire d’une autre société. L’échec du “mai étudiant” en 1968, les scissions successives au sein de l’UNEF contribuent à une lente désaffection des étudiants envers des structures syndicales devenues gauchistes. Les principaux partis politiques décident alors d’investir le monde étudiant, véritable vivier de militants. Cela contribue principalement à pérenniser une représentation très morcelée, et restreint l’engagement étudiant à une simple action politicienne. Depuis, et malgré de nombreuses tentatives de rapprochement, la grande UNEF, représentante de tous les étudiants, ne reste qu’un vieux souvenir. Et même si l’UNEF-ID et l’UNEF-SE ont fusionné en 2001 pour s’appeler de nouveau UNEF, des menaces de scission des étudiants communistes planent déjà.
Face à cette politisation du milieu étudiant, une conception apolitique de l’engagement étudiant s’est affirmée au début des années 1960. S’organisant autour d’associations locales dans les facultés, elle se regroupe par filière de formation et attire d’autant plus d’étudiants que les structures syndicales se politisent. Afin d’asseoir leur représentativité auprès du pouvoir politique, les associations monodisciplinaires tentent régulièrement de se fédérer. Cependant, la diversité de leurs objectifs corporatistes rend ces unions fragiles et la multiplicité des structures nuit à une bonne compréhension du monde associatif. De plus, la crainte d’une récupération partisane1 provoque la méfiance de certains dirigeants face à une organisation fédérale soucieuse de représenter tout l’univers associatif. Pour autant, la nécessaire représentativité conduit à des rapprochements hier encore impossibles. Ainsi, l’ANEMF et l’UNECD ont rejoint la FAGE en janvier 2002, alors que les autres associations monodisciplinaires des facultés de droit, pharmacie et biologie restent toujours distantes.
Mais contrairement aux syndicats où les antennes locales ne sont qu’une représentation sur les campus d’une organisation nationale, le mouvement associatif s’appuie sur des associations locales (que l’on nomme corporation, BDE…) qui se fédèrent en structure nationale, tentant ainsi de représenter au mieux les intérêts des étudiants.
L’association locale est donc le lieu où l’engagement étudiant est le plus visible. Mais le diversité des objectifs (corporatif, culturel, humanitaire, sportif ou simplement amical…) entraîne une certaine méconnaissance de ce milieu, tant les motivations peuvent être disparates. Néanmoins, l’altruisme semble être un paramètre nécessaire à l’implication de l’étudiant dans une association.
La corporation des étudiants, à l’image de l’AAEMR, est un lieu de socialisation et de convivialité au sein de la faculté. Son action au service des étudiant s’inscrit le plus souvent dans un aspect présent de leurs intérêts, se souciant peu d’une politique à long terme. C’est pourquoi il n’existe que peu d’archives ou comptes-rendus ; les dirigeants ne voulant pas s’embarrasser de souvenirs inutiles. Nous pouvons alors considérer que son action est davantage corporative que corporatiste.
Depuis quelques années, à l’instar de nombreuses corpos, un certain désintérêt des étudiants vis-à-vis de l’AAEMR est constaté. De nombreux éléments peuvent expliquer ce retrait de l’engagement étudiant. Entre autres, nous pouvons invoquer l’incertitude quant à leur avenir, la crainte de sortir de l’anonymat, la peur d’un certain pouvoir universitaire, un accroissement constant du poids des études, la disparition progressive des traditions estudiantines et la perte de la notion de groupe qui en résulte. L’individualisme remplace peu à peu l’altruisme.
Les corporations ont donc besoin d’un réelle sollicitude des instances universitaires afin de renaître chaque année pour œuvrer dans l’intérêt des étudiants. Fait-il récompenser l’engagement associatif par l’attribution de quelques points aux examens ? Certains l’ont proposé.
Lorsque qu’une corpo disparaît, une structure syndicale risque alors de la remplacer car les étudiants ont toujours besoin de porte-parole.
Abréviations des organisations étudiantes
AAEMR : Association Amicale des Étudiants en Médecine de Rennes
AF : Action Française
AG : Assemblée Générale
AGE : Association Générale des Étudiants
AGEMP : Association Générale des Étudiants en Médecine de Paris
AJS : Alliance des Jeunes pour le Socialisme
ANEMF : Association Nationale des Étudiants en Médecine de France
ANEPF : Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France
CA : Conseil d’Administration
CAL : Comité d’Action Lycéen
CAP : Comité d’Action Populaire
CELF : Comité des Étudiants Libéraux de France
CLEF : Comité de Liaison des Étudiants de France
CNEF : Confédération Nationale des Étudiants de France
COSEF : Comité d’Organisation pour un Syndicat des Étudiants de France
ESU : Étudiants Socialistes Unifiés
EMSA : European Medical Student Association
FAGE : Fédération des Associations Générales d’Étudiants
FAGEM : Fédération des Associations Générales d’Étudiants et Monodisciplinaires
FFEC : Fédération Française des Étudiants Catholiques
FGEL : Fédération Générale des Étudiants en Lettres
FNEB : Fédération Nationale des Étudiants en Biologie
FNEF : Fédération Nationale des Étudiants de France
FUA : Front Uni Antifasciste
GUD : Groupement Universitaire de Défense
IFMSA : International Federation of Medical Student Association
JCR : Jeunesse Communiste Révolutionnaire
JEC : Jeunesse Étudiante Chrétienne
MAS : Mouvement d’Action Syndicale
OCI : Organisation Communiste Internationale
UEC : Union des Étudiants Communistes
UEP : Union des Étudiants Patriotes
UFE : Union Fédérale des Étudiants
UGEMA : Union Générale des Étudiants Musulmans d’Algérie
UIE : Union Internationale des Étudiants
UJCML : Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Léninistes
UNECD : Union Nationale des Étudiants en chirurgie Dentaire
UNEDESP : Union Nationale des Étudiants en Droit, Économie et Science Politique
UNEF : Union Nationale des Étudiants de France
UNEF-ID : Union Nationale des Étudiants de France – Indépendante et Démocratique
UNEF-Re : Union Nationale des Étudiants de France – Renouveau
UNEF-SE : Union Nationale des Étudiants de France – Solidarité Étudiant
UNEF-US : Union Nationale des Étudiants de France – Unité Syndicale
UNEMF : Union Nationale des Étudiants en Médecine de France
UNI : Union Nationale Interuniversitaire
UPOE : Union Patriotique des Organisations Étudiantes
UREM : Union Rennaise des Étudiants en Médecine
Annexe 1
La Charte de Grenoble
Préambule
Les représentants des étudiants français rassemblés au Congrès National de Grenoble le 24 avril 1946, conscients de la valeur historique de cette époque :
Où l’union française élabore la nouvelle déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
Où s’édifie le statut pacifique des nations.
Où le monde du travail et de la jeunesse dégage des bases d’une révolution économique et sociale au service de l’homme.
affirment leur volonté de participer à l’effort unanime de reconstruction, fidèles aux buts traditionnels poursuivis par la jeunesse étudiante française lorsqu’elle était la plus consciente de sa mission. Fidèles à l’exemple des meilleurs d’entre eux, morts dans la lutte du peuple français pour sa liberté, constatant le caractère périmé des institutions qui les régissent, déclarent vouloir se placer, comme ils l’ont fait si souvent au cours de notre histoire, à l’avant-garde de le jeunesse française, définissant librement comme bases de leurs tâches et leurs revendications les principes suivant.
Article 1 :
L’étudiant est un jeune travailleur intellectuel.
Droits et devoirs de l’étudiant en tant que jeune :
Article 2 :
En tant que jeune, l’étudiant a droit à une prévoyance sociale particulière, dans les domaines physique, intellectuel et moral.
Article 3 :
En tant que jeune, l’étudiant a le devoir de s’intégrer à l’ensemble de la jeunesse mondiale et nationale.
Droits et devoirs de l’étudiant en tant que travailleur :
Article 4 :
En tant que travailleur, l’étudiant a le droit au travail et au repos dans les meilleures conditions et dans l’indépendance matérielle, tant personnelle que sociale, garanties par le libre exercice des droits syndicaux.
Article 5 :
En tant que travailleur, l’étudiant a le devoir d’acquérir la meilleure compétence technique.
Droits et devoirs de l’étudiant en tant qu’intellectuel :
Article 6 :
En tant qu’intellectuel, l’étudiant a le droit à la recherche de la vérité et la liberté en est la condition première.
Article 7 :
En tant qu’intellectuel, l’étudiant a le devoir :
De définir, propager et défendre la vérité, ce qui implique le devoir de faire partager et progresser la culture et de dégager le sens de l’histoire.
De défendre la liberté contre toute oppression, ce qui, pour l’intellectuel, constitue la mission la plus sacrée.
Annexe 2
Le Plaisir des Dieux
Du dieu Vulcain, quand l’épouse mignonne
Va boxonner loin de son vieux sournois,
Son noir époux, que l’amour aiguillonne,
Tranquillement se polit le chinois.
Va-t’en, dit il à sa foutue femelle, Je me fous bien de ton con chassieux : De mes cinq doigts, je fais une pucelle, Masturbons-nous, c’est le plaisir des dieux. De mes cinq doigts, je fais une pucelle, Masturbons-nous, c’est le plaisir des dieux !»
Bast’ ! laissons lui ce plaisir ridicule,
Chacun, d’ailleurs, s’amuse à sa façon.
Moi je préfère la manière d’Hercule,
Jamais sa main ne lui servit de con.
Le plus sale trou, la plus veille fendasse,
Rien n’échappait à son vit glorieux.
Nous sommes fiers de marcher sur ses traces,
Baisons, baisons, c’est le plaisir des dieux.
Nous sommes fiers de marcher sur ses traces,
Baisons, baisons, c’est le plaisir des dieux !
Du dieu Bacchus, quand, accablé d’ivresse,
Le vit mollit et sur le con s’endort,
Soixante-neuf ! et le vit se redresse,
Soixante-neuf ferait bander un mort.
clitoris ! ton parfum de fromage Fait regimber nos engins glorieux,
À ta vertu, nous rendons tous hommage, Gamahuchons, c’est le plaisir des dieux ! À ta vertu, nous rendons tous hommage, Gamahuchons, c’est le plaisir des dieux !
Pour Jupiter, façon vraiment divine,
Le con lui pue, il aime le goudron.
D’un moule à merde, il fait un moule à pine,
Et bat le beurre au milieu des étrons.
Cette façon est cruellement bonne
Pour terminer un gueuleton joyeux :
Après l’dessert, on s’encule en couronne,
Enculons nous, c’est le plaisir des dieux.
Après l’dessert, on s’encule en couronne,
Enculons nous, c’est le plaisir des dieux !
Quant à Pluton, dieu à la large panse,
Le moindre effort lui semble fatiguant.
Aussi veut-il éviter la dépense,
Et fait sucer son pénis arrogant.
Tout en rêvant aux extases passées,
Tout languissants, nous réjouissons nos yeux
En laissant faire une amante empressée.
Faisons pomper, c’est le plaisir des dieux.
En laissant faire une amante empressée.
Faisons pomper, c’est le plaisir des dieux !
Au reste, amis, qu’on en fasse à sa tête,
Main, con, cul, bouche, au plaisir tout est bon.
Sur quelque autel qu’on célèbre la fête,
Toujours là-haut, on est sur du pardon.
Foutre et jouir, voilà l’unique affaire,
Foutre et jouir, voilà quels sont nos vœux :
Foutons, amis, qu’importe la manière,
Foutons, foutons, c’est le plaisir des dieux.
Foutons, amis, qu’importe la manière,
Foutons, foutons, c’est le plaisir des dieux !
Références bibliographiques
A- Livres et articles
Borella F. et De la Fournière M.
Le syndicalisme étudiant.
Seuil ed., Paris, 1957
Brayet J.O.
L’association des étudiants en médecine de Nantes, 40 ans de corporatisme au service des étudiants
Thèse médecine, Nantes, 1988, n°58
Daniel G.
La faluche (histoire, décryptage et analyse)
Thèse médecine, Lille, 1990, n°166
Delubac H.
L’étudiant en médecine de 1830 à nos jours, aspects socio-psychologiques.
Thèse médecine, Marseille, 1987, n° 400
Depagne G.
Le mouvement associatif et la chirurgie dentaire
Thèse chirurgie dentaire, Paris, 1997, n°10289
Fischer D.
L’histoire des étudiants en France, de 1945 à nos jours.
Flammarion ed., Paris, 2000, 612 pages
Velluet C.
Etre déléguée, témoignages.
Thèse médecine, Paris 6, 1985, n° 05 A
Vernier K.
La symbolique de la faluche
Maîtrise d’ethnologie, Sciences humaines, Strasbourg, 1992
Weitz G.
Associations et manifestations : les étudiants français de la Belle Époque.
Le Mouvement social, juillet – septembre 1982, 120, pp31-44
B- Sites internet
www.anemf.org
www.animafac.net
Le coté obscur de l’assoce, Becquet V., Factuel la revue n°1
L’étudiant, acteur de la vie associative, Becquet V., Factuel la revue n°2
La convivialité au prix du marché et du politique, Taverne D., Factuel la revue n°2
Dossier : l’étudiant, l’université, la cité, conclusion de Cocula A.M., Factuel la revue n°3
Qu’est ce qu’être étudiant, éditorial de Crocq M., Factuel la revue n°3
Propos sur le bonheur d’être engagé quand on est étudiant, Poirier T., Factuel la revue n°3
Le bizutage, une affaire d’État, Crocq M., Factuel la revue n°3
Histoire d’un rituel, Largueze B., Factuel la revue n°3
www.education.gouv.fr
Instruction concernant le bizutage, circulaire n°99-124 du 07-09-99 www.fage.netasso.fr
www.germe.info
Merceron S., Les Cahiers du GERME (Groupe d’Étude et de Recherches sur les Mouvements Étudiants), Spécial n°1, Mars 1996
Monchanblon A., Les Cahiers du GERME (Groupe d’Étude et de Recherches sur les Mouvements Étudiants), Spécial n°3, Janvier 1998
www.ifrance.com/krispi/histoire
Histoire des associations étudiantes françaises, Daniel G., Fischer D., Merceron S., Monchablon A., Raeis O., Tranoy S.
www.lyon.unef.org
Historique du mouvement syndical à Lyon et en France www.unef.eu.org
www.uni.asso.fr
L’UNI, une réaction réfléchie
L’UNI, une réaction spontanée
www.timone.univ-mrs.fr/medecine/divers
Association des Étudiants en Médecine de Marseille (AEM2)
Association Nationale des Étudiants en Médecine de France (ANEMF)
www.transfac.fr
La lente maturation des organisations étudiantes, Cluzel F.
Le mai étudiant à Montpellier, Ganozzi P.M.
L’UNEF et la question de la participation étudiante, Morder R.
Nouveaux regards sur le mai étudiant et jeune, Morder R.
L’identité des étudiants en médecine, Wertheimer C.