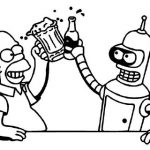A cet effet, je me revois encore en 1942, étudiant de 2ème année et assistant à une clinique en service de médecine. Nous étions tous rassemblés autour de la malade dans un petit box au fond de la salle commune, et nous écoutions avec attention les commentaires de notre moniteur, un jeune chef de clinique, qui devint ensuite un grand professeur que vous avez tous connu.
La patiente était une jeune fille couchée en chien de fusil sur son lit dans la pénombre.
Notre chef, petit par la taille, se hissait à la tête du lit et sur la pointe des pieds pour exprimer d’un ton doctoral des faits importants. Il affirmait que le diagnostic porté, et ceci de façon formelle, était celui de méningite tuberculeuse, bien que l’on n’ait pas trouvé de bacille de Koch dans le liquide céphalo-rachidien, ce qui était habituel à l’époque.
De ce fait, étant donné que nous ne disposions d’aucun moyen thérapeutique efficace, cette pauvre fille était condamnée à une mort certaine. Il ajoutait que le bacille de Koch avait une épaisse capsule de cire qui le rendait acido et alcoolo résistant. On pouvait le tremper dans l’acide le plus concentré ou dans l’alcool absolu sans le détruire, et dans ces conditions, il était impensable de découvrir un jour un traitement efficace.
Vous savez tous ce qu’il est advenu du traitement et du pronostic de cette affection quelques années plus tard avec l’avènement de la streptomycine.
Mais je dois également vous conter l’épilogue de cette histoire. Nous avions tous, jeunes étudiants, été profondément frappés par le destin tragique de cette jeune fille qui avait notre âge. Aussi, huit jours plus tard, nous avons été trouver discrètement la sœur de la salle pour avoir quelques nouvelles sur le sort de la malheureuse. Elle nous accueillit avec le sourire et nous dit qu’on pouvait la voir et qu’elle prenait son déjeuner.
L’externe de la salle nous donna de plus amples explications. En fait le diagnostic de méningite tuberculeuse avait été porté un peu hâtivement, il s’agissait simplement d’une méningite lymphocytaire bénigne spontanément curable.
Cet exemple clinique m’est toujours resté présent et j’en ai tiré deux conclusions :
Tout d’abord l’erreur est possible en médecine et ensuite l’espoir est toujours permis même dans les cas jugés désespérés.
J’ajouterai d’ailleurs que j’ai vu au centre anticancéreux à plusieurs reprises des malades apparemment condamnés à une mort prochaine, renvoyés dans leurs foyers, se présenter quelques mois plus tard à la consultation en pleine santé apparente. A nous d’en tirer une leçon de modestie.
Il faut également garder confiance dans l’avenir de la médecine, des découvertes inespérées pouvant toujours démentir les dogmes les mieux établis.
Etudes médicales
Les études médicales de l’époque duraient 6 ans et étaient précédées d’une année de préparation : le PCB (photo de la promo – 1940) qui se déroulait à la faculté des sciences dans le quartier de la Craffe, c’est à dire à l’Institut de Physique Chimie Biologie.

En 1940, le nombre d’étudiants était limité par les difficultés que beaucoup d’entre nous avaient pour rejoindre Nancy restée en zone interdite. L’atmosphère était celle d’une franche camaraderie renforcée par de nombreuses sorties collectives. A l’occasion de l’une d’elle, vous pouvez voir le futur Professeur Rauber exerçant déjà ses talents oratoires et captivant son auditoire.

1ère année
Après cette année de détente relative, les choses nous paraissaient plus sérieuses, lorsque nous franchissions les portes de la faculté de médecine dans le quartier Saint Pierre.
Les cours et les travaux pratiques étaient communs aux deux premières années, le programme étant étalé sur 2 ans, ce qui favorisait les relations entre étudiants d’années différentes.
Le premier semestre était le plus important car il était consacré à l’anatomie et à l’histologie, qui représentaient alors la base de l’enseignement. Celui de l’anatomie était fondamental et 4 après midi par semaine, nous nous retrouvions tous de 2 à 4 heures en salle de dissection.(photo de la promo – 1941 ).
Inutile de décrire l’impression désagréable ressentie lorsque nous pénétrions pour la première fois dans cette immense salle froide où régnait une forte odeur de formol qui nous prenait au nez et où une dizaine de cadavres étaient alignés sur des tables en pierre. Nous étions accueillis par le Professeur Beau, alors jeune agrégé, dont la froideur apparente de maitre de cérémonie complétait admirablement l’atmosphère morbide.
Mais peu à peu le climat se réchauffait, les conversations engendraient un brouhaha général en même temps qu’un lourd nuage de fumée emplissait la salle, chacun allumant cigarette ou pipe pour se donner du courage avant d’entreprendre la dissection.
La dissection se passait par équipe de 2 ou 3 équipes travaillant sur le même cadavre tout en compulsant le petit Rouvière.

En salle de dissection
Le professeur et les aides d’anatomie passaient de tables en tables pour donner des conseils ; ils se mêlaient volontiers aux discussions qui portaient sur les sujets les plus variés. La première impression désagréable passée, ces heures étaient des moments de détente dont nous avons conservé de bons souvenirs.
2ème année
L’histologie nous était enseignée de façon magistrale par l’un des grands maîtres de l’époque, le Professeur Remy Collin. Ses cours essentiellement consacrés à l’histophysiologie de l’hypophyse, se référaient à des travaux personnels. Il s’exprimait toujours dans un langage châtié et fascinant son auditoire par la clarté de son exposé. Personnage qui nous paraissait déjà d’un autre âge, il portait toujours des binocles et un col dur cassé et amidonné.
Je me souviendrai toujours de l’épreuve de TP d’histologie où j’avais confondu une coupe de testicule avec une coupe d’antéhypophyse. Devant ce sacrilège, les binocles en sont tombés sur la table d’indignation et bien sûr je fus recalé.
Le deuxième semestre était consacré à l’enseignement de la physique, de la chimie et de la physiologie. La chimie et la physique occupaient peu de place.
Le Professeur Robert devait interrompre une fois par semaine son passe temps favori, la pêche, pour venir de Lunéville faire son cours sur les protides, les glucides et les lipides.
Son sujet favori était le lait, et, à cette occasion, il nous faisait l’inventaire de tous les objets insolites que l’on trouvait dans les bidons de lait à la laiterie Saint Hubert, tels que vieilles chaussures, bottes, chats, rats, souris crevés et j’en passe.
Il faut dire que l’examen se passait gentiment. Le candidat était invité à choisir son sujet qui infailliblement était le lait. Seuls ceux qui s’étaient distingués en chahutant pendant les cours étaient recalés.
La physique était enseignée dans une atmosphère houleuse. Le Pr Georges Lamy apparaissait sur son bureau, le visage congestif, lisait à voix basse son cours sur le fonctionnement du tube de Crookes en sautant de temps en temps inconsciemment quelques pages au milieu des piécettes et objets divers qui atterrissaient autour de lui.
Seule la physiologie était prise plus au sérieux. Elle nous était enseignée par le Professeur Chailley Bert, à l’allure de lord anglais qui ne manquait pas une occasion de faire référence à son illustre beau père, Paul Bert, et à son maître Charles Richet.
3ème année
La troisième année (photo de la promo) était essentiellement consacrée à l’anatomie pathologique et à la bactériologie. Nous avons eu le privilège de bénéficier de l’enseignement d’un brillant élève du Pr Remy Collin, le Professeur Pierre Florentin, directeur du Centre anticancéreux. Ses cours remarquablement illustrés par des schémas simples et clairs, faits au tableau, séduisaient l’auditoire.
Le Professeur Paulin de Lavergne avait des qualités d’orateur et d’enseignant exceptionnels. Ses cours étaient de véritables spectacles où l’auditoire était à la fois captivé par le verbe et amusé par les gestes et les mimiques.
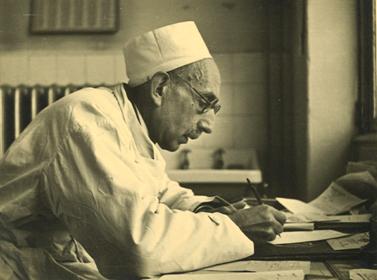
Paulin de Lavergne
On le voyait ainsi certains jours traverser l’estrade genoux ployés, les bras tombant ou majestueusement pour indiquer la banalité ou la rareté dune bactérie; ou encore pour retenir l’attention, rattraper au dernier moment sa paire de lunettes qu’il avait malicieusement laissée glisser sur son pupitre.
A partir de la quatrième année, les cours étaient peu fréquentés. Nos fonctions d’externe et la préparation à l’internat se substituaient avantageusement aux cours de pathologie.
5ème année
En 5ème année, l’hygiène et le traitement des gadoues intéressaient peu de monde.
Seuls les cours de thérapeutique du Pr Kissel emplissaient l’amphithéâtre.
Pour d’autres raisons, nous fréquentions le cours de médecine légale du Pr Mutel. Avec un flegme non simulé, il avait l’art de distiller nombre d’histoires drôles touchant une discipline qui ne s’y prêtait guère.
Enfin, la 6ème année était consacrée à la préparation des examens cliniques et à la thèse.

Salle des thèses (1954)
Concours hospitaliers
Dans le cursus des études médicales, les examens ne constituaient au pire qu’un barrage temporaire pour l’étudiant qui arrivait presque toujours à décrocher son diplôme de médecine, à condition d’avoir la patience et d’y mettre le temps. La seule sélection était celle des concours hospitaliers (interrompus de 1943 à 1945). On peut dire qu’un étudiant sur 3 devenait externe et qu’un externe sur 3 ou 4 devenait interne.
L’externat se passait habituellement en fin de 2ème année, mais dès le début de la première année, nous assistions aux conférences faites pas les internes.
L’examen comprenait 3 épreuves: une d’anatomie et deux épreuves médicales, l’une de médecine dite de pathologie interne et l’autre de chirurgie dite de pathologie externe. Chaque épreuve consistait en un exposé oral de 5 minutes devant le jury après tirage au sort des questions et préparation de 10 minutes.
Le concours d’internat se passait généralement en 5ème ou 6ème année et nécessitait une préparation intensive. A cet effet, notre livre de chevet était les« Conférences de clinique » de Louis Ramond en 13 volumes.
Le concours comportait 3 épreuves: anatomie – pathologie interne- pathologie externe, chacune d’une durée d’une heure.
Après les épreuves, le candidat lisait sa copie devant le jury sous la surveillance d’un camarade. Mais si l’écrit était discriminatoire, le résultat final et le classement étaient essentiellement en rapport avec les résultats de l’épreuve orale, éminemment pratiques, c’est-à-dire « l’épreuve des malades ».
Le candidat avait 1/4 d’heure pour examiner le malade tiré au sort et demander les quelques examens complémentaires nécessaires pour préciser le diagnostic. Après 15 minutes de réflexion, il devait en 10 minutes présenter le malade devant le jury en exposant successivement les symptômes, les signes cliniques et biologiques, le diagnostic différentiel, le diagnostic affirmé ou présumé, le traitement et éventuellement le pronostic. Enfin, une épreuve d’urgence départageait les ex-æquo.
Il faut dire que quel que soit le résultat, la préparation au concours, dans un esprit de compétition et plus particulièrement celle de l’épreuve de malades, constituait un enseignement fécond et vivant. Pour nous entrainer, nous faisions de nombreuses présentations de malades aux anciens internes et à quelques agrégés comme les PrChalnot et Kissel. On apprenait ainsi la discipline et la rigueur de l’examen clinique. On s’entrainait également à observer, à réfléchir, et à exposer.
Cet enseignement complet englobait la maladie, c’est à dire la pathologie et également le malade c’est à dire l’investigation clinique. La proclamation des résultats était suivie du traditionnel baptême. A cette époque, le nombre total des internes en exercice était limité à 15 ou 20, ce qui favorisait les réunions amicales et les sorties communes.
(photo d’internat – 1947 ) (photo – dans le service du Pr. Chalnot)
Les hôpitaux de Nancy
L’enseignement clinique au lit du malade ayant lieu tous les matins à l’hôpital, dès la première année, les externes avaient le privilège de participer pleinement à la vie des services et de faire partie du personnel médical de l’hôpital.
En 1943, au début de mon externat, les hôpitaux étaient la propriété pleine et entière des sœurs de Saint Charles qui en assuraient la gestion. L’administration était réduite à sa plus simple expression, c’est à dire à un économe gestionnaire et à un trésorier auprès duquel nous allions chercher à la fin de chaque mois notre maigre pécule.
Le personnage suprême et tout puissant et pour nous un peu mystérieux était la supérieure des soeurs de Saint Charles. Son pouvoir absolu pouvait à l’occasion aller jusqu’à faire ou défaire une carrière médicale.
Elle disposait d’un service de renseignement parfaitement structuré car la communauté exerçait un contrôle absolu et permanent sur tous les services. Les responsables des services et des salles communes étaient des sœurs dont l’autorité était d’autant plus grande qu’étant donné leur âge canonique, elles avaient souvent connu le chef de service alors qu’il n’était qu’externe, et il était courant de désigner un service ou une salle par le nom de la sœur responsable. Il faut dire toutefois que beaucoup de ces sœurs étaient à l’époque des femmes remarquables d’une grande intelligence ayant acquis sur le terrain une expérience considérable. De plus, disponibles 24h sur 24 et dévouées, elles assuraient auprès des malades un soutien moral irremplaçable.
La population hospitalière à l’époque était également différente de celle d’aujourd’hui L’hôpital était essentiellement réservé aux classes sociales les plus défavorisées qui ne bénéficiaient pas souvent de prestations financières maladie.
La sécurité sociale n’existait pas avant 1945. Seuls des salariés non cadre étaient obligatoirement inscrits à une caisse mutuelle d’assurance maladie ce qui représentait en fait une minorité de la population dans un pays encore à l’époque essentiellement agricole.
Les médecins peu ou pas rétribués exerçaient tous à temps partiel. Ceux qui n’avaient pas de fonction universitaire trouvaient leur revenu dans un exercice en clientèle privée ou comme consultant. Cet exercice était grandement favorisé par le titre prestigieux de « chirurgien ou médecin des hôpitaux ».
Ces facteurs socio-économiques retentissaient également sur les mentalités. Les malades étaient peu ou pas revendicateurs. Ils acceptaient sans grande explication et avec un certain fatalisme le verdict et les décisions médicales même lorsqu’elles se traduisaient par des mutilations importantes.
Le problème de la vérité au malade ne se posait pas. L’image du médecin qui donnait gratuitement des soins aux pauvres et aux indigents était grandie. Le pouvoir médical était considérable.
Chirurgie
Au début des années 40, certains chirurgiens commençaient à s’intéresser à la chirurgie fonctionnelle à la suite des travaux de Leriche, mais le chirurgien restait encore essentiellement dirigé vers la technique sur la base de ses connaissances anatomiques.
Nombre de techniques chirurgicales utilisées couramment aujourd’hui étaient déjà décrites, mais les conditions de réalisation de ces interventions avaient peu évolué depuis l’époque pasteurienne c’est à dire de l’asepsie.
L’intervention majeure était alors la gastrectomie subtotale. Ne disait-on pas qu’elle constituait le brevet du chirurgien et cette confirmation était acquise à l’interne qui, en fin de 4eme année, avait le privilège de réaliser sous la direction du patron ou du chef de clinique sa première gastrectomie.
Il faut dire que ses indications étaient alors très larges. Pratiquement tout ulcère qui ne répondait pas rapidement favorablement au traitement médical ou qui récidivait était opéré. Et j’ai vu nombre de jeunes de 20 ans ou même moins subir cette intervention qui était grevée d’une mortalité opératoire inacceptable aujourd’hui.
En effet les conditions de réalisation des interventions étaient précaires. Les techniques d’anesthésie générale utilisées nous paraissent aujourd’hui d’un autre âge. L’anesthésie était réalisée au Schleich (chlorure d’éthyle – éther – chloroforme) au masque d’Ombredanne, ou encore chez l’enfant au chloroforme en goutte à goutte sur une compresse.
Les moyens de réanimation se limitaient à l’inhalation d’oxygène et si nécessaire des transfusions de bras à bras, en utilisant en cas d’urgence le donneur que l’on avait sous la main, c’est à dire un brancardier ou l’externe de service.
Inutile d’ajouter que l’on ne disposait ni d’antibiotiques pour juguler l’infection, ni d’anticoagulant pour traiter les thromboses.
Dans de telles conditions la mortalité opératoire était fonction essentiellement de la maitrise du chirurgien, de la sureté et de la rapidité du geste. La durée d’une intervention ne devait pas dépasser en principe 60 minutes sans risque d’augmenter de façon intolérable les risques opératoires.
A cet effet l’adresse et la célébrité du Pr Hamant étaient légendaire, il était capable de battre des records. Personnage hors du commun, doué dune personnalité puissante et colorée, son influence lorsqu’il se trouvait dans un jury d’internat pouvait être décisive pour le candidat. Ainsi, tout externe soucieux de son avenir se devait de faire un stage en chirurgie B. La journée du Pr Hamant commençait à 5h30 à la clinique Bonsecours.
Lorsque 8H sonnait à la chapelle de l’hôpital, il arrivait au service portant sous son bras sa traditionnelle bicyclette jusqu’à son bureau. Tout le personnel médical l’attendait dans un alignement parfait.
La visite commençait et entouré de ses gardes du corps, chef de clinique et internes. Il parcourait au pas de course les 4 salles du service, suivi de la cohorte des externes.
Après cette courte visite débutaient les séances opératoires. Le Pr Hamant se réservait les 2 ou 3 interventions jugées les plus importantes, puis le chef de clinique et les internes prenaient le relais.
Le tableau opératoire était toujours très chargé : gastrectomie, colectomie, cholecystectomie se succédaient.
Les interventions gynécologiques les plus courantes étaient l’hystérectomie subtotale avec annexectomie réalisée souvent chez des femmes jeunes de moins de 30 ans pour saignements ou chez des femmes plus âgées pour fibrome. Les cancers gynécologiques étaient traités généralement par Wertheim ou Halsted.
Certaines interventions peuvent paraitre aujourd’hui anachroniques. Ainsi les péritonites tuberculeuses avec épanchement, très fréquentes à l’époque, étaient traitées et parfois guéries par simple exposition des lésions après laparotomie. Il s’agissait en l’occurrence d’une forme d’héliothérapie.
Les hernies et les appendicites étaient, bien sûr, l’apanage des internes, mais lorsqu’un externe avait été jugé particulièrement méritant, il avait le privilège à la fin de son stage de réaliser l’une des interventions sous le contrôle d’un chirurgien expérimenté.
La traumatologie occupait également une place importante et une salle au service des hommes était réservée à ces blessés.
L’enclouage des fractures du col, la pose de broches étaient des interventions courantes. La réduction des fractures, de même que la recherche des corps étrangers se faisaient sous contrôle scopique avec « la boule de Siemens », l’externe tenant l’écran. Ces appareils étaient mal protégés et nombre de chirurgiens de l’époque ont gardé des séquelles sous forme de radiodermites au niveau des mains.
Enfin, il faut dire que les ostéomyélites étaient fréquentes et en l’absence d’antibiotiques, le traitement était essentiellement chirurgical.
Dans les services de chirurgie le rôle essentiel de l’externe était celui d’anesthésiste. Inutile de décrire la terreur panique qui pouvait s’emparer de nous lorsque nous étions amenés à donner dans le service du Pr Hamant la première anesthésie générale pour le patron.
L’apprentissage était des plus sommaires. On nous mettait l’appareil d’Ombredanne dans les mains après avoir versé dans le réservoir une ampoule de Schleich. On nous expliquait qu’il fallait simplement monter progressivement la manette au repère 8, jusqu’à ce que le malade dorme, ce qui s’appréciait par l’abolition du réflexe palpébral, en mettant le doigt sur la cornée. Puis on devait redescendre progressivement la manette en surveillant la respiration du malade, c’est à dire le rythme d’expansion de la vessie et l’état de la pupille.
En fait il fallait beaucoup de doigté pour naviguer entre les 2 écueils, c’est à dire la syncope qui était annoncée par une mydriase et le réveil du malade associé parfois à des vomissements.
Lors des cas de syncope, la réanimation consistait essentiellement après avoir dégagé les voies respiratoires à l’administration de grandes tapes sur la joue du patient.
De temps en temps, le silence de la salle était brutalement rompu par les vociférations de l’opérateur: le sang est noir, le malade jaune. Quand cela ne se traduisait pas par des actes, le pauvre externe se retrouvait avec son tabouret au fond de la salle sous l’effet d’un magistral coup de pied du Pr Hamant.
On racontait également l’aventure arrivée à un jeune externe au service d’urologie du temps du Pr André. Elle avait donné lieu à un quiproquo assez comique. Le jeune externe effrayé par l’ampleur de l’expansion de la vessie de l’appareil s’était écrié : « Monsieur, la vessie va éclater ». Le patron intervenant chez le patient sur le même organe s’offusqua bruyamment de cette réflexion inopinée qui lui paraissait déplacée. L’externe eut finalement le mot de la fin en disant : « Monsieur ce n’est pas la vôtre, mais c’est la mienne qui va éclater ».
Parmi les spécialités chirurgicales, le service de chirurgie infantile du Pr Bodart se trouvait au pavillon Virginie Mauvais, actuellement détruit. Je n’ai pas fréquenté ce service mais le seul souvenir que j’en ai gardé est l’aventure qui m’est arrivée lors de ma première nuit de garde d’interne. A cette occasion, il faut dire que l’on avait du mal à contenir une certaine angoisse lorsqu’on se trouvait pour la première fois seul responsable dans cet immense hôpital.
La première partie de la nuit s’était relativement bien passée. Quelques appels souvent peu justifiés de veilleuses totalement incompétentes. Tel l’appel pour un malade pris soudainement de violentes douleurs abdominales et qui à mon arrivée se trouvait tout à fait bien après être passé aux toilettes.
Vers 1h du matin, je suis amené à examiner un enfant qui apparemment présentait une hernie étranglée. Je fais appel au chirurgien de garde qui à cette époque, n’ayant pas de moyen de locomotion, venait à pied depuis la rue de Metz. Au bout d’une heure, je le vis apparaitre en salle de garde pour m’informer que je l’avais dérangé inutilement, la sœur Rosalie, experte en la matière, ayant réduit la hernie dans un bain d’eau tiède.
Vers 3h du matin, je vois un autre enfant qui présentait manifestement des symptômes d’invagination intestinale. Cette fois, avant de déplacer le chirurgien, j’avais pris la précaution de consulter la sœur Rosalie pour savoir si elle n’avait pas également une technique pour réduire les invaginations des nourrissons.
J’ai fréquenté le service d’urologie du Pr André Guillemin lors de mon premier stage d’externe en 1943. Une des occupations essentielles de l’externe était alors de pratiquer dans une salle spécialement aménagée les nombreuses dilatations quotidiennes au Béniquet des urètres rétrécis le plus souvent à la suite de blennorragie.
Le service était sous la haute protection de la sœur Andrée qui, lorsque le patron apparaissait, se précipitait sur une petite clochette qu’elle actionnait fébrilement pour prévenir le personnel médical que la visite allait commencer.
Le service de gynécologie se trouvait dans le vieil hôpital Marin. Le Pr Binet était très connu pour ses publications de sexologie que l’on trouvait dans les kiosques à journaux. Elles faisaient scandale à l’époque alors qu’elles apparaitraient certainement bien banales aujourd’hui.
L’externe du service était préposé au traitement par Propidon des salpingites chroniques, ce qui représentait une forme de thermothérapie.
Enfin, la neurochirurgie naissante était alors abritée dans les locaux du service d’ORL du Dr Aubriot. Le Pr Rousseaux, chirurgien habile et orateur brillant trop tôt disparu y opérait déjà quelques tumeurs cérébrales. Mais les résultats de ces opérations souvent longues étaient alors décevants, car les malades décédaient habituellement dans les 24h, l’hypertension cérébrale étant alors mal contrôlée.
Et je l’ai entendu dire un jour désabusé qu’il n’y avait qu’une bonne intervention, c’était celle de l’appendicite aigüe. Heureusement il trouvait plus de satisfactions dans les interventions pour hernie discale ou dans la chirurgie de la thyroïde qu’il affectionnait.
Le Professeur Kissel intervenait au service comme consultant de neurologie, et cette brillante association constituait un magnifique tandem pour le plus grand bénéfice des étudiants.
Dans les services de chirurgie, l’externe était formé à une rude discipline. L’activité y était intense, le temps était compté et l’exactitude était de rigueur. Tout autre était l’atmosphère plus détendue qui régnait dans les services de médecine où la pose matinale traditionnelle de 11h favorisait les discussions.
On prenait également le temps de la réflexion pour élaborer des théories pathogéniques souvent ingénieuses et séduisantes mais rapidement caduques. Certaines conceptions de l’époque nous paraissent aujourd’hui complètement aberrantes.
On voyait la vérole partout. Certes, la syphilis était beaucoup plus fréquente qu’elle ne l’est aujourd’hui. A l’hôpital Fournier, on pouvait observer quotidiennement chancre, roséole, gommes …. De même, dans les services de médecine, on trouvait toujours quelques malades atteints de tabes et de paralysie générales
Mais on attribuait également à la syphilis ou plutôt à l’hérédosyphilis un grand nombre de maladies dont on ignorait l’étiologie. C’était le cas d’un grand nombre d’affections néonatales ou congénitales et d’une grande partie des maladies vasculaires ou neurologiques. Il suffisait de quelques dents malformées, d’une kératite suspecte, d’une aorte douteuse quelque peu déroulée pour entreprendre un traitement spécifique.
A la maternité, toute femme qui avait fait plusieurs avortements spontanés ou accouchements prématurés ou dont l’enfant était malformé, était suspectée de syphilis et était soumise au traitement par Novarsenobenzol et Bismuth.
L’interne, comme aujourd’hui, était une des chevilles ouvrières indispensables à la bonne marche des services de médecine, assurant le suivi des malades, l’accueil et l’examen des nouveaux malades, lors des contre visites. De plus, en l’absence de secrétaire médical, il écrivait le courrier.
L’externe était « le notaire » et prenait les observations détaillées. Mais de plus, comme les secrétaires n’étaient pas autorisées à pratiquer les ponctions veineuses, il était chargé également des prises de sang, injections intra veineuses et des diverses ponctions d’épanchement pleuraux ou d’ascites.
Mais les services constituaient avant tout une école de clinique où l’on apprenait à interroger, à palper, à ausculter. L’examen clinique du malade était fondamental et devait permettre dans la plupart des cas d’établir le diagnostic.
C’était une application de la méthode anatomoclinique décrite déjà en 1819 par Laennec. L’auscultation occupait ainsi une place importante en pneumologie: elle se faisait directement à l’oreille au travers d’une serviette. Les râles crépitants, les tintements métalliques et le souffle amphorique du pneumothorax.
Les examens complémentaires étaient limités, en dehors des examens systématiques traditionnels: NF, BW, urée, recherche du sucre et de l’albumine dans les urines. On réalisait parfois à la demande: constante d’Ambard, glycémie, dosage des protides et tests hépatiques.
Les radiographies étaient demandées en fonction des données de l’examen clinique.
En période de restriction, il était d’usage de réduire le nombre des clichés qui étaient d’ailleurs souvent de mauvaise qualité. Le Pr Lamy, responsable du service de radiologie, avait d’ailleurs décrété qu’il était inutile de faire des radios pulmonaires de profil, arguant de l’incapacité des médecins pour interpréter correctement un cliché de face.
Dans le domaine de la thérapeutique, les moyens doués de quelque efficacité étaient peu nombreux en dehors de quelques diurétiques et tonicardiaques,
– des anti inflammatoires de type salicylate de sodium (utilisé pour le traitement du rhumatisme articulaire aigu, pathologie fréquente à l’époque.
– de la quinine utilisée dans le paludisme et comme anti thermique
– de l’insuline pour traitement du diabète.
L’infection était traitée par les sulfamides depuis la découverte de Domack en 1935.
Dans certains cas de septicémies et endocardites malignes, on utilisait couramment l’abcès de fixation provoqué par l’injection de térébenthine.
Enfin, l’alcool par voie intraveineuse sous diverses formes avait une place importante dans le traitement des pneumopathies aigues.
Mais si les médicaments actifs étaient peu nombreux, la pharmacologie n’en était pas moins riche. Si l’on se réfère à l’épaisseur du codex, emplis de noms à consonance latine que nous étions censés connaitre pour l’examen de pharmacologie qui constituait une épreuve redoutable.
L’examinateur ouvrait au hasard une page du Codex et le candidat devait donner la propriété, les indications et la posologie du produit qui y figurait.
Il faut dire également que les préparations magistrales de certain de nos Maîtres telles que celles du Pr Louyot faisaient notre émerveillement en même temps que la terreur des pharmaciens.
La pathologie rencontrée dans les services de médecine différait quelque peu de celle rencontrée aujourd’hui. Je n’ai pas vu de cirrhose pendant des années de garde du fait du sevrage alcoolique. Le cancer du poumon était très rare. Il faut dire que les indications de la bronchoscopie étaient restreintes et le diagnostic n’était fait qu’à un stade tardif.
Les moyens thérapeutiques étant limités, nombre d’affections aujourd’hui facilement curables étaient réputées généralement mortelles.
Il en était ainsi des endocardites à évolution lente d’Osler.
Il en était de même de la maladie de Hogkin, bien que quelques rémissions pouvaient déjà être espérées à la suite de traitement radiothérapique.
Les deux services de médecine générale A et B se faisaient face de part et d’autre de la cour centrale au 1er étage des bâtiments Collinet de la Salle et Roger de Videlange.
L’ambiance qui y régnait était également différente. Au service du Pr Drouet, l’hormonologie occupait une place importante. La clinique y était brillante et on avait le culte du trait de génie qui donnait le jour à de nouvelles pathogénies.
En face, le Pr Abel manifestait une conscience professionnelle poussée jusqu’au scrupule et il régnait dans ce service une atmosphère de sérieux et de gravité qui se répandait sur tout et sur tous.
Chez le Docteur Mathieu
Voisin des deux grands services de médecine générale, le service de médecine complémentaire du Dr Mathieu était situé sous les combles dans le pavillon Collinet de la Salle.
Les malades devaient gravir à pied les deux étages, ce qui constituait une véritable épreuve d’effort, le nombre et la durée des étages constituant un bon test pour apprécier l’état des coronaires et témoignant du degré d’insuffisance cardiaque.
Dans le local des consultations, l’électrocardiogramme à corde était un meuble impressionnant plus proche d’un buffet lorrain par son volume que des appareils modernes. Il nécessitait pour son maniement la main experte des demoiselles Hadot qui seules étaient capables d’obtenir un tracé satisfaisant.
La visite était agrémentée de longues stations au lit des malades. Le Maître auscultait attentivement dans un profond silence posant délicatement son stéthoscope dont la longueur inhabituelle des tuyaux de caoutchouc nous impressionnait. Puis chacun de nous s’évertuait à percevoir et à localiser le petit souffle diastolique ou le bruit de galop qu’il avait décrit et que nos oreilles inexpertes ne trouvaient que rarement.
Entre deux salles, il s’arrêtait volontiers, et pour détendre l’atmosphère, il nous contait une histoire drôle vécue, telle que celle du père Garnier, professeur de Chimie dans les années 20 dont il avait été le préparateur.
C’était l’heureuse époque où les étudiants passaient les examens individuellement quand ils le désiraient. Certains étaient plus assidus des brasseries que des salles de cours et l’un d’eux se rendant au labo de chimie pour fixer la date de son examen tombe sur un vieil homme à la blouse crasseuse qui farfouillait dans un poêle à charbon pour en ranimer la flamme. Il lui dit, le prenant pour un garçon de laboratoire : « Tu sais pas où est le vieux con de père Garnier » et l’autre se raidissant lui répondit : « le vieux con, c’est moi ! »
Inutile de décrire la stupeur de l’étudiant et le résultat de l’examen.
Les malades hospitalisés au service de cardiologie étaient pour la plupart des cardiaques en état de décompensation avancée, auxquels on administrait largement les quelques médicaments diurétiques et tonicardiaques disponibles associés si nécessaire aux ponctions d’hydrothorax et d’ascite. La saignée était couramment pratiquée chez les hypertendus et dans les œdèmes aigus du poumon. Les grands œdémateux étaient soulagés par le drainage lymphatique réalisé par tube de Southey placé aux chevilles.
Enfin, le Dr Mathieu affectionnait l’application de sangsues dans les œdèmes phlébitiques, ce qui réalisait un traitement heparinique avant l’heure. J’ai d’ailleurs lu récemment dans la littérature que ce moyen thérapeutique qui nous parait d’un autre âge existe toujours dans la pharmacopée et connait une nouvelle vogue en microchirurgie pour la résorption des œdèmes veineux.
Nous gardons du Dr Mathieu l’image d’un vrai médecin.
Il était doté d’une grande culture et d’un vaste savoir médical acquis par le travail et d’une longue pratique en clientèle et à l’hôpital. Fin psychologue, il savait être proche du malade, et, quelque soit sa condition sociale, trouver le langage le mieux approprié pour communiquer avec lui. Il savait également à l’occasion se montrer paternel et bienveillant avec ses collaborateurs.
Autres services médicaux
En 1943, le service des contagieux du Pr de Lavergne était transféré de Maringer à la maison de sœurs actuellement Hôpital St Charles.
En l’absence de vaccination systématique, la fréquence des maladies infectieuses était nettement plus élevée qu’aujourd’hui et on ne disposait d’aucun traitement spécifique en dehors de la sérothérapie. On y retrouvait toutes les maladies infectieuses de l’enfance dont les complications étaient parfois redoutables en l’absence d’antibiotique.
Chez l’adulte, les cas de tétanos étaient fréquents. Il en était de même des paratyphoïdes et des typhoïdes dont il existait un foyer endémique dans la Meuse à Bar Le Duc, et les décès dans les formes graves n’étaient pas exceptionnelles.
Les cas de fièvre de Malte paraissaient également de plus en plus fréquents.
L’hôpital Villemin était à l’époque un hôpital sanatorium où l’on soignait exclusivement la tuberculose pulmonaire. Cet hôpital avait été construit en 1922 sur le modèle des sanatoriums. On peut encore voir actuellement les galeries de cures où les malades passèrent de longues heures allongées pour effectuer leur cure de repos et de silence.
La tuberculose dans ces années de guerre et de privation était le grand fléau à l’époque, touchant activement les jeunes. Les étudiants en médecine étaient plus particulièrement exposés et payaient un lourd tribu. Près du tiers de l’effectif de étudiants de chaque année de médecine subissaient plus ou moins sévèrement l’atteinte du mal et plusieurs de nos camarades l’ont payé de leur vie.
En l’absence de traitement spécifique, la thérapeutique habituelle dans les formes excavées était la collapsothérapie, c’est à dire essentiellement le pneumothorax associé le plus souvent à une section de bride et entretenue plusieurs années. Il se compliquait fréquemment d’épanchement liquidien ou purulent nécessitant un drainage.
Lorsque la collapsothérapie par simple pneumothorax s’avérait insuffisante, on préconisait parfois pour les cavernes du lobe inférieur la phrénicectomie qui entrainait un déficit ventilatoire important et pour les cavernes du sommet les plus fréquentes la thoracoplastie.
J’ai assisté à quelques unes de ces interventions réalisées à l’époque à l’hôpital Maringer par le Pr André Guillemin. Les opérations étaient redoutées par les malades. Elles étaient très mutilantes et très pénibles, car réalisées sous anesthésie locale, elles étaient très douloureuses. J’entends encore d’un jeune malade, qui, au cours de l’intervention, alors que le Pr Simonin devisait avec le chirurgien de la situation politique du moment, s’écria excédé : « M’en fous de votre Pétain et de votre De Gaulle », ce qui contribua instantanément à ramener au silence absolu.
Pour tous les malades, une cure de repos en sanatorium, généralement à la montagne, pendant de nombreux mois, voire plusieurs années, complétait le traitement, mais on ne pouvait malheureusement le plus souvent espérer qu’une stabilisation des lésions et les rechutes étaient fréquentes.
Inutile de dire que la mortalité était importante.
Les malades multi excavés et cachectiques mouraient habituellement dans un tableau de généralisation associant granulie, laryngite et parfois méningite tuberculeuse.
Hautement contagieux, ces moribonds étaient isolés dans une chambre individuelle ce qui avait souvent un effet psychologique dramatique.
A l’hôpital Fournier, à coté des cas de galle qui encombraient les consultations, le diagnostic et le traitement de la syphilis occupaient une place importante. Fournier, médecin de Saint Louis, avait consacré sa vie à la syphiligraphie.
L’externe chargé chaque matin de faire les injections de novarsenobenzol aux longues files de malades atteints ou présumés y perfectionnait sa technique.
Au pavillon Ricord du Dr Bonnet, personnage pittoresque au vocabulaire de troupier, traitant énergiquement les blennorragies par les grands lavages urétraux au permanganate.
Le service de médecine infantile situé au pavillon Krug était peu hospitalier pour les externes ou les internes qui n’étaient pas du service. L’Amélie, non religieuse, factotum du patron et véritable cerbère, refoulait systématiquement tout visiteur importun. Elle était pleine d’attention pour le Maître, le professeur Caussade qu’elle tirait par la manche pendant la visite de 11H45 pour lui passer son manteau afin qu’il ne rate pas son tramway pour rentrer chez lui.
La maternité a toujours été un service à part. Le Professeur Vermelin enseignait que l’accouchement est et doit rester un acte physiologique, la nature étant présumée faire les choses au mieux. Trop souvent, l’intervention médicale crée la dystocie et était à l’origine des complications.
Cette conception traduisait un certain bon sens à une époque où l’infection était redoutable en l’absence d’antibiotique.
Toutes les femmes fébriles étaient transférées immédiatement au pavillon d’isolement. On y rencontrait également nombre de jeunes femmes qui, à la suite d’un avortement provoqué dans des conditions précaires, mourraient généralement de péritonite dans un tableau de septicémie.
Que dire du pavillon de Radiothérapie en 1940 ! Le Pavillon des cancéreux, c’était le refuge des malades atteints de cancers avancés, au teint jaune paille, et qui présentaient souvent d’énormes tumeurs surinfectées et nécrosées.
Il faut dire que les cancéreux étaient moins nombreux à l’époque et que le cancer ne constituait pas comme aujourd’hui un problème de société.
On peut évoquer plusieurs raisons: l’espérance de vie était plus courte, les moyens de diagnostic étaient limités.
Enfin, nombre de personnes âgées, surtout de la campagne, dépourvues de protection sociale et de ressources, refusaient toute hospitalisation.
Pour beaucoup, la chirurgie représentait alors le seul traitement à visée curative. Et jusqu’à l’arrivée du Pr Chalnot en 1945, il n’y avait pas de chirurgien au Centre. Le traitement radiothérapique n’était souvent perçu que comme un pis aller relevant un peu des médecines parallèles. Si son efficacité était discutable, ce traitement avait au moins l’avantage de donner au médecin la possibilité d’expliquer au malade, lorsque son état s’était aggravé, que c’était l’effet des rayons et que cet effet était transitoire, et qu’il ne pouvait qu’aller mieux.
La médecine après 1945
De 1940 à 1945, on a donc assisté en France et à Nancy, à une certaine stagnation des sciences médicales. Pendant les années de guerre, les moyens de communication étaient pratiquement inexistants et de plus, la plupart des travaux anglo saxons étaient couverts par le secret militaire.
L’arrivée des américains en automne 44 fut pour nous une révélation.
Ils amenaient dans leur paquetage un produit miraculeux, la pénicilline, dont l’action bactéricide apparaissait spectaculaire avec des doses qui nous paraissent aujourd’hui ridicules, de l’ordre de 500.000 à 1.000.000 d’unités au total.
Le produit était distribué avec parcimonie aux civils et par suite réservé aux malades les plus gravement atteints. Les flacons étaient conservés à basse température et les injections se faisaient toutes les 3 H. C’est à cette occasion que s’est installé à l’hôpital un externe de garde chargé de parcourir la nuit les salles pour réaliser les traitements.
L’apparition de la pénicilline a marqué le début de l’antibiothérapie et fut bientôt suivie de nouvelles drogues.
Ainsi, en 1947, l’avènement de la streptomycine a permis enfin le contrôle du BK.
Un service spécial fut créé à Maringer sous le contrôle du Pr de Lavergne où l’on traitait essentiellement des granulies et des méningites BK.
Je me souviens alors que j’étais interne au service en 1948 du premier malade traité et guéri à Nancy d’une méningite tuberculeuse.
C’était un médecin biologiste alsacien qui avait fait lui même son diagnostic et suivait avec angoisse l’évolution de sa maladie.
Peu de temps après, ce fut l’avènement de la typhomycine qui modifie le pronostic de la typhoïde.
L’arrivée des américains a également marqué le début d’une ère nouvelle en chirurgie.
Les américains ont permis d’équiper les hôpitaux avec les premiers appareils d’anesthésie à circuit fermé.
En même temps, l’armée américaine approvisionnait les services de chirurgie en flacon de plasma en attendant l’ouverture par le Pr Michon en 1948 du Centre Régional de Transfusion. Cette évolution des techniques d’anesthésie et de réanimation favorisait en particulier le développement au service du Pr Chalnot de la chirurgie thoracique puis de la chirurgie cardiaque.
Par la suite on assista à l’éclatement de la médecine et de la chirurgie générale en nombreux services de spécialité.
Les locaux de l’hôpital central s’avérèrent bientôt trop exigus et dès 1948, on faisait des projets pour le nouvel hôpital.
Parallèlement, sous l’influence du Pr Jacques Parisot, élu doyen en 1949, la faculté devait également connaitre un développement et une expansion considérable.
Si l’on fait le bilan de l’état de la médecine en cette fin de siècle par rapport à ce qu’il était dans les années 40, le bilan est certes très positif.
La pénétration de la médecine par les sciences exactes, physique et chimique, et par les sciences biologiques, est à l’origine de développements prodigieux dans tous les domaines et cette évolution se poursuivra certainement dans l’avenir.
Mais il ne faudrait pas que la médecine ne devienne que l’expression d’une haute technicité orientée uniquement vers le traitement de la maladie, le malade lui même étant considéré comme une association d’organes, qui font l’objet de multiples investigations, réunis dans des bilans parfois impressionnants, quand il n’est pas assimilé à un simple volume cible.
Ainsi, lors des staffs du lundi soir au service du Pr Chalnot, la présentation et l’examen du malade était de règle avant la prise de décision thérapeutique. Actuellement, ces décisions se prennent souvent sur simple examen de dossier, et l’on peut craindre que dans l’avenir, l’ordinateur seul établisse le programme thérapeutique.
Malgré les progrès, la médecine ne sera jamais une science exacte, et il est nécessaire de conserver l’esprit médical, transmis par nos anciens maitres, généralistes et humanistes, et qui repose sur la valeur de l’examen clinique, le développement de l’esprit clinique et la personnalité de chacun.
Article trouvé sur l’excellent site: http://www.professeurs-medecine-nancy.fr/Schoumacher_souvenirs.htm